|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Avertissement :
Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.
Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.
Merci.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
256, 257,
258, 259, 260,
261, 262, 263,
264, 265,
| |
FÊTES DE NOËL ET DE FIN D’ANNEE
Chers Amies, Chers Amis,
En ce mois de décembre, comme chaque mois, j'ai la joie de m'adresser à vous. Et une fois n'est pas coutume, je souhaite remercier aujourd'hui tous ceux qui me font parvenir textes, documents et photos et qui participent avec dynamisme et compétence, à la mission, de préservation de notre mémoire, qui est la mienne au travers de la Seybouse. Rien n'est parfait en ce bas monde, nous faisons ce que nous pouvons.
Le temps de l’Avent est là, les sapins sont habillés et décorés, les illuminations de Noël sont installées dans les rues, la neige nous a fait l’honneur de passer dans certains endroits, les enfants ont comme d’habitude, envoyé leur liste au Père Noël, les familles préparent les réveillons.
Sur les pas de Marie et Joseph qui ont fait naître leur Divin Fils dans une étable, osons la simplicité, le dénuement, l’humilité.
 N’oubliez pas le 4 Décembre, pour la Sainte-Barbe, chacun doit semer du blé (ou des lentilles) sur du coton imbibé d'eau dans une coupelle et Saint Nicolas le 6 décembre pour les bonbons et les chocolats.
N’oubliez pas le 4 Décembre, pour la Sainte-Barbe, chacun doit semer du blé (ou des lentilles) sur du coton imbibé d'eau dans une coupelle et Saint Nicolas le 6 décembre pour les bonbons et les chocolats.
Je souhaite à Tout le Monde de Bonnes et Joyeuses Fêtes.
" Bône " lecture et bon mois de décembre
A tchao, Diobône,
Jean Pierre Bartolini
| |
JARDIN DES ETOILES 2025
Fleurissement cimetière de Bône
Par Mounir Hanéche et Eric Wagner
|
|
Mesdames, messieurs, chères et chers compatriotes bônois(es), bonjour.
Comme depuis des années, nous avons été encore au rendez-vous de la mémoire des nôtres laissés en leur terre algérienne.
Nous n'avons pas été nombreux, une trenaine de tombes fleuries car nos rangs se dégarnisent à vue d'oeil.
Malgré les travaux entrepris, éclairage, rehaussement de murs, fermeture de tombes, et autres par l'APC et le Consulat de France, les dégradations continuent.
Nous avons marqué de notre présence le fleurissemnt de nos tombes.
Merci à Mounir et à Eric Wagner pour leur implication dans cette marque de respect et du souvenir envers nos anciens.
Solidairement, piednoirement, bônoisement vôtre.
JPB
Deux photos ci-jointe la Vierge à l'entrée du cimetière et la Stèle dédiée à tous les morts.
|
|
LA MONA
Paul GOETZINGER
Echo de l'ORANIE N°249, MARS/AVRIL 1997
|
C’est une belle histoire. Une histoire liée à I'histoire d'Oran et qui a laissé ses marques. Mais, en raison des modifications phoniques et orthographiques, les Oranais pour la plupart l'ignorent, alors qu'ils connaissent les lieux où elle se déroula.
L'action se situe dans la première période de I'occupation espagnole qui débuta en 1505 par la prise de Mers-El-Kébir et ensuite la conquête d'Oran en 1509. Les raisons de ces opérations seraient trop longues à expliquer dans le cadre de notre récit.
C'est une magnifique histoire d'amour qui, comme souvent dans le cas, se termine tristement et même plus : ... tragiquement.
A l'époque Oran ne constituait qu'un "Presidio" avec une garnison réduite. Un jeune lieutenant eut besoin d'une domestique pour s'occuper de son foyer. Il n'était pas question d'avoir du personnel civil venant d'Espagne et les autochtones rechignaient à servir un roumi. Il dut se rabattre sur une Mona. Pour expliquer cette appellation, il convient de décrire le site environnant Oran.
La barrière montagneuse du Murdjadjo qui sépare la mer de la dépression de la Grande Sebkha, vestige de I'ancien "Golfe Sahélien", s'étend depuis M'Sila à 591 m, jusqu'au piton rocheux de 360 m qui chapeaute, ou plutôt qui chapeautait, le massif conique de I'Aïdour séparant la baie d'Oran de la rade de Mers-El-Kébir.
L'action humaine a quelque peu modifié I'aspect final de la chaîne. D'abord la construction du fort sur le piton de I'Aidour qui a perdu son nom pour celui de Santa-Cruz, ne laissant son origine qu'aux merveilleuses grottes qui se trouvent à ses pieds. Ensuite la faille qui sépare le fort de la Meseta, plus connue sous le nom de "Plateau du Marabout".
Cette faille, que d'aucuns appelaient "Le Col" fut exécutée au début des années 1770 sous les ordres du colonel Hontabat, commandant les ingénieurs du Génie espagnol, afin d'arrêter les attaques incessantes du fort par les troupes ennemies voulant chasser les espagnols du territoire. C'est une réalisation colossale que beaucoup d'Oranais ignorent tant on a de peine à I'imaginer.
A l'époque qui nous concerne ce relief était quasiment dépourvu de végétation à part quelques touffes de broussailles sortant des éboulis de rochers. Pour l'occupant espagnol il n'était pas sans similitude avec le rocher de Gibraltar. Pourtant des groupes humains offrant une ressemblance avec le caractère de ce gitan, mais de confession islamique, s'y maintenaient.
Compte tenu du rapprochement avec Gibraltar les Espagnols eurent vite fait d'appeler ces populations "les Monos et les Monas" en comparaison avec les singes de race "Guenons" qui vivent sur le rocher du Détroit. Entre parenthèses, par quels détours ce qualificatif de guenon est arrivé à être donné, en français à la femelle du singe ?
La question reste posée.
Ainsi notre officier eut à son service une Mona.
Apparemment elle dut lui donner entièrement satisfaction en tout et pour tout car il en eut un enfant.
Ce fait dû rester plus ou moins secret et ce n'est qu'au second enfant que le scandale éclata. Cela se sut dans les sphères dirigeantes de la très catholique Espagne.
Comment ! un de ses sujets en concubinage avec une musulmane et en sus, de la plus basse espèce. Inadmissible en pleine Inquisition.
La réaction ne se fit pas attendre. Le lieutenant fut sommé de regagner sans délai sa sainte patrie par le premier navire en partance d'Oran, sans préjuger des sanctions à venir.
Le jour où la caravelle emmenant le fautif quittait le bassin à fond de sable à peine protégé par un simple épi d'enrochement, la Mona, un enfant au bras et I'autre tenu par la main, s'enfonça de plus en plus dans la mer jusqu'à noyade des trois malheureux.
Cet événement marqua si profondément les habitants d'Oran qu'ils appelèrent la plage où eut lieu le drame : "La Playa de la Mona".
Entre 1518 et 1534, le marquis de Comares, gouverneur d'Oran, fit élever un fort sur l'éperon rocheux qui domine la plage auquel on donna le nom de "El Castillo de la Mona".
Les Espagnols occupèrent Oran une première fois de 1509 à 1708, puis s'implantèrent une seconde fois de 1732 à 1791, date à laquelle ils abandonnèrent définitivement le Presidio après moult difficultés et surtout le tremblement de terre dévastateur de la nuit du 8 au 9 Octobre 1790. Les noms des lieux qui nous concernent furent néanmoins maintenus jusqu'à I'arrivée des Français en Août 1831; Apparemment il semble qu'il n'en fut pas de même durant la période française. En réalité il n'en est rien et voici pourquoi.
En espagnol toutes les lettres d'un vocable se font sentir dans la prononciation avec plus ou moins de puissance sur les syllabes suivant I'accent tonique, ce qui sous la dictée facilite l'orthographe. Ce qui n'est pas du tout le cas en français. N'est ce pas Monsieur PIVOT ?..
En prononçant le nom donné à la plage et au fort, les Français en estompèrent d'abord le A final de Mona ce qui donna "La Mone", puis avec leur accent que les méditerranéens qualifient de "pointu", le O sec et bref s'adouci et donna "La Moune". Ce n'est que bien plus tard que I'article et le nom furent accolés pour donner en définitif "LAMOUNE", vocable qui n'échappe plus à la mémoire de nos concitoyens connaissant bien le fort LAMOUNE ainsi que le quai du même nom érigé sur la fameuse plage ou se situait la base de la Marine Nationale avant la création du port militaire de Kébir.
Voilà la triste histoire d'amour de la MONA qui est tombée dans I'oubli malgré les traces qu'elle a pu laisser.
Il est dit mais, rien n'est prouvé, que la pâtisserie pascale chère aux Oranais "La Mouna", aurait subit partiellement la même transformation dénommée à I'origine La Mona, soi-disant, parce qu’elle figurait le cône de Santa-Cruz avec son semis de sucre concassé représentant la rocaille du site. De plus, au temps où cette spécialité n'était que de confection familiale, on y ajoutait au sommet un oeuf dur simulant le fort pour renforcer la comparaison.
Paul GOETZINGER
|
|
MAI 1962... LA DERNIERE COMMUNION
ACEP-ENSEMBLE N°305, septembre 2017
|
|
Le drame de Manchester a coûté la vie à des enfants et adolescents. Le terrorisme islamiste a encore frappé en faisant exploser une bombe au cœur d'un concert, Manchester fait suite à Londres, Stockholm, Berlin, Nice, paris, etc.
Cette fureur et cette barbarie avaient déjà frappé, toujours par des bombes et des égorgements, en Algérie il y a un peu moins de soixante ans.
«Des mots qui pleurent et des larmes qui parlent »
(Abraham Cowley)
Qu'elle était radieuse I'aurore de ce dernier dimanche de Mai 1962 à Oran ! ... Le ciel était tout blanc, d'une blancheur de gaze, où scintillaient des gouttelettes nacrées, pluie d'atomes lumineux dont la chute emplissait l'éther d'une immense vibration qu'on aurait dit minuscule. Tel une plume blanche, un nuage solitaire se courbait au-dessus de la ville, cette ville, hier si gaie, si propre, si belle qui, aujourd'hui, avait le visage gris des malades incurables, des cancéreux à quelques jours de leur mort.
Avec le mois de Mai étaient revenus les cortèges immaculés des premiers communiants, et dans cette époque de violence et de haine, il n'y avait rien de plus émouvant que ces enfants graves et recueillis, rayonnants de foi et vêtus de la blancheur des lys.
Parmi eux, se trouvait Sophie Dubiton, amputée d'une jambe et qu'on portait dans le cortège des communiantes. ElIe avait été l'une des premières victimes du « boucher d'Oran », le général Katz, commandant le secteur autonome d'Oran qui avait donné la consigne à ses troupes essentiellement constituées de « gens sûrs », en l'occurrence de gendarmes mobiles, « de tirer à vue sur tout européen qui aurait l'audace de paraître sur une terrasse ou un balcon lors d'un bouclage ».
Les premières victimes du « boucher d'Oran » furent deux adolescentes de 14 et 16 ans : Mlles Dominiguetti et Monique Echtiron qui étendaient du linge sur leur balcon. Elles furent tuées par les gendarmes. Les projectiles d'une mitrailleuse lourde de 12/7 traversèrent la façade et fauchèrent dans leur appartement, Mme Amoignan née Dubiton, dont le père était déjà tombé sous les balles d'un terroriste du FLN, ainsi que sa petite fille, Sophie, âgée de deux ans et demi et sa sœur, Frédérique, âgée de treize ans qui, atteinte à la jambe, eut le nerf sciatique attaché et dut être amputée.
 Pourquoi lui refuser, malgré l'atrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la cérémonie ? Elle n'aurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait après tant de souffrances imméritées. Pourquoi lui refuser, malgré l'atrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la cérémonie ? Elle n'aurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait après tant de souffrances imméritées.
Alors, toute parée, superbe dans ces blancheurs d'étoffe qui l'entouraient comme d'un rayonnement de candeur, Frédérique, se sentait enveloppée d'amour, réchauffée par les sourires lumineux de ses voisins et amis qui lui témoignaient leur tendresse et l'astre radieux, semblait une pluie d'or qui ruisselait de ses mains fines.
Et cette vision insolite de ces enfants encadrés de C.R.S ! ... parce que leur quartier étant bouclé par suite d'une perquisition générale, on n'avait pas le droit d'en sortir, sinon avec ces charmants messieurs. C'était grotesque et digne d'Ubu Roi ! Ces petites filles parées de blanc, se rendant vers I'aumônerie du lycée, ridiculisaient par leur innocence la faconde de ces matamores qui les accompagnaient d'un air soupçonneux. Pensez donc, si elles allaient emporter sous leurs voiles les tracts et les armes de I'OAS ! On massa les enfants, place de la Bastille, avec les mitrailleuses braquées sur eux. Et le chanoine, sur le devant de son église, bénit les communiants en disant : « Aujourd'hui, pour venir ici vous avez du franchir les armées ; vous avez franchi les armées de Satan ! Ne l'oubliez jamais ! Que cela vous reste comme le symbole, I'exemple de ce que vous devrez toujours être prêts à faire : franchir les armées du démon pour venir à la maison de Dieu. »
Après cette déclaration, le chanoine fut arrêté...
Comme on a raison de cacher aux enfants la vue des laideurs humaines.
Le triomphe de la force, la victoire de I'injustice, sont des secousses trop violentes pour eux. Ils doivent croire longtemps que Dieu intervient en faveur des belles causes, que le Mal ne peut prévaloir contre l'amour et le sacrifice.
Quand l'âme a pris ce pli de foi dans l'enfance, rien après ne I'efface plus. Ces petits êtres vêtus de blanc, ont été dépouillés trop jeunes de leur tunique d'illusions. Ils ont vu que leurs prières d'enfants purs ne touchaient pas le ciel, que la tendresse de leurs parents ne pouvait pas les protéger contre les abus de la force, qu'une balle bien dirigée ou qu'un couteau trop vif valait plus que cent cœurs vaillants... et de ce jour, ils sont restés tristes de cette certitude.
Ah ! Quand le sommeil de la mort nous jettera dans la terre, puissions-nous alors ne plus rêver, ne plus voir les tristes réalités de notre triste monde !...
José CASTANO
« Si j’avais le pouvoir d’oublier, j'oublierais. Toute mémoire est chargée de chagrins et de troubles »
(Ch. Dickens)
 Cette photo représente la petite Frédérique DUBITON le jour de sa communion. (Parue dans l'hebdomadaire « CARREFOUR » du 16 Mai 1962.). Pour preuve de la désinformation qui sévissait alors en Métropole et du lynchage médiatique que subissait perpétuellement l'OAS, certains journaux -toute honte bue- à l'instar de « La Marseillaise du Languedoc », journal communiste et de « L'Indépendant » de Perpignan, avaient publié cette photo accompagnée de la légende suivante : « Chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués ou blessés par les criminels de I'OAS en Algérie... Personne n'est à l'abri de leurs mauvais coups. Pitoyable témoignage. Cette petite communiante sortant d'une église d'Oran « du être amputée d'une jambe à la suite d'un plasticage de l'OAS (sic) » Cette photo représente la petite Frédérique DUBITON le jour de sa communion. (Parue dans l'hebdomadaire « CARREFOUR » du 16 Mai 1962.). Pour preuve de la désinformation qui sévissait alors en Métropole et du lynchage médiatique que subissait perpétuellement l'OAS, certains journaux -toute honte bue- à l'instar de « La Marseillaise du Languedoc », journal communiste et de « L'Indépendant » de Perpignan, avaient publié cette photo accompagnée de la légende suivante : « Chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués ou blessés par les criminels de I'OAS en Algérie... Personne n'est à l'abri de leurs mauvais coups. Pitoyable témoignage. Cette petite communiante sortant d'une église d'Oran « du être amputée d'une jambe à la suite d'un plasticage de l'OAS (sic) »
Ainsi, les coups les plus vils et les plus bas étaient régulièrement portés par ces « plumes vertueuses » pour en finir avec un élément indésirable qui troublait leur béatitude. Un machiavélisme féroce et inconscient présidait à l'élaboration du grand crime qui se préparait : Les informations quotidiennes étaient cyniquement dénaturées, des extraits tendancieux, des truquages perfides, des censures arbitraires en représentaient seuls les pages les plus réalistes. La vérité était altérée par des récits tendancieux à l'excès et par omission systématique de tout ce qui aurait convenu le mieux de mettre en lumière, tout cela afin de convaincre I'opinion publique que l'Algérie française était une chimère entretenue par une minorité d'exaltés.
Et pendant ce temps, le FLN, soutenu par cette « intelligentsia » progressiste, perpétrait impunément dans l'indifférence générale ses horribles forfaits...
Destins tragiques.., La famille Dubiton
Pierre Dubiton (photo) naît à Oran le 30 octobre 1942. Son père, Georges, agent de contrôle sanitaire à la ville d'Oran, est tué le 26 octobre 1956 par un commando de 3 terroristes du FLN en descendant du bus. Elève du lycée Lamoricière, comme beaucoup d'Oranais, Pierre Dubiton joue au football : il est milieu de terrain au Club des Joyeusetés d'Oran.
A 17 ans, il s'engage au 1er Régiment Etranger de Parachutistes, où il reste 20 mois. Il sera blessé 3 fois.
Un jour, il est appelé après le massacre d'une famille. C'était celle de sa demi-sœur.
Les quatre têtes étaient posées dehors. Sa sœur avait 11 ans.
Les fellaghas I'avaient violée, éventrée, mutilée.
En mai 1961, Pierre Dubiton, en cavale passe à I'OAS zone 3, dans le commando Franck (du nom de son chef Franck Perrier), un des commandos de la Colline 3 qui englobait le centre-ville, le quartier israélite et la Médina, parfois nommée « Bayard » (dont le chef est Jean Bart), elle-même une des 10 zones de I'OAS Oran (dirigée par les Micheletti père et fils, Charles et Claude, sous les ordres du général Jouhaud, secondé par le commandant Camelin et le lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, le « crabe-tambour »).
Le 27 mars 1962, des bombardiers légers B26 de la Sénia mitraillent les immeubles d'Oran : les balles de mitrailleuses traversent la fenêtre et arrachent le bras de sa sœur aînée, Andrée, éclatent la cuisse de son autre sœur Frédérique, 13 ans, qui sera amputée de la jambe, et fracassent le tibia et la rotule de sa petite-nièce, Sophie, 3 ans. Au printemps 1962, Pierre Dubiton est à son tour blessé au bras droit par une balle explosive tirée par un tireur d'élite de la gendarmerie.
En 1963, on le retrouve mercenaire au Katanga. En 1967, il est en Israël où il remplace des soldats dans les kibboutz pendant la guerre des 6 jours. En 1970, il s'installe à Marseille où il devient d'abord expert-comptable (Société d'Expertise Comptable Méridionale) puis directeur financier et vice-président de I'OM.
|
|
|
( Recette de M. André Tarento, Pâtissier à La Calle )
Ingrédients :
1 kg de farine.
250 g de beurre.
5 oeufs frais.
1 sachet de sucre vanillé.
1 sachet de levure alsacienne.
Zeste de 1 orange + 1 citron.
2 cuillerées à soupe de rhum.
Sirop avec : 250 g de sucre fin + le jus d'1/2 citron.
Préparation des Angelinettes :
Mélangez : 1 kg de farine + 5 oeufs frais battus en omelette + 250 g de beurre ramolli + 1 sachet de sucre vanillé + 1 sachet de levure alsacienne + zeste de 1 citron et 1 orange + 2 cuillerées à soupe de rhum.
Pétrir la pâte avec très peu d'eau tiède.
Façonnez les Angelinettes en forme de billes agate.
Mettre dans un plat huilé.
Dorez à l’œuf.
Cuire doucement au four 25 à 30' environ.
Répartir sur les Angelinettes dés la sortie du four, un sirop fait de la façon suivante : 250 g de sucre fin + 1 verre d'eau - portez à ébullition à feu très doux et ajoutez le jus d'un 1/2 citron - tournez le mélange à la cuillère de bois, puis, retirez du feu et aspergez les Angelinettes.
Conseils culinaires :
- Petits gâteaux traditionnels de la Nativité.
- Délicieux pour les desserts et le petit déjeuner : faites-les au moins une fois, je vous assure que vous ne serez pas déçus !
Jean-Claude PUGLISI
- de La Calle Bastion de France.
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Giens en presqu’île - HYERES ( Var )
|
|
|
|
LE MUTILE du N°45, 3 février 1918
|
LA GUERRE ET LES MERES
Les pleurs sont, à la mère source de joie ou de douleur : les premiers humectent l'enfant à sa naissance et l'auréolent des divines souffrances de la maternité ; les autres, les ultimes larmes de la séparation, inondent le visage de l'être chéri qui n'est plus et qui emporte dans l'au-delà tous les espoirs que sa créatrice avait fondés en lui.
A. J.
Si la guerre, comme la mort du reste, a des rigueurs à nulle autres pareilles, l'Etat en a de bien attristantes, aussi il ordonne la levée en masse de tous les citoyens valides pour concourir à la sauvegarde de la Mère Patrie en méconnaissant le sacrifice de quantités de mères françaises qui donnent, sans récrimination, en holocauste, la chair de leur chair, le fruit de leurs entrailles.
Loin de nous la pensée de dresser devant la maternité grandiose quoique immatérielle de la Patrie, la maternité réelle de la femme.
L'une est faite de notre idéal, de notre conception cervicale. Elle est pour nous un symbole, l'autre est oeuvre de la nature et nous attache instinctivement, dès la plus tendre enfance, de liens si doux qu'ils survivent à la mère si bien qu'il n'est aucun être conscient qui n'invoque sa mère au milieu du danger, de la douleur ou au moment d'entrer dans l'éternité.
Nous avons dit que l'Etat méconnaissait les mères, pas toutes du moins, puisque les mères veuves de guerre sont pensionnées, mais du moins une certaine catégorie d'entre elles, nous voulons parler de celles qui ont donné à la Patrie leurs fils célibataires et qui les ont perdus à jamais.
L'Etat n'a pas admis, ou du moins ne paraît pas admettre que les mères ont consenti d'énormes sacrifices pour élever leurs enfants.
Il les leur prend, mais ne leur donne rien, ou si peu que vraiment leurs pensions ne grèveront que très peu le budget, car elles n'y figureront qu'autant qu'elles auront atteint cinquante-cinq ans.
Dans la vie normale, en pleine période de paix, l'Etat est autrement soucieux des droits de la mère. Il oblige les enfants à lui servir une pension alimentaire et accorde même à la mère le bénéfice de l'assistance judiciaire pour faire valoir ses droits quand ses enfants font preuve d'ingratitude.
La mère peut-elle en période de guerre exiger des même droits pour assigner le gouvernement dont les décisions la lèsent ?
Non pas, puisque le gouvernement étant le maître suprême, couvert par une loi, ne saurait accorder satisfaction aux récriminations des plaignantes. D'où l'obligation pour elles de se taire et d'essayer de vivre la vie qu'une loi ingrate leur crée.
Le code civil de Napoléon, actuellement encore en vigueur, donne à la mère l'hérédité d'une partie de la pension administrative de son enfant, a litre d'ascendante directe. La législation actuelle, si elle en tolère la validité en matière civile, la supprime"complètement, en matière militaire, à moins que le militaire défunt n'ait fait au profil de sa mère une délégation de demi-solde, comme son épouse en aurait bénéficié s'il avait été marié.
Ainsi, pour que la mère puisse régulièrement toucher la pension afférente au grade de son fils, il faut que celui-ci, avant d'aller au combat d'où l'on ne revient pas toujours, ait pris la sage précaution de déléguer sa solde à sa mère par un écrit dont il doit être porteur ; s'il n'a pas pris cette sage précaution, bernique, la mère n'a droit à rien.
On conçoit aisément le ridicule de cette manière de faire qui consiste uniquement à ne prendre d'une main ce que l'on donne de l'autre. Est-il admissible que tous les combattants aillent au front avec celte idée qu'ils n'en reviendront pas ? S'il en était ainsi, nous n'aurions pas ce superbe allant do nos troupes qui se rient des dangers parce qu'elles savent qu'on en revient ... pour recommencer.
Et puis, comment fera-t-on pour retrouver ce legs, quand le corps aura été mis en lambeaux par un crapouillot ?
C'est là un de ces à côtés navrants qui nuisent toujours aux avantages d'une loi.
Celle-ci, on lui donne le plus de publicité possible comme pour mieux dissimuler les exceptions qui en découlent, telle la fanfare tintammaresque du dentiste charlatan de foire qui couvre les hurlements-du patient à qui on extrait une dent, au nom de l'axiome populaire : «L'opération est sans douleur pour l'opérateur».
Nous avons par habitude de ne récriminer qu'autant que nous possédons la preuve de ce que nous disons. Cette preuve nous la donnons à nos lecteurs dans toute sa triste et lamentable simplicité :
Madame veuve Martin, épouse en son vivant de M. Martin Emile, docteur en médecine, et veuve en premières noces de M. Fayaud, avait un fils pour l'instruction duquel elle avait sacrifié sa petite fortune.
L'enfant doué d'une intelligence peu commune, bien que d'un état de santé inquiétant, il parcourut rapidement le cycle des études secondaires et il était médecin de colonisation au moment de la mobilisation.
Reconnu bon au service armé par le Conseil de révision d'Alger, dans sa séance du 16 novembre 1914, il fut affecté au 1er régiment de Zouaves le 9 décembre 1914 comme zouave de 2° classe et nommé médecin auxiliaire au corps le 10 décembre 1914.
Le 8 avril 1915 une nouvelle nomination le consacrait médecin aide major de 2° classe, et l'affectait à Méchérin.
II occupa ensuite et successivement les postes suivants : Portbassa, Méridja, Béni-Ounif, Aïn-Sefra, et partit enfin avec la 2° compagnie du 8° bataillon territorial de zouaves le 25 janvier 1916 à destination de l'Orient d'où il ne devait pas revenir. Surpris en effet par une avalanche de neige, pendant qu'il faisait son devoir, il fut sorti de là transi et contracta une maladie qui l'emporta le 14 février 1917 à l'ambulance 6-17, à Kozani (Armée d'Orient).
Instruite de l'épouvantable malheur qui la frappaient la personne de son unique enfant bien aimé, la mère, privée de cet unique soutien, écrivit au Ministre de la guerre en sollicitant la délégation d'office de la demi-solde de son fils, mort d'une maladie contractée en service el fut péniblement affectée en apprenant le 27 mai 1917, par l'intermédiaire de M. le Général Moinier, que le Ministre de la Guerre n'avait pas cru devoir accueillir favorablement sa demande, et. lui en exprimait tous ses regrets.
Ce laconisme excluait toute explication et Madame veuve Martin, désolée, crut devoir en référer à M. le Maire de la ville d'Alger qui la recommanda au Général commandant le 19° corps d'armée.
A la date du 15 septembre dernier, celui-ci lui faisait, savoir qu'elle devait adresser une demande de secours immédiat au Général commandant la subdivision d'Alger, ajoutant, qu'elle pourrait en nuire obtenir un emploi dans les bureaux militaires de la place, soit comme rédactrice, soit comme secrétaire copiste en adressant au préalable une demande au Commandant du bureau de Recrutement qui lui ferait connaître les conditions à remplir.
Celle mère-infortunée a. reçu du 8° régiment de Tirailleurs indigènes auquel appartenait son fils, un secours de 300 francs dit « de deuil».
Quant à l'emploi administratif, elle ne l'a point sollicité parce qu'elle appartient à la catégorie des mères dont les enfants sont « morts pour la France» et qui, à 57 ans, ayant les yeux brûlés par les larmes, ne peuvent plus exercer convenablement un emploi de copiste ou rédactrice.
Toutes les mères ne sont pas obligées d'être lettrées et si certaines d'entre elles le sont, que fera-t-on de celles qui ne le sont pas ?
Et puis, comment qualifier celte manière de faire qui consiste à dire à une mère : « Votre fils qui était votre unique soutien est mort à notre service mais pour que vous ne souffriez pas trop de cette «perte, nous vous offrons du travail, si toutefois vous êtes en état de le faire.» C'est là un dédommagement qui est plutôt une ironie ou alors la langue française est un vain mot.
Ce que nous voudrions pouvoir lire dans la loi nouvelle modifiant les pensions, ce serait un article en créant une au profit des mères dont les soutiens sont morts au champ d'honneur.
Il ne faut pas oublier que c'est à l'abnégation sublime de ces admirables femmes, à l'éducation qu'elles ont donné à leur fils, que tant d'héroïsmes se sont révélés depuis 1914, il faut se rappeler surtout que les mères sont le creuset où se fondent les énergies nationales et consacrer leur mérite par des lois attentionnées.
Jetez tant qu'il vous plaira, des fleurs, même de rhétorique, sur les tombes de nos héros, mais au moins n'abandonnez pas leurs mères.
René FRANCE,
Mutilé, n°1, décoré de la croix de guerre,
étudiant en médecine.
|
|
11 novembre 1940
Envoyé par A. Hamelin
|
Des gamins défient les « Boches »
pour honorer les poilus
https://www.bvoltaire.fr/11-novembre-1940-des-gamins-defient-les-boches-pour-honorer-les-poilus/
Méconnu, l’hommage de lycéens et étudiants au Soldat inconnu dans un Paris truffé de soldats allemands en 1940.
Plusieurs milliers d’adolescents et de tout jeunes adultes battant le pavé parisien, narguant la Wehrmacht, quelques mois après son arrivée dans la capitale : l’histoire rocambolesque, digne de La Grande Vadrouille, mériterait d’être mieux connue. Dans l'ouvrage de référence Des royalistes dans la Résistance (Éditions Flammarion), l’historien François-Marin Fleutot lui a consacré un chapitre. Pour BV, il évoque cette épopée qui en dit long sur une époque si souvent caricaturée depuis.
Hommages et bagarres toute la journée
Nous sommes le 11 novembre au matin, avant l’aube. « Vers cinq heures trente, les gaullistes ouvrent le bal, nous explique François-Marin Fleutot. Deux jeunes émissaires venus de Londres viennent déposer au pied de la statue de Georges Clemenceau, en bas des Champs-Élysées, une gerbe de fleurs enrubannée au nom de « La France libre » ainsi qu’une carte de visite géante au nom de Charles de Gaulle ». À partir de neuf heures, une foule de plus en plus nombreuse de Parisiens, cocarde bricolée au revers, envahit les alentours de la place de l’Étoile. « L’armistice avaient été signé vers dix heures trente et les Parisiens sont donc venus spontanément. » Mais dès dix heures, un premier incident éclate. Des soldats allemands sont à proximité de l’Arc de Triomphe et l’un d’entre eux a alors le mauvais goût de garer son vélo contre un pilier du monument. « Des lycéens présents déclarent que cela était « insultant pour l’honneur de la France » et éloignent la bicyclette, nous raconte François-Marin Fleutot. Mais son propriétaire et plusieurs autres soldats, furieux, se jettent sur les lycéens en leur ordonnant de remettre le véhicule à sa place. Refus, bagarre, coups de feu des Allemands. En l’air, mais pas tous, puisqu’un passant prend une balle et s’écroule, blessé. » Des premières arrestations ont alors lieu. La journée ne fait que commencer. Dans les heures qui suivent, les Parisiens continuent d’affluer et « la police française se contente d’empêcher les regroupements, afin de ne pas risquer d’incidents graves avec les Allemands, poursuit François-Marin Fleutot. Ils demandaient aux gens de se disperser, en se chargeant alors d’aller déposer les bouquets que ceux-ci avaient apportés. »
Les étudiants royalistes à la manœuvre
Méfiant, le gouvernement de Vichy avait adressé, dès le 8 novembre, des consignes pour le 11 aux responsables de l’instruction publique. « Le travail ne doit pas être interrompu et les commémorations devant les monuments aux morts de chaque établissement faites en présence des seuls professeurs. »
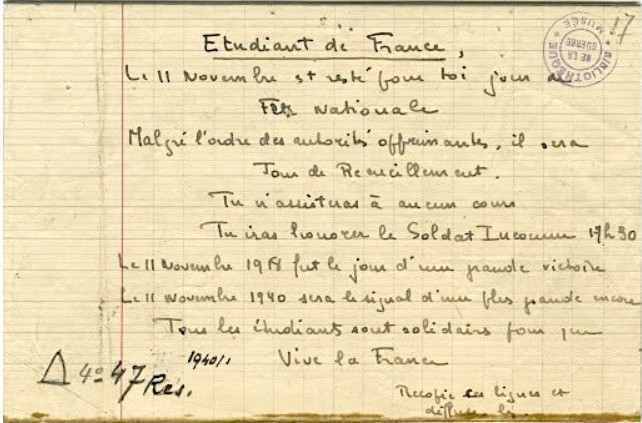
Mais commencent alors à circuler, dans les lycées et universités, des tracts, pour certains manuscrits, appelant à venir rendre hommage aux héros de 14-18, le 11 novembre à dix-sept heures trente à l’Étoile. Des appels similaires ont eu lieu dans d’autres grandes villes. Lycéens et étudiants peuvent y lire que « le 11 novembre est resté pour toi un jour de fête nationale et malgré l’ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n’assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le Soldat inconnu. »
L'un des tracts anonymes, probablement écrit par les royalistes de la corpo droit, donnant rendez-vous place de l'Étoile. Document creative commons.
On sait aujourd’hui que « ces appels émanaient de la Corpo droit, alors très majoritairement composée de royalistes et dirigée par des étudiants d’Action française, André Pertuzio et son second, Jean Ebstein-Langevin » (qui deviendra, ensuite, un cadre de la Résistance). Mais il est difficile de savoir combien de lycéens et étudiants ont répondu à leur appel. La fourchette va de cinq mille à quinze mille. Et le 11, « si les royalistes sont en nombre, d’autres patriotes sont aussi présents, et même des jeunes de gauche, répondant à l’appel de l’UNEF, dont le vice-président, François Lescure, est présent lui aussi ce soir-là », précise François-Marin Fleutot.
Blessures et arrestations
Là encore, la police française tente d’empêcher les attroupements, mais ne disperse pas la foule. « Ces jeunes étaient beaucoup plus « joueurs » que les aînés qui les avaient précédés durant la journée. » L’hommage tourne alors à la franche « manif » et, débordées, « les autorités allemandes font alors appel à des civils de leurs services de renseignement pour appuyer leurs militaires et disperser les jeunes Français ». Très vite, les tirs en l’air succèdent aux bousculades, et les premières arrestations ont lieu. « C’est violent, car les lycéens et étudiants ne sont pas disposés à se laisser faire. Des bagarres éclatent, faisant des blessés. » Les rapports de police de l’époque font état de 155 jeunes incarcérés à la prison de la Santé, dont 19 étudiants et 93 lycéens. Nombre d'entre eux sont libérés assez rapidement, mais plusieurs cas de violences et même de tortures par les autorités allemandes ont été signalés, et certains manifestants n’ont été libérés qu’après plusieurs mois. Censure oblige, les journaux ne relatent pas l’événement sur le moment, à part la presse collaborationniste, pour condamner ses auteurs. Mais Radio Londres en parle dès le vingt-neuf.
Une journée de patriotisme et de bravoure
Si le rendez-vous du soir de la Corpo droit a été pensé et organisé, en l’occurrence par des jeunes royalistes d’Action française, pendant tout le reste de la journée, des milliers de personnes sont venues spontanément. »
 La plaque commémorative du 11 novembre 1940, posée en haut des Champs-Élysées et inaugurée en 1954 par René Coty. Photo Creative commons.
La plaque commémorative du 11 novembre 1940, posée en haut des Champs-Élysées et inaugurée en 1954 par René Coty. Photo Creative commons.
Pour François-Marin Fleutot, il est important de retenir que « cette journée a finalement rassemblé des Français de tous bords politiques ». En cette année 1940, dont on dit qu’elle symbolise une forme d’acceptation résignée, voire de lâcheté, « ce onze novembre a témoigné, au contraire, d’un réflexe patriotique », analyse-t-il. Et, pour des milliers de jeunes, de courage, voire de bravoure.
Etienne Lombard, 10 novembre 2025
|
Algérie catholique N° 10, octobre 1937
Bibliothéque Gallica
|
Pensionnat de la Sainte Enfance
Les touristes qui visitent Alger ne manquent presque jamais de monter à Kouba. On leur a vanté la beauté grandiose et la merveilleuse situation du Grand Séminaire : il faut y aller ; il faut emporter sur la prunelle de ses yeux l'image de ce splendide édifice. On y monte ; on admire ; on s'extasie et on redescend vers la ville.
 Combien d'Algérois agissent comme ces simples touristes sans se douter qu'au-delà du Séminaire et de l'Eglise située à moitié chemin vers Vieux-Kouba, se trouve une maison des Filles de la Charité, qui est sans contredit une des plus anciennes de la vaste agglomération koubaine. Combien d'Algérois agissent comme ces simples touristes sans se douter qu'au-delà du Séminaire et de l'Eglise située à moitié chemin vers Vieux-Kouba, se trouve une maison des Filles de la Charité, qui est sans contredit une des plus anciennes de la vaste agglomération koubaine.
Au temps où il n'y avait encore que de rares fermes éparses, les Sœurs du Bon Saint Vincent, fidèles à la tradition de leur Père. prévoyantes et maternelles, avaient discerné ce plateau de Kouba, d'entre tous les autres sites environnants, comme un des plus sains, des mieux aérés, des plus favorables à l'éducation de la jeunesse. Elles y fondèrent donc l'Etablissement de la Sainte-enfance.
Et certes elles n'eurent pu mieux choisir. Le site est des plus agréables : d'une part la vue d'étend largement sur Kouba Alger et sa baie magnifique, et de l'autre, l'immense plaine de la Mitidja déroule à l'infini ses tapis d'or et de verdure. Quelle vue reposante : des fleurs partout, et des vignes, et des palmiers, et des arbres de toutes sortes Et quelle température idéale ! De douces brises apportent les parfums des champs et la fraîcheur de la mer. Le soleil, qui, en d'autres lieux, tombe et brûle avec une si impitoyable cruauté, caresse le plateau où s'érige la Sainte-Enfance avec une clémence maternelle.
 Il sait en effet que les Sœurs y accueillent des enfants, êtres faibles et délicats, en qui il faut infuser un sang vif, une robuste santé, une vie forte et énergique. Et voilà pourquoi il veut bien, en août, émousser l'acuité de ses traits, et en décembre, atténuer par une douce chaleur les rigueurs de l'hiver. On comprend que les enfants qui vont, là-haut, commencer leur éducation, prennent assez vite goût aux études. Dans un cadre si beau, dans un site si salubre, dans un milieu excellent où les Sœurs de Saint Vincent font régner tant de gaîté, de joie et de vie familiale, il est impossible que les cœurs ne s'ouvrent bientôt à la bonté, les esprits à la science et les âmes à la beauté, à l'ordre et à l'harmonie. Il sait en effet que les Sœurs y accueillent des enfants, êtres faibles et délicats, en qui il faut infuser un sang vif, une robuste santé, une vie forte et énergique. Et voilà pourquoi il veut bien, en août, émousser l'acuité de ses traits, et en décembre, atténuer par une douce chaleur les rigueurs de l'hiver. On comprend que les enfants qui vont, là-haut, commencer leur éducation, prennent assez vite goût aux études. Dans un cadre si beau, dans un site si salubre, dans un milieu excellent où les Sœurs de Saint Vincent font régner tant de gaîté, de joie et de vie familiale, il est impossible que les cœurs ne s'ouvrent bientôt à la bonté, les esprits à la science et les âmes à la beauté, à l'ordre et à l'harmonie.
J'ai voulu voir, constater ce mes yeux, Mes déductions se sont trouvées exactes. Toutes ces petites filles que je rencontrais étaient pleines d'entrain, de gentillesse et de cordialité. Leurs figures rayonnaient de santé et leur front de bonne humeur.
«Eh bien, mon enfant, dis-je à l'une d'elles, es-tu contente ici ? ».
«Oh, oui, Monsieur, me répondit-elle, très contente. Nous ne manquons de rien ; les bonnes Sœurs nous soignent à merveille ; il fait tout le temps très bon et, les nuits, on dort comme des anges parce qu'il fait frais et tranquille.»
J'admirai la sagesse des Filles de Monsieur Vincent, qui toujours pratiques, toujours modernes, toujours adaptées aux besoins les plus divers de leur époque, savent pour les enfants qui se confient à elles, choisir les endroits les plus favorables à l'épanouissement de leur santé physique et de leur beauté morale. Et je pensais au poète qui avait rêvé d'une maison : humble et pourtant agréable, lumineuse et pourtant largement ombragée, tranquille et pourtant remplie de cris joyeux, à la campagne et pourtant pas très éloignée des commodités de la ville.
Je ne sais si le rêve du poète se réalisa. Mais je sais que si j'étais une petite fille et un peu poète j'aimerais vivre à la Sainte-Enfance de Kouba.
|
|
LE REVEILLON DE P’TITS-YEUX
Bonjour, N° 13, janvier 1933
journal satyrique bônois.
|
|
Ptits-yeux a fait le réveillon, lui aussi, et pourquoi pas ?
Ses impressions ne devaient pas être celles de tout le monde. Les voici :
Cà, oui ! Une madone de Noël, tout afogué. Je suis.
Avec Fanfan, n'zavons fait la fête du p'tit Jésus, comme en s’l’appelle, taïba la sauce !
Ouala ! D'abord, lui, y m'a dit :
- Ou le vas, toi, ce soir ?
Qui y ta parlé pour qu'te fait le rivillon, personne, sûr ? A moi, non plus !
Argua-le, çuilà ! Alors, pourquoi te parles et te le lances des calembours ?
Fanfan, tout d'suite, y lui monte la moutarde dans le nez ; Alors, moi, j'y a dit :
Qu'est-ce te fais du mauvais sang ? T'y' a une quarantième dans la poche ? Cà, j'ai, moi ! Alors, qui nous touche ?
Tous les aïeux n’zallons en dessur la Place d'Armes, là oûsquon mange plein les saucisses et vinga la ventrade ! Ma, avant, n’sommes été chez Madame Joseph qui se tient le café, quelle est belle à la mort, que quand elle vous voit rentrer, les yeux bleus y lui tournent comme des billes agate à six pour un sou.
Après, pasque c'est la fête, elle paie la rince. Fanfan y s'en paie une ote, elle une ote. Et vinga les rinces à la volée que les yeux y tournent et tout y tourne avec.
- Ma, oh l Fanfan, si nous restons ici ! Sûr, la s’borgne, n’zattrapons !
A de bon, maintenant, te Vas, toi, qu'y me répond. Et pis, qui te parle à toi?Jaloux, t'y es, pasque Madame Joseph elle me regardé mieux qu'à toi. Si t'la veux, te t'l'a prend. Ma, avant, la rince te paies.,,, et n’zallons manger.
Tout le monde y se fait le rivillon et nous, non alors, et qui nous sommes, nous, personne qui nous touche et, comme les ôtres, la fête nous s'faisons.
Arga la police :
Qu'est qui a, M'sieur l’agent, nous se faisons pas du scandale et si vous voulez s'la faire avec nous, si le cœur y vous en dit ! A de bon ! c'est de bon cœur, hein ! Vous voulez pas venir ? Alors mieux que vous s'en allez, pasqu'un sac des morts, je vas vous jurer !
Amar ! apporte ici quatre saucisses, quatre briques et quatre choses des moutons ?
Akoun adak, chose di montons ?
- Arga-le, çuilà, ma d'où te viens ? Cà c'est une fatche de faux témoin, il a. Ma, comme le sais pas qu’est-ce c'est les choses des moutons, çà qu'on appelle les olives de Gastu, les rognons blancs ?
- Han ! çi çà, la chouse di montons ? Tilarbia ! y s'appille les claoui !
Allez ! va de là, otrement j'te fais la figure comme une pastèque arabe. Allez, porte tout avec le piquant, t'en veux, toi du piquant, toi, Fanfan ?
Mellah ! toi t’y en prends et moi non ! Rien qu'à toi, t'y en veux ?
- Et pourquoi, tu m'réponds tout tordu ? a de bon, t'y es fou ! Moi, j'l'as demandé çà pasque l'ot' jour quand ti as mangé du piquant te m'as dis que te l'avais payé. le lendemain et que le papier il allait prendre feu !
Alors, moi, t’sais, camarade avec toi, je suis ! Tchoutche ! et puis, mange vite et le pense plus à Madame Joseph pasque mariée elle est et c'est pas pour ta fatcha broute.
Allez, t'y as fini ? Eh ! comme te mange ! Viens, z'alIons à la messe. N'se faisons une prière à le p'tit Jésus qui nous donne de la chance en pagaille pour toute Vannée, à nous, à les petits de ta sœur la vilaine, à eux de la jolie qu'elle a pas voulu se marier ac moi, à ton frère et à toute notre race, otrement nous lui afoguons ses morts dans les meilleurs qu'il a !
Rabul.
| |
ALGER ETUDIANT
N° 27. — 5 Avril 1924. Source Gallica
|
| RABINDRANATH TAGORE
POETE HINDOU
Jadis, voilà ce que dit la légende, un vieil Hindou, homme de grande soumission et de grande croyance parcourait à pied les vastes territoires de l'Inde. On le nommait Maharshi.
Un soir, comme il cheminait prés de Bolpur, il arriva devant un immense espace nu. Tour à tour il se tourna vers le Nord, vers le Sud, vers l'Est et vers l'Ouest ; aucun obstacle n'arrêta l'essor de son regard. A cette époque il était arrivé à l’âge où le sage doit penser à la retraite, il s'assit sur un roc, ordonna à ceux qui le suivaient de le laisser seul quelques jours.... puis il médita.
Plus tard, dans ce même endroit, il fit construire une vaste maison.
Quand Maharshi mourut, il légua à son fils, ce qu'il possédait, en lui demandant de créer une « Maison d'hospitalité ». Ce fils que les dieux avaient fait bon et sensible, obéit à son père, mais voulut compléter l’œuvre entreprise, des bungalows en toit de chaume s’élevèrent autour de la demeure antique, des manguiers étalèrent leurs branches.
Ce lieu s'appelle aujourd’hui Santiniketan. Le nom du fils est Rabindranath Tagore.
Rabindranath Tagore ! Pour celui qui à détaché ses regards de l'Europe imbécile, ce nom est plus beau qu’un mirage....
Aujourd'hui, après 30 ans, Santiniketan est un merveilleux paradis où près de 300 étudiants, le cou entouré de guirlandes fleuries, viennent écouter les conseils du plus grand des poètes. Et lui devant qui les 2 mondes s'inclinent, lui, l'Homère moderne au milieu des enfants qu'il aime, psalmodie lentement en bengali quelque poème. Partout, dans ce petit univers il fait pur et bleu, les femmes ont un visage limpide.... Parfois, on voit passer, dans la rue, de beaux enfants bruns, presque nus.
Le Poète parle l'anglais mais ne comprend pas notre langue qu'il aime confusément.
Il dort dans une petite chambre aux murs hauts et blanchis à la chaux sur un lit très dur. Il travaille devant une table simple en bols blanc, assis dans un grand fauteuil carré devant l'immensité.
Là, règne un éternel printemps. A vrai dire pendant le jour il fait bien un peu chaud, mais à midi le Poète va dîner chez ses hôtes et sa parole est une onde bienfaisante.
Il cause de son pays qu'il aime, et qu'il sert de son mieux. Cet esprit universel est un homme de progrès, qui ne partage pas les idées de Gandhi, dont il a cependant l'idéal, le désintéressement et la beauté d’âme.
Ce fils de « Brahme » voudrait que « dans une Inde libre la plus nombreuse partir de la population ne soit plus pour l'autre un objet d'horreur et de mépris ».
Dans l'ovale parfait que délimitent les cheveux gris et la barbe longue et soyeuse, le sourire. rayonne doucement empli d'un délicieux espoir. Le pont immense n'a pas de ride... Rabindranath est bien le descendant des Mages. Drapé dans des voiles amples, quand il a visité votre monde il eut devant nos génies de bazar en habit noir et col cassé, un sourire douloureux.
Je voudrais vous faire aimer son œuvre. Au hasard, j'entrouvre la « fugitive » et je lis ;
J'ai désiré tracer les mots de l'Amour dans leur propre couleur ; mais comme ils se cachent au fond de mon être et comme nos larmes sont pâles !
Les reconnaîtras-tu, mon amie, ces mots sans couleur ?
J’ai désiré dire les mots de l'amour dans leur propre musique, mais cette musique ne résonne que dans mon cœur et mes yeux sont charges de silence.
Les reconnaîtras-tu, mon amie, ces mots sans musique.
N'y a-t-il pas là quelque chose de lumineusement beau et ce n'est pourtant que la traduction d'une traduction.
La « Nouvelle Revue Française », à l'avant garde de la pensée humaine a ce pendant confié aux meilleurs parmi les meilleurs le soin de faire connaître en France le poète Hindou : Renée de Brimont, Andrée Gide. L'effort de ces ardeurs à rendre comme ils comprenaient, a abouti à un douloureux résultat. On devine bien vite que le même homme a traduit l'« Offrande Lyrique » et écrit « Les Nourritures Terrestres ».
Pierre Jean, Jouve a publié dans « Europe » trois poèmes du « Cygne » qu'il a aidé en cela par Kadidâs Ney, traduit directement du bengali.
Celle version, plus prés du texte original se rapproche du poème tel qu'il jaillit du cœur du Poète. Je citerai quelques vers, dans lesquels on devine le cri d'impuissance devant le malheur d'être seul à sentir et de ne pas savoir faire comprendre aux autres la beauté de cet infini que l'on conçoit trop vaguement.
Ce que j'ai fait l'effort d'exprimer, et n'ai pas encore exprimé, voici :
J'ai peint le monde de l'éternité
Sur l'humble toile des moments,
Je l'ai vu et médité de mille manières,
Unie éternelle reconnaissance de l'inconnu est tombé en moi.
Et m`a naturellement comblé.
Mais je n'ai pas encore trouvé la largue naturelle
Pour exprimer.
Cela est plus vibrant, plus clair, plus personnel.
Pierre Jean Jouve a le droit de donner comme titre à son audace Tagore Inconnu.
Le temps coule doucement et frôle les berges tranquilles. Le Mage dans ses instants de loisir donne à la vieille Europe de quoi désoler bien des stériles veillées. Tandis qu'il chante ses poèmes auprès d'enfants bruns qui seront les ouvriers de l'Inde de demain.
Je veux vous lire une dernière fois :
Je ne réclame nul salaire pour les airs que je vous ai chantés. Je serai satisfait s'ils me vivent qu'une nuit durant et disparaissent dés l'aube comme les étoiles, l’obéissant troupeau qu’une bergère effrayée préserve du soleil.
Le plus beau des salaires : l'admiration du monde ne te l'a-t-elle pas offert, O Poète, et si ton chant doit disparaitre à l’aube. - Quel éblouissant soleil sommes-nous appelé à voir s'élever dans l'azur?
Malaterre Pierre.
Les renseignements sur la vie du poète sont empruntés D. Sylvain Lévi.
|
|
Le départ des Espagnols : Oran, le 30 juin 1962
LE GENERAL FRANCO ET LES PIEDS-NOIRS
ACEP-ENSEMBLE N°305, septembre 2017
|
Les péripéties de ce départ sont peu connues et pourtant on frôla l'incident international.
Le consulat général d'Espagne à Oran avait prévu un rapatriement direct sur la péninsule, et la communauté de ce pays avait été prévenue de ce possible départ.
Aussi, la dernière semaine de juin 1962, les Espagnols résidant dans les villages de la province d'Oran firent route sur la capitale en convois protégés, avec leurs voitures chargées au maximum, camionnettes et camions bourrés de ballots, de caisses, de meubles, de petites machines agricoles, etc., bref, tout ce qui pouvait être emporté sans pourtant avoir la certitude de parvenir à I'embarquer.
D'autres, partis individuellement, n'arriveront jamais, car ils auront été arrêtés sur les routes, détroussés, voire égorgés par des bandes " incontrôlées " qui faisaient déjà régner leur loi à I'intérieur des terres.
La, il n'y a pas d'eau, pas de buvette, et il faut se déplacer vers les zones d'embarquement déjà surpeuplées, afin de s’approvisionner au minimum ou bien aller jusqu'au vieux quartier de la Marine pour obtenir certains aliments, surtout pour les plus petits.
Une véritable entraide s'établit immédiatement entre tous, mais un profond sentiment d'inquiétude s'amorce aussi, pour ne pas dire de la peur, sur ce que I'avenir peut réserver.
Tous ont préparé une valise par personne au cas où les autorités les empêcheraient d'emporter tous leurs autres biens, les obligeant alors à abandonner tout le reste sur les quais du port ou les véhicules se comptent déjà par centaines. Et cela sera perdu à tout jamais.
Aux arrivants s'ajoutent leurs compatriotes de la ville et bientôt près de 3.000 personnes s'agglutinent près de I'usine thermique du port d'Oran, sur des terrains vagues vite transformés en véritable camp de réfugiés où l'on dort dans les voitures où à même le sol, les couvertures servant de parasol, vu la chaleur du mois de juin.
Dans un climat aussi tendu, on craint la non-venue des bateaux espagnols et de se retrouver ainsi à la date fatidique du premier juillet sur le port, livrés sans aucune protection à la merci des bandes de vandales qui déferleront sûrement sur la ville. C'est angoissant et on craint le pire à la veille de cette indépendance qui fait trembler..
Les 29/30 juin 1962, l'Espagne du général Franco vient au secours des pieds-noirs en affrétant 2 Ferrys :
- Le Victoria,
- Le Virgen d'africa,
Pour accoster le long des quais d'Oran il aura fallu longuement parlementer avec les autorités françaises réticentes et même donner à la France un ultimatum, risquant un grave incident international.
Le 30 à 10 h du matin, malgré l'opposition de de Gaulle, le général franco donne l'ordre à ses capitaines à embarquer les pieds-noirs, faisant fi de la pression imposée par la France, Franco prévint de Gaulle qu'il était prêt à I'affrontement militaire pour sauver ses pieds-noirs abandonnés sur les quais d'Oran et livrés à la barbarie du FLN.
De Gaulle est également informé que l'aviation et la marine de guerre espagnole sont en route jusqu'aux eaux internationales, face à Oran, face à la détermination du général Franco, la France cède le samedi 30 à juin, ses 2 bateaux espagnols ont pu embarquer 3200 pieds-noirs, 85 voitures et un camion.
Lors de l'embarquement, les courageux capitaines espagnols durent s’opposer à la montée d'une compagnie de CRS sur leurs bateaux (propriété espagnole), des CRS qui voulaient lister tous les pieds-noirs embarqués à destination de I'Espagne.
Les capitaines espagnols avouèrent n'avait pas compris I'attitude arrogante des autorités françaises dans une situation aussi dramatique, contre vents et marées politiques, finalement à 15 h 30, les quais d'Oran, noirs de monde se vidèrent.
Les bateaux espagnols prirent enfin la mer malgré une importante surcharge.
De l'arrivée jusqu'au départ des ferrys espagnols une liesse, joie et larmes, s'étaient emparées des pieds-noirs aux cris de «viva espana» et « viva franco »
Mardi 26 juin
La nouvelle a couru comme une traînée de poudre : les navires arrivent, en effet, en fin de journée.
Du boulevard Front de Mer on peut les apercevoir, immobiles au large, en eaux internationales où ils doivent attendre I'autorisation d'entrer au port. Dès lors, l'ambiance a viré de bord : la peur se transforme en espoir. Mais ce sera, hélas, pour bien peu de temps,
Mercredi 27 juin
Les deux bateaux, le « Victoria » et le « Virgen de Africa », en provenance des Baléares et frétés par l'Etat espagnol, demeurent toujours ancrés au large. Les deux bâtiments étaient placés sous le commandement respectif des capitaines Alejandro Sanchez Blasco et Joaquim Vilanueava lorsqu'ils lorsqu’ils reçurent la mission de rapatrier les ressortissants espagnols d'Oran. Les deux navires partirent des Baléares le 26 juin pour se diriger vers Oran.
Là-bas le 30 juin, ils embarquèrent 3.200 réfugiés, ainsi que 85 automobiles et un camion.
Mais que se passe-t-il donc ?
Eh bien les autorités françaises, sur ordre de Paris, refusent l'accès aux deux navires ! La France avait déjà rejeté les aides américaines, italienne, grecque et espagnole pour faciliter l'évacuation, mais là, l'Exécutif français est intransigeant : « pas de panique », la France estime pouvoir assurer toute seule ces départs de « vacanciers » (sic), et il ne faut surtout pas donner l’impression d'une fuite généralisée, d'un sauve-qui peut face à la peur à cause d'une politique qui, en vérité, ne garantit plus rien.
C'est l'échec total des fameux, c'est l'échec absolu des prévisions de l'Homme « providentiel » qui a fini par agir en démolisseur de l'Empire Français.
Pendant ce temps, toutes les démarches du consulat, ainsi que du ministre espagnol des Affaires Etrangères, sont vaines.
Il leur est répondu qu'aucun navire étranger ne pénètrera dans un port d'Algérie pour embarquer des « réfugiés «.
Jeudi 28 juin
Les bateaux espagnols, toujours à l'horizon depuis trois jours, demandent la permission d'envoyer un canot afin de ramener du ravitaillement pour des équipages venus simplement pour un aller-retour immédiat, vu la pénurie de vivres survenue à bord. Celle-ci est accordée, et le canot reviendra du port avec I'aide essentielle du consulat pour ce maintien en eaux internationales.
Entre-temps, le moral des réfugiés sur les quais est au plus bas, l'espoir faisant place au découragement.
Toutes ces familles n'arrivent pas à comprendre ce refus aussi incohérent qu'inhumain, puisque ce départ pour l'Espagne ne peut en rien gêner la politique de la France.
Vendredi 29 juin
La France vient de refuser à nouveau l'entrée des bateaux au ministre espagnol des Affaires Etrangères qui, à son tour, transmet à son gouvernement la position de Paris, tout en soulignant le danger que peuvent encourir ses milliers de personnes dépourvues de toute garantie de sécurité. Face à cet état de faire, Madrid décide l'envoi immédiat d'une protection pour ses ressortissants, sachant que dès le 30 juin à minuit, la France n'assumera plus l'ordre et renoncera à son autorité sur tout l'ensemble du territoire algérien.
C'est ainsi que deux navires de guerre partent ce même jour du port militaire de Carthagène, cap sur Oran (1), tandis qu'en même temps branle-bas de combat est déclenché dans les bases aériennes de San Javier (Murcie) et d'Albacète, Des appareils sont armes et prêts à décoller pour appuyer la Marine si nécessaire.
Samedi 30 juin
A Paris, le gouvernement est déjà informé de l'arrivée des navires de guerre espagnols en eaux internationales, en face d'Oran, ainsi que l'alerte donnée aux forces aériennes espagnoles. Il y a risque de créer un gave incident le 1er juillet, compte tenu de la détermination du chef de I'Etat espagnol d'alors, le général Franco, d'aller si nécessaire à une intervention militaire afin d'évacuer ses ressortissants.
A 10 h du matin, le permis d'accoster est enfin accordé (peut-être après avoir consulté les autorités algériennes 7). Les deux bateaux de passagers s'approchent, et c'est la joie, presque la liesse, qui éclate dans le « campement de réfugiés ».
A 15 h, les deux navires sont enfin à quai. Ce sont des « kangourous « qui font habituellement le trajet Barcelone - Palma de Majorque. Ainsi, le « Virgen de Africa « et le « Victoria « pourront embarquer les voitures, et sans limite de bagages. Après cette semaine de mauvaises nouvelles, un autre monde s'ouvre devant nous, I’embarquement commence donc, mais il faut encore subir les fouilles des bagages par les bons soins d'une compagnie de CRS, et si ces bateaux doivent se diriger sur l'Espagne, personne ne comprend ce qu'ils peuvent bien chercher avec autant de zele.
15h30. Tout le monde est déjà monté à bord, c'est-à-dire 2.200 passagers, 85 automobiles et un camion. Ainsi, avec une importante surcharge par navire, les quais sont désormais restés vides. Cependant, tout ne semble pas terminé.
En effet, un officier des CRS et deux unités tentent de monter à bord du «Victoria », mais le capitaine Sanchez BIasco, en haut de la passerelle, s'y oppose résolument : Ce navire tient lieu de territoire espagnol
- affirme-t-il - et vous n'y avez aucune autorité
- ajoute-t-il. La situation est tendue, et l'officier français demande alors des instructions par radio.
Finalement les CRS se retirent. Selon eux il paraîtrait que des membres de l’OAS seraient montés à bord…
16 h. Au moment où les deux bateaux larguent enfin les amarres, un vif échange de propos s'engage entre Ies passagers et les forces de I'ordre restées à quai dont par bienséance, je ne reproduirai pas les termes ici, mais que I'on peut aisément imaginer.
Tandis que les navires atteignent leur vitesse de croisière, les scènes à bord sont sans doute semblables à celles des départs de ces derniers jours : des sanglots et des larmes, et cette dernière image de la ville au pied de Santa-Cruz s'incrustent à jamais dans nos rétines.
Dans un coin, appuyée sur la rambarde, une dame à moitie voûtée, et toute de noir vêtu à la façon des femmes de l'époque dans les villages, pleure esseulée. Je m'approche d'elle pour l'aider à passer ce mauvais moment. « Vous êtes seule, sans famille ?
Elle hoche négativement la tête.
« Vous êtes veuve ? » « Pas encore ! »
Sa réponse m'intrigue, j'insiste.
« Mon mari est resté à Dublineau. Les propriétaires sont partis. La ferme est abandonnée, mais lui n'a pas voulu partir. Il y a quarante ans, c’est lui qui a planté tous les orangers, les citronniers, et depuis nous vivions dans cette ferme. Pour lui, c’est comme ses enfants, il n'a pas voulu les abandonner. Ils vont le tuer, mais lui soutient qu'il est l’ami de tous. »
j'ai rejoint le capitaine du « Victoria » J'ai des biberons â faire chauffer, et avec gentillesse un membre de I'équipage s'en charge. Pendant ce temps, je lui montre les deux bateaux de guerre qui, depuis notre départ, nous escortent,
L'autorisation est arrivée juste à temps ! - lui, dis-je. « Oui, cela m'a ôté une grande responsabilité, car nous avions ordre d'entrer au port des le lever du jour du premier juillet, et embarquer tout ce monde sous leur protection, on ne sait jamais, cela risquait de tourner très mal.
Il était clair que Madrid avait prévu la protection de ses ressortissants, par la force si nécessaire (comme il se doit !).
Je n'ose imaginer ce qu'aurait été le 5 juillet avec tout le monde désarmé et sans aucune sécurité sur le port.
A plusieurs reprises, I'aviation espagnole nous survole. Une fois la nuit tombée, et déjà tout près d'Alicante, les lumières des escorteurs s'éloignèrent…
1er juillet
A, 2 h, les bateaux pénètrent dans le port d’Alicante.
Tous les quais sont éclairés afin de faciliter l'accostage de nuit. La ville est prise encore dans le tourbillon de ses fêtes de la Saint-Jean.
Dès notre arrivée, les membres de la Croix-Rouge montent à bord avec des boissons, des sandwiches, etc, et nous portent les bagages, tandis que les infirmiers s'occupent des enfants,
Tout a été prévu : contrôles d'identité sans tracas et aide pécuniaires immédiate si nécessaire.
Nous constatons ainsi que la ville a tout fait pour nous recevoir au mieux.
De plus, croyant bien faire en guise de bienvenue, la mairie prend soudain I'initiative d'allumer un long chapelet de pétards - une « traca » - qui fait sursauter tout le monde, tant cela rappelait les impitoyables mitrailleuses « 12.7 » et les détonations des « plastics ».
Désormais, une vie nouvelle allait commencer.
Après avoir séché ses larmes, il fallait retrousser ses manches et se préparer à souffrir car, pour beaucoup, l'avenir semblait bien noir.
Plus de cinquante ans sont passés depuis, et il me semble que c'était hier quand la bonne ville d'Alicante nous accueillait
Jo Torroja
|
|
PHOTOS BÔNE
Envois de M. Martinez Antoine
|
|
Les Noëls de chez nous
De Mme Annette BRANCHE née RICO
ACEP-ENSEMBLE N°305, septembre 2017
|
Je n'ai qu'à fermer les yeux
Pour retrouver ces souvenirs lointains et doux
Des Noëls de chez nous,
Images pleines de tendresse de ma jeunesse.
Je me souviens de ces marchands venus d'Espagne « d'Alicante »
Qui, à la mi-décembre, installaient leurs stands
Pour vendre ce turron aux amandes,
que l'on dégustait traditionnellement pour le réveillon.
Le soir de Noël quand sonnait les douze coups
Et que carillonnaient les cloches des églises,
On se rendait en famille pour assister
A la messe de minuit.
L'office terminé on se hâtait joyeusement
Vers la maison où l'on retrouvait
Cette atmosphère de fête
Chère à mon cœur d'enfant.
Sur la table, au préalablement garnie
D'une nappe blanche décorée de houx,
Le couvert étincelant des jours de fête était mis.
Dans un coin de la pièce le sapin illuminé
Brillait de mille feux et
Dans la crèche où l'enfant Jésus dormait,
l'âne et le bœuf veillaient.
La dinde farcie attendait d'être servie et dégustée,
Dans cette chaude ambiance de foi,
De ces Noëls d'autrefois.
Dès le lever du jour, mes frères et moi,
Très impatients, allions découvrir émerveillés
Les jouets que le père Noël avait déposés
Tout près de nos petits souliers remplis
De chocolats, de bonbons et fruits confits.
Souvenirs pleins de tendresse,
Lointains, si doux, des Noëls de chez nous.
Annette BRANCHE née RICO
|
|
|
Les fortifications de Bône
Envoyé par M. D. Bonocori
|
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
RESUME
Dans cet article, nous relatons l’histoire des fortifications de Bône (Aujourd’hui Annaba). Deux raisons rendent cet examen utile. Si l’enquête sur les documents d’archives conduit d’un côté, au constat de l’impact des fortifications sur la forme générale de la ville, elle dévoile d’un autre côté, l’immense foisonnement des idées du génie militaire qui en était responsable. Ce travail veut surtout souligner la capacité du génie militaire à entrer en négociation avec les autres corps d’état et surtout avec l’«administration civile ». Le regard ici suggéré tente d’éclairer cette part de la formation de Bône aussi bien comme matérialité que comme terreau d’idées.
Mots clés : Projets – Conférences – Fortifications – Bône - Structure urbaine -
I’INTRODUCTION
Cet article a pour objet de questionner la fabrication des fortifications de Bône. Ces dernières forment l’un des grands axes de l’intervention coloniale dans les villes d’Algérie. L’article qui fait suite à des travaux sur la problématique du projet colonial, intervient dans un contexte de rareté des travaux historiques sur les villes coloniales d’Algérie [1]. Au sein même du peu de travaux qui existent, Bône (Auj. Annaba) est toujours sous représentée. En plus d’avoir été une des modalités d’intervention coloniale « lourde », les fortifications ont agi comme une condition urbaine à ce qui leur a succédé.
Dans le champ de l’histoire de l’urbanisme, les fortifications sont usuellement envisagées comme frein à l’expansion des villes. Elles sont pour cette raison négativement reçues par l’urbanisme. Ceci est certes une réalité mais elle renseigne très peu de la spécificité de chaque cas. Chaque ville possède une histoire particulière, elle l’est davantage par les éléments qui organisent son espace et ses fortifications. Nous nous attachons à tenter de mettre au jour cette question pour le cas bônois.
Bône semble avoir besoin d’écrire son histoire, que ce soit dans une optique didactique posant des questionnements sur sa construction, ou en réponse à la « demande sociale » d’histoire. C’est en ce sens que Bône passerait pour être un bon observatoire. La montée des questions identitaires nécessite que les problèmes soient revisités et nécessite surtout que les réponses gagnent en précision.
L’importance que requiert cet objet est également liée à la recherche documentaire qu’il a suscitée : le seul fait de déterrer les écrits qui ont concerné les projets de fortifications représente un acquis pour l’histoire de la ville. Ecrits et projets sont loin d’être connus. Le croisement des deux est rarement mobilisé par une histoire urbaine encore « jeune ». Les fortifications ont été mises en œuvre par le génie militaire à qui on attribue souvent un esprit de domination. Il est en outre, le « fabricant » le plus visible de cet ouvrage. En revanche, les longues discussions qu’il entreprend avec d’autres instances dans ce même contexte de fortifications, nous livrent un génie plus ouvert aux débats et au compromis.
L’un des enjeux de l’article est de révéler combien la construction des fortifications de Bône a relevé de débat et de phénomènes collectifs.
Du fait de l’intérêt que nous accordons à l’idée de débat, l’argumentaire implique une attention particulière à l’égard de l’ensemble des documents qui l’illustrent. Revenir sur la trajectoire des fortifications de Bône peut avoir une portée immédiate. Deux options antinomiques se révèlent au sein du génie même et charpentent ainsi les conférences : il s’agit pour les partisans du discours défensif d’agrandir la ville le moins possible, alors que pour les tenants d’un discours expansif, Bône gagnerait à rejoindre le fond de sa petite plaine nécessitant de sérieux travaux d’assainissement.
II. HYPOTHESES, QUESTIONNEMENTS ET SOURCES
La problématique du projet colonial questionne souvent les formes urbaines produites sans vraiment regarder les jeux collectifs impliqués dans leur mise en place. Le projet qu’accompagne le discours représente pour nos recherches, un objet crucial. Projet-discours sont par cette posture envisagés comme seul document-source. De plus, les textes mobilisés renvoient aux ouvertures et potentialités des contenus des documents écrits. Le débat nait sur ces derniers.
Sur les fortifications de Bône, la matière à découvrir est très importante. Il faut toutefois en souligner le caractère composite qui, rajouté au contexte institutionnel de collecte des documents, représente une difficulté majeure dans nos démarches. Conservé au niveau du dépôt des fortifications des services historiques de la défense (SHD), le corpus mobilisé est d’une extrême étendue : cartes, plans, projets et contre-projets ; conférences, apostilles et compte rendus de délibérations …
Pour autant, ceci n’a pas empêché de mobiliser d’autres sources en complément de celles militaires : les procès verbaux des délibérations du conseil municipal tenus au même propos ; les dossiers des expropriations et les décisions ministérielles ; la revue du génie militaire et la presse locale ; le livre de René Bouyac.
Le maniement des documents cités plus haut a impliqué une attitude un peu particulière : avec la lecture fine et précise de chaque pièce, intervient une réserve à l’égard de l’historiographie de cours. Il faut remarquer que notre pratique de la critique textuelle, pour récente qu’elle soit, repose sur les principes transmis par l’école méthodique française. Nulle possibilité de critiquer le document sans sa restitution fidèle et intégrale. Il est utile de rappeler que par la restitution de la chronologie des travaux et du contenu des conférences mixtes 1, nous soulignons le caractère ouvert des débats du génie. Ceci reste de loin l’épine dorsale de ce travail. Mais encore, toutes les démarches qui assujettissent les appareils de la colonisation à des réadaptations restent un paysage à révéler.
Dans la mesure où l’opération historique est un travail de découpage des documents, elle commence par classer ces derniers selon leur pertinence et selon ce qu’ils apportent à la problématique.
Cependant, le classement n’est pas préalable à l’analyse. Il l’accompagne, grossit les détails d’un texte, scrute les éléments constitutifs d’un plan, décrypte le fait historique le moins visible au travers de celui visiblement ordinaire : le génie n’a jamais employé le terme « débat » même s’il l’a mis en pratique. L’idée de débat est le pur produit de notre lecture des documents d’archives mobilisés et représente ainsi, la part d’originalité du travail. Telle est notre pratique de l’interprétation : au-delà de la collecte de documents, il faudra classer, lire et traduire une pièce au service d’une question donnée.
Toute cette activité de traduction-interprétation a lieu dans le seul but de rendre les documents intelligibles et vérifiables.
L’inscription des fortifications dans une problématique de sécurité n’est probablement pas à confirmer, tous les discours y concordent [2]. Abordées sous l’angle des débats de la littérature urbaine, les fortifications ont pour explication quasi unique, la question de la sécurité. D’un autre côté, leur démolition est toujours interprétée comme nécessaire à l’urbanisation. Sans vouloir nier l’intérêt de ces deux moments dans la vie de chaque fortification, édification et démolition, nous voudrions interroger celles de Bône sous l’angle de leurs particularités de contexte et d’« hommes » 2 . La fabrication du territoire doit beaucoup à ces derniers et à leur vision du moment 3.
Si aujourd’hui, soit deux siècles après les aménagements en question, nous admettons que l’itinéraire de ce territoire et les péripéties de ses remodelages ont conditionné la structure de Bône, qu’en était-il au moment de leur fabrication ? Quelle correspondance entre cette vision que nous avons de la ville et les projections qu’en ont eues les ingénieurs du génie? L’urbanisme colonial est-il véritablement un urbanisme de tout pouvoir ? A-t-il usé de déni total du contexte ? De plus, l’histoire coloniale de l’Algérie est-elle réductible à une histoire de confrontation entre une France conquérante et un territoire facilement livré à l’appropriation ?
III. BÔNE : OBSERVATOIRES DE FORTIFICATIONS
Bône est devenue une place forte de second degré depuis sa conquête par les troupes françaises en 1832. L’enceinte bâtie par le génie militaire entre 1845 et 1880 4 évolua selon un itinéraire qui lui est propre mais non sans lien avec des modèles expérimentés ailleurs. Et si les fortifications de Bône sont considérées comme une catégorie d’aménagement à part, c’est en raison de l’importance qu’elles ont pris dans le processus de fabrication de la ville.
Nombre de projets leurs sont dédiés et diverses postures en font un cheval de bataille, elles intéressent surtout un domaine du génie dès les premières années de l’occupation et à ce titre, elles représentent un service à part entière 5.
Elles sont par essence, une sorte de bornage de l’espace urbain qui y est contenu. Elles l’opposent de fait au reste du territoire, lui non urbain. Avec ce territoire, la colonisation entend entreprendre des rapports de moins en moins ambigus, le contenant de façon progressive et négociée.
Bien avant les importants travaux engagés pour la restructuration et ensuite pour la croissance de Bône, ces fortifications ont du être tour à tour restaurées, remodelées, édifiées, agrandies et ont à leur tour agit sur le territoire bônois, en voie d’être déterminé et urbanisé.
L’épisode des fortifications bônoises ponctué de moments plus ou moins forts relate la recherche incessante d’accords entre les pouvoirs locaux du génie, l’administration civile et le ministère de la guerre 6. Plus intéressante encore est cette recherche d’harmonie avec la topographie locale particulière et avec une structure antérieure à l’apport colonial (Fig. 1).
Ce plan d’ensemble, tel qu’il fut intitulé, indique l’enceinte du moment (1833) et les transformations à adopter dans la ville de Bône. Il a pour base, le plan d’alignement des principales rues de Bône que signent Urtin, capitaine chef du génie et Lambert, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. Les traits de façades repris en jaune indiquent une reconstruction en projet, les immeubles étant frappés d’alignement, faisaient peau neuve.
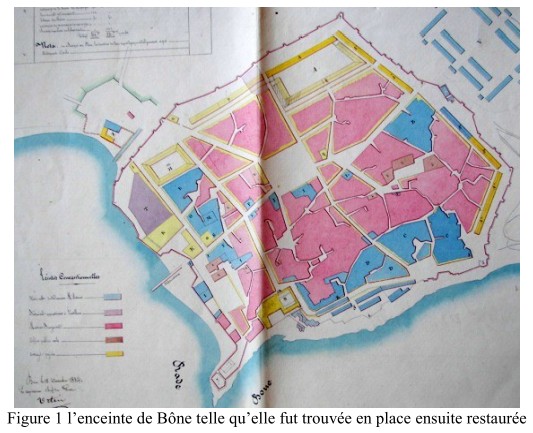 Source : 1VH 382, Archives du Shat (service historique de l’armée de terre), SHD (service historique de la défense), Vincennes, Paris, France.
Source : 1VH 382, Archives du Shat (service historique de l’armée de terre), SHD (service historique de la défense), Vincennes, Paris, France.
IV. L’HISTOIRE DES FORTIFICATIONS DE BÔNE
En dépit du foisonnement des plans, des projets et des programmes, sécuriser le territoire est restée pour des décennies la question centrale de sa colonisation.
En conséquence, toute réflexion restait subordonnée à l’avancement des travaux de fortification. Aussi, la définition des territoires concernés par l’occupation coloniale fut la toute première nécessité de cette entreprise. Maîtriser l’espace pour maîtriser les hommes, définir un territoire aujourd’hui français, voici les deux mots d’ordre des premiers moments de contact avec les villes d’Algérie [3]. Les contours et les grandes lignes de ce qui est aujourd’hui le centre de Bône ont été modelés par la colonisation. Le caractère d’« unité » qui lui est reconnu, serait probablement à expliquer par son plan des fortifications.
IV.1. LA CONQUÊTE
Dans l’apostille du chef du génie militaire apparaît pour la première fois, en 1831, l’expression de « Bône et dépendances », pour dire la ville et ses alentours. L’apostille a eu pour simple implication de souligner la délimitation des zones de servitudes rédigée d’après les dispositions de l’ordonnance du 1er Août 1831 7.
Il faudra surtout souligner que ces dispositions s’appliquent à la propriété, pour la défense de l’état. Elles nous intéressent en ce qu’elles sont appliquées aux ouvrages de défenses à établir dans le futur.
Les termes de ces dispositions sont pour rappeler deux faits importants : l’un concerne les enjeux lisibles de la défense de la place de Bône et l’autre montre des desseins d’expansion qui surgissent dès les premiers jours de l’arrivée des troupes françaises sur le terrain bônois. Il s’en suivra un projet de plan de délimitation des zones de servitudes. Ce plan a été approuvé par décision ministérielle du 23 janvier 1833.
De cette manière, sera donné le coup d’envoi d’une longue série de débats, de tractations au sein des services du génie militaire lui-même et avec la ville. Il est intéressant de rappeler combien ce même plan va continuer à servir de base pour les projets à dresser pour Bône. Remarquons surtout que dès le départ de cette colonisation, un effort est consenti pour l’adaptation des textes de lois qui de la métropole à l’Algérie sont remodelés pour la situation 8. Contrairement aux idées répandues 9 sur l’imposition systématique des modes opératoires de la métropole en terrains colonisés, l’adaptation des idées, des lois et des modalités de leurs applications, a été une des préoccupations de la colonisation. C’est du moins le cas pour le champ disciplinaire dans lequel se déploie notre réflexion.
De cette même sorte, la loi 1819 sur la délimitation des servitudes militaires fut transposée. Il est à noter combien les démarches qui jalonnent l’itinéraire des fortifications, s’inscrivent dans des temps longs : entre août 1831 et janvier 1833 pour le transfert d’un texte de loi par exemple.
Les documents édités par le service des fortifications renvoient tantôt au terme enceinte, tantôt à celui de fortifications pour souvent désigner le même objet.
Cependant, le terme de fortification nous semble plus pertinent car englobant autant l’action, l’art que l’ouvrage lui-même. Cette fluctuation dans l’usage des termes renvoie à une autre fluctuation dans les qualifications du système de défense lui-même. La distinction entre les deux termes est soulignée dans des travaux sur le domaine [4-5-6].
L’apostille du génie fait sans doute écho à la création à Alger d’une commission extraordinaire, en 1839, et qui fut chargée « des questions de sécurité du territoire […] et émet officiellement l’idée d’une muraille continue pour encercler la Mitidja » [3]. Transposé en terrain colonial, ce principe militaire de fortifier le territoire une fois devenu français, est une évidence : « pour en faire une enclave protégée au milieu d’un vaste espace ennemi » [3-4]. Mais d’un autre côté, que le mur soit fortifié ou non, il renvoie en tout état de cause, à la simple volonté de maîtriser l’espace déjà colonisé ou celui à coloniser. En 1832, le territoire bônois devenant français demandait la marque de cette emprise 10.
IV.2. ANCIENS REMPARTS
La nécessaire mise en place de fortifications dignes de défendre la ville, s’imposa car les remparts trouvés en place nécessitaient souvent des travaux de réfection. Parmi les principales préoccupations qui couvrent la longue première période de l’occupation de Bône (1832-1845) la question de la restauration des remparts arabes revenait souvent (Fig. 2). Gréban en tant que chef du Génie et Faujas en charge de plusieurs projets de restauration des remparts « prennent part à la rédaction du projet de restauration des vieux remparts », qui d’après le plan fut fait sur leur côté littoral, soutenant la falaise.
L’enceinte n’a par ce fait subi aucun changement de tracé, sauf consolidation. En plus du mur des remparts, les préoccupations liées à la défense se sont illustrés dans la reconstruction du fort Cigogne, des fronts du fort de Constantine, la construction de redoutes et le renforcement de celles en place.
Le fait de contemporanéité des questions de fortifications des deux rives de la méditerranée nous semble digne d’intérêt : si pour Paris, la déclaration d’utilité publique de la muraille de Thiers date de 1840, celle de Bône suivra une décennie après, durant laquelle les débats incessants avaient anticipé sur la déclaration par la série des expropriations jugées elles aussi, d’utilité publique.
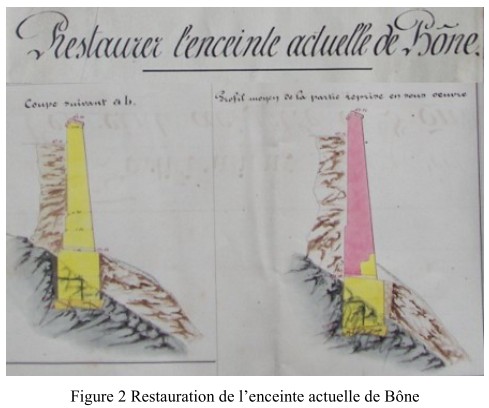 Source : 1VH 383, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Source : 1VH 383, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Combien de conférences ont du passer en revue la conjoncture géostratégique pour prescrire la mise en place de fortifications. Dressant un état des lieux des fortifications de Bône, en date du premier août 1832, le directeur des fortifications de Constantine établit un croquis auquel il joint la formule impérative : « remplacer la redoute Damrémont par une portion de la nouvelle enceinte capable de résister à une troupe européenne » 11 . Les raisons de l’insécurité tenaient tout autant à la crainte des soulèvements des populations autochtones qu’à celle de possibles attaques par la mer.
Le trait impératif des textes du génie se trouve le long des documents consultés avec les annotations : « à exécuter », « à faire », « à terminer » … Ce type de formulations impératives peut en effet facilement masquer le caractère ouvert des contenus de discours.
Du point de vue du nombre, les projets successifs de fortifications représentent la part la plus conséquente, ou du moins c’est ce que restituent les archives du Shat. Prendre la mesure des projets passerait-elle par leur nombre ? Ce nombre serait-il révélateur de l’intérêt accordé par le génie militaire aux fortifications en tant qu’acte d’édification ?
S’il est désormais admis que la domination militaire fut pénible à accomplir, en raison des mouvements de résistance et d’insurrection, « le principe même de la conquête territoriale était vigoureusement discuté avec au centre des débats, la question sur la définition des territoires à occuper […] Utile et colonisable » [3]. Utile et colonisable, voici tout à fait résumés les deux termes d’une colonisation encore incertaine. A la condition d’« espace utile et susceptible d’être défendu », répondaient les villes déjà occupées et dont l’arrière pays était prometteur de beaucoup de ressources.
Avec sa plaine, par la suite répartie en petite et grande, Bône offrait l’avantage et la disponibilité du sol argileux. Etant une ville littorale, Bône était-elle prédestinée à la colonisation ? Mais de quelle colonisation pouvait-il s’agir : agricole, portuaire ou de commandement ?
Pour le tracé des fortifications ou pour leur renforcement, l’argumentaire militaire repose en effet sur les enjeux de sécurité : rapports, plans et devis des dépenses sont ainsi mobilisés pour souligner la nécessité de fortifier. Il est intéressant de comprendre combien le texte, le chiffre et l’iconographie se mettent au service des idées du génie. La multitude des notifications qui accompagnent les plans présente l’originalité de reprendre l’essentiel du discours des conférences mixtes. Une forme de pragmatisme par le projet naissait en ces temps. La chose avant la lettre en somme.
Il est important de souligner combien le tracé des fortifications « à venir » coïncide avec celui des canaux d’assainissement de la petite plaine de Bône (Fig. 3). Avant toute idée sur la fortification, ces canaux existaient déjà par pure nécessité d’hygiène publique. L’argument de la salubrité n’a pourtant jamais été associé au discours sur les fortifications [7]. Cela peut en effet, fournir de nouvelles pistes de recherches que de regarder les fortifications par la loupe de la salubrité, au-delà de toute considération de défense.
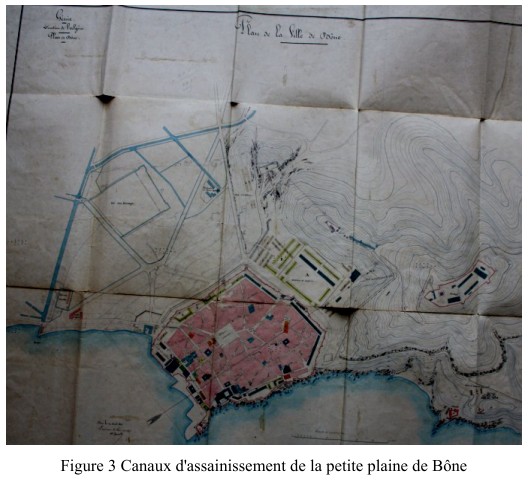 Source : 1H 847, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Source : 1H 847, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Ce plan reprend le système d’assainissement et d’assèchement de la petite plaine de Bône. Il est dressé le 20 avril 1843 par le lieutenant du génie, Danet, qui est lui-même l’auteur du projet retenu des fortifications. Deux faits repris dans le dessin sont à remarquer : les canaux d’assainissement et les chemins, le tout se tient hors la ville arabe. Quel en a été le dessein sinon d’y étendre Bône ?
Dans ses procès verbaux, le conseil général de la province de Constantine 12 insiste sur la nécessité d’obtenir des crédits pour les projets urgents tels que le port et le dessèchement de la petite plaine.
L’assainissement de la petite plaine de Bône représente à lui seul une somme de travaux se renouvelant chaque année depuis 1840, passant par les 1870. Ces dernières sont le moment fort du peuplement européen des villes d’Algérie et donc du besoin d’agrandir la ville.
Les canaux de Bône tracés avec minutie, en contrebas des reliefs arrosés de l’Edough et du Bou Kanta sont ainsi destinés à drainer les eaux des précipitations vers le canal exutoire. Aussi, l’assainissement aurai-il joué un rôle défensif ? A voir comment les deux tracés, de fortification et d’assainissement, évoluent conjointement pour retrouver le rivage, tout porte à croire que ces deux appareils sont au service l’un de l’autre. L’enjeu de mise en visibilité des tracés Danet est double. Il s’illustre dans le rapport de cet ingénieur au projet et au territoire.
La distinction souvent opérée entre la stratégie militaire d’occupation et les contraintes économiques dans la progression de la colonisation se trouve par ce type de résolutions sérieusement mise en question.
IV.3. FORTIFICATION ET DELIMITATION
Des multiples projets de fortifications, surgit la préoccupation insistante de se sécuriser et par la suite celle d’agrandir la surface du territoire conquis (Fig. 4). De s’en tenir aux limites de la ville arabe et tout ce qu’elle a pu représenter comme entraves à sa modernisation signifiait la simple remise en cause du système de colonisation lui-même.
Envisagées selon leur statut de « marqueur spatial » 13 , les fortifications révèlent au mieux la volonté de la colonisation à se tracer des limites avec un territoire tenu en réserve ou en observation. La figure 4 montre certes les hésitations du génie à se déployer autour de Bône mais il n’est guère exclu d’intégrer de nouveaux territoires. Dès le début, le génie a regardé autour de Bône, ceci représente une particularité englobant des terrains non encore occupés.
Il est évident que la géométrie du tracé des fortifications a été dans le respect des leçons de maître Vauban 14, mais portés sur une topographie particulière, elle donne à voir deux options de tracé et partant deux tendances d’aménagement. Quelle que soit l’apparente pluralité des choix de faire du territoire, deux directions ont orienté ce tracé. La casbah donne la tendance dans le premier cas et les fortifications qui y sont proposées englobent la forteresse en partant du rocher du lion où un système de batterie est déjà en place : « voir venir l’ennemi de loin » 15 , voici le seul argument de la liaison proposée entre le promontoire, la forteresse et la mer (Fig. 5).
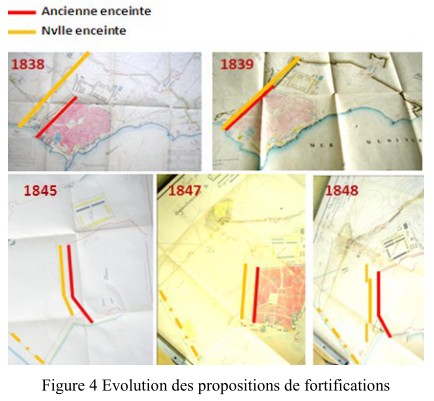
Sources : 1VH 382, 1VH 383, 1VH 384,
Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Dans le second cas, c’est la petite plaine de Bône qui est englobée, non sans réserves vis-à-vis des marécages encore en besoin d’être traités. Bien évidemment, ce tracé ne peut faire le déni de celui des canaux. Ces derniers, nés suite à d’importants travaux d’assainissement de la petite plaine ont déjà imprimé leurs marques sur le territoire. Selon un respect strict des tracés de ces canaux, la géométrie des murs d’enceinte ne soulevait qu’une question de distance entre la fortification et la canalisation. Au final, c’est côte à côte, et à quelques mètres de distance, que s’acheminent ces deux ouvrages pour former la première auréole encerclant le nouveau Bône (Fig. 6).
De la lecture des dossiers de projets se dégagent deux visions de ville : une option de place forte ou à fortifier, qu’on peut qualifier aussi de conservatrice, et une autre option plus extensive car en intégrant un territoire plus grand et plus urbanisable, elle voit en Bône une future ville.

Source : 1VH 384, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Cette planche reprend une partie du plan qui accompagne le « projet d’agrandissement de la place de Bône » de 1849 16 . On peut y lire la tendance à fortifier les hauteurs au détriment de la fortification de la petite plaine.
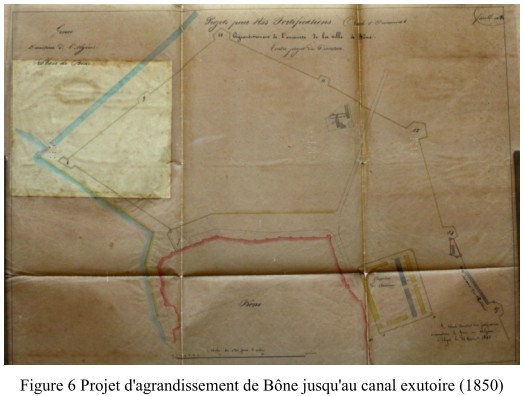
Source : 1H 847, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France;
Contre projet du directeur
Plus remarquables encore sont les catégories d’officiers porteurs de ces deux conceptions aux priorités si différenciées qu’elles ont suscité des interventions de supérieurs. Ainsi, au nombre de propositions correspond un nombre approximativement égal de contre projets des directeurs des fortifications.
Reprenant souvent les propositions initiales en ce qu’elles ont de plus substantiel, ces contre projets ne disent rien des rapports de force qui se trouvent derrière la multitude des projets. Ces conflits se lisent en filigrane dans les conférences, pourtant nées pour unifier les idées des uns et des autres. L’idée de consensus portée par les conférences n’intervient qu’après de longues divergences dans les conceptions de territoires à occuper et donc d’échelles de la colonisation à promouvoir.
En plus de révéler le contenu des idées du génie, ce système de conférences surgit ici pour marquer la tournure procédurale que prennent les démarches urbanistiques. Il est intéressant de se saisir de la portée et de la visée de la procédure dans un domaine en plein effervescence. L’occupation du territoire encore inconnu et fondamentalement à sécuriser, représente la motivation essentielle de la fièvre du projet. L’émergence de nouvelles questions liées à l’agrandissement de l’enceinte et de la ville rajoute à la prépondérance de la conférence.
Posé en termes de surfaces, l’agrandissement de l’enceinte n’a été entravé que par les débats autour de la salubrité des terrains à gagner. Au final, une conférence arrêtait l’extension en ces termes : « Le projet proposé par le commandant supérieur du génie offre le double avantage : 1. d’étendre la ville du côté du port de refuge projeté, 2. de ne comprendre dans cette extension que des terrains qui se trouvent à un minimum de 2 m au-dessus du niveau de la mer. Ce projet ajoute immédiatement à la ville une superficie de 27ha 61ares 10c lors de la démolition des fortifications actuelles […] pour les besoins de la population exigeant que l’enceinte fut reculée jusqu’à l’exutoire » 17 . La conférence est terminée par la formulation quasi impérative du génie militaire, que nous présentons en figure 7.
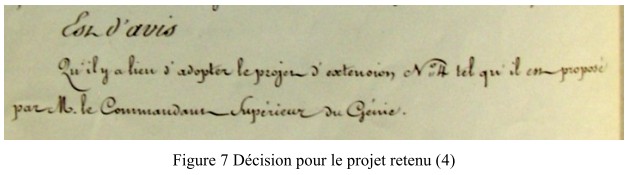
Source : 1VH 385, Archives du Shat, Vincennes, Paris
La conquête trouve ainsi dans le profil déterminé de l’officier Danet, un défenseur de ses intérêts conjugués, défense et mise en valeur des plaines gagnées sur le territoire environnant. La force de ses idées réside dans l’opportunité qu’il trouva à joindre aux rôles d’assainissement du canal exutoire, un rôle défensif de l’enceinte s’y juxtaposant. Il semble utile de souligner qu’il a été l’auteur des deux ouvrages, canal exutoire et enceinte. Ainsi, mission défensive et mission de mise en valeur des territoires pouvaient aller de pair.
Les débats ont duré pendant presque trois décennies et ce n’est qu’en 1855 qu’apparaît pour la première fois une fortification donnant la part belle à la petite plaine. Ainsi, les tracés contigus des canaux d’assainissement ont servi de ligne à suivre à la lettre par les nouvelles fortifications.
IV.4. LES FORTIFICATIONS, UNE QUESTION DE DEPENSES
Tout à fait à l’origine de ce nouvel épisode de débats surgit la question s’attachant aux énormes emprises foncières des servitudes de l’enceinte. Elles étaient plus immenses vers l’extérieur bien évidemment mais même la bande fine de l’intérieur faisait l’objet de tractations entre les militaires, la chambre de commerce et la mairie. Cette dernière commençait à marquer ses positions bien avant cet épisode mais pour les questions foncières, elle a davantage pesé du poids d’une élite nouvelle, essentiellement constituée de conseillers et propriétaires à la fois. Les sérieux intérêts que promettait la colonisation extensive de la plaine de Bône ne pouvaient plus attendre l’avènement de nouveaux consensus. Il faudra sans doute le remarquer que du déplacement de l’enceinte, tel que proposé par le lieutenant Danet, résulterait l’affaire financière indiquée dans le tableau 1. Le bénéfice qui pourrait résulter de l’exécution de ce projet pourrait se chiffrer par une somme de plus de 500 000 francs.
La ville voudrait se charger de cette opération puisqu’elle y trouverait un bénéfice conséquent. Mais le génie militaire trouve qu’il y aurait lieu de ne pas le lui céder puisque les revenus de la ville sont jugés « assez grands, elle est riche, ce serait lui faire un cadeau aux dépends des contribuables, l’état devrait donc en profiter au moment opportun » 18.
Tableau 1 Dépenses et bénéfice de l’extension des fortifications.
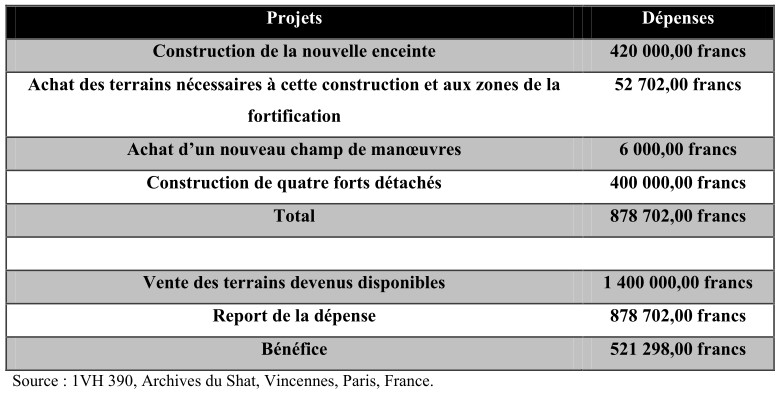
L’état pourrait ainsi et avec ce bénéfice, acheter tous les terrains qui constitueraient la nouvelle zone des servitudes s’étendant jusqu’à 250 mètres de l’enceinte, d’une superficie de 56 hectares environ.
Cette zone serait d’une grande ressource pour l’état, pour le génie militaire et pour la ville. Elle pourrait servir, selon le même procès verbal, de champ de manœuvre qu’il serait inutile de rechercher plus loin, ou de campement, ce qui a manqué à Bône lors de l’arrivée de troupes pour embarquer ou débarquer à l’époque des expéditions. Dans cette zone, le contrôle et la surveillance des constructions qui ne manquent pas de s’élever, pourront être facilement assurés.
Il est vrai que les bénéfices attendus de cette opération ne pourraient s’acquérir qu’après un temps long, par l’augmentation de la population. Cela explique qu’elle soit réitérée aux années 1880.
La lutte suscita alors la rédaction de nombreux écrits, de part et d’autres des instances concernées : ville et génie militaire. La rédaction de rapports allant et venant entre les pouvoirs locaux (mairie et chefferie du génie militaire) et plus loin (préfecture et direction des fortifications de Constantine), fut en effet, l’unique ressource mobilisée dans cette lutte d’intérêts prenant à terme une forme financière après avoir été longuement question de territoire et de sécurité. Ce déplacement de l’objet de lutte entre l’administration civile et celle militaire a le mérite de rompre enfin avec les hésitations des deux autorités et de nous livrer une histoire d’agrandissement de Bône comme un fait inéluctable.
V. GENESE DE LA STRUCTURE DE BÔNE
Les idées de délimitation du territoire à conquérir intègrent définitivement une forme d’avancée vers la plaine, orientée du côté ouest de la ville, là où l’espace se montre prometteur d’une colonisation fructueuse et d’une urbanisation facile. Il faudra ajouter la plus value qu’assure la proximité des domaines agricoles.
V.1. COMPLEXITE DU TOUT
Le parcellaire en cours de formation fait son apparition à partir des années 1860. Les cartes du génie le montrent bien. L’empressement avec lequel le sol a été réparti et par la suite livré à la construction de nouveaux bâtiments montre le besoin d’établir une nouvelle ville sans les contraintes de l’ancienne et désigne une période de fébrile disponibilité à construire.
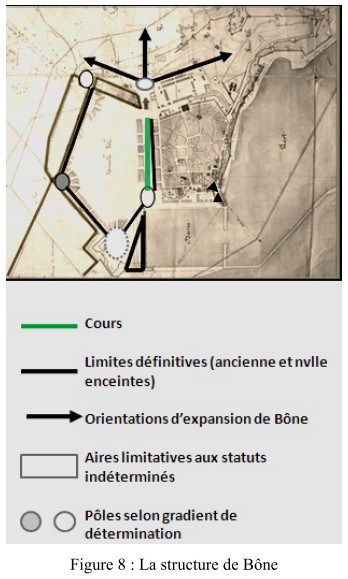
Source : 1VH 2045, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France;
redessiné par l’auteur
Une première période de construction s’accentuant surtout entre 1881 et 1891 voit venir les bâtiments les plus représentatifs d’une architecture néo classique mais territoire nord africain. La présence d’imposantes arcades, tantôt attribuée aux contraintes du climat tantôt vue comme duplication de rue parisiennes, annonce l’avènement combien désiré de la nouvelle ville. Il est à remarquer que les immeubles les plus représentatifs d’art ou de pouvoir, occupent les croisements de rues. Les successions de façades relèvent du même enjeu.
L’itinéraire de l’enceinte de Bône a été pour beaucoup dans celui de la ville. Il apparaît comme un seuil privilégié pour cerner les modes de fabrication urbaine par la marque de frontières se réadaptant au fil du temps. Le territoire de la nouvelle ville ainsi créée se définit par ses contours et par la possibilité conjointe de les maintenir et de les défendre.
Retenons la démarche adoptée : le tracé du contour par l’enceinte ensuite la composition de l’espace interne ainsi délimité. Cette composition prend tout son sens lorsqu’aux traces du sol (canaux et chemins de vergers), elle adapte un volontarisme structuraliste [8]. Outre le tracé net de la nouvelle ville, aucun territoire ne peut prétendre à autant de minutie dans sa conception.
Il devient clair que la structure urbaine de Bône est ainsi née de la géométrie du tour des fortifications.
Imprimé au sol de façon indélébile, ce tour de Bône fabriqué de toutes pièces, inclut la ville en son sein, une inclusion qui n’exclue en rien une série d’« objets » de structure complexes : Le cours édifié en place et lieu des anciens remparts, le mur de l’enceinte lui-même, les bastions, les portes et enfin les périmètres de fortification (Fig. 8).
Le projet de tracé d’un premier périmètre suivi d’une autre proposition de trois autres périmètres ont beaucoup joué dans la structure d’une banlieue à venir, par rapport à ses limites tout autant que pour ses liens au noyau originel. Il serait intéressant d’examiner au plus près le rapport à envisager entre les fronts pionniers fortifiés et les périmètres de colonisations.
Le passage à ces nouvelles fortifications marque un autre passage vers de nouveaux modes opératoires qui sans le souligner clairement sont en train de prendre une forme différenciée. Anticiper sur la croissance à venir et l’orienter n’est donc pas l’apanage de la planification urbaine des premières années du XXe siècle [9]. Les trois tours de villes que suggéraient les trois zones de servitudes sont eux aussi une forme de prévision du futur de Bône.
En ménageant de nouvelles portes, le tracé des nouvelles enceintes serait en train d’ouvrir la ville aux nouveaux territoires à conquérir. Ces aménagements constituaient la pièce maîtresse du nouveau système défensif de Bône tel qu’il est représenté pour le génie militaire. De toutes les portes, c’est la porte des Karezas (Ex porte de Constantine) qui à notre sens semble convenir pour illustrer cette situation de rencontre entre deux univers : l’un déjà conquis et l’autre en voie de le devenir.
V.2. COMPLEXITE DES ELEMENTS DE LA STRUCTURE URBAINE
Chaque élément de la structure de Bône peut en effet être envisagé séparément du reste, du simple fait qu’il ait bénéficié d’un traitement particulier par le génie militaire. Plus importante encore est la raison de cette particularité. Elle est à chercher dans les conférences qui ont unis le génie avec l’administration civile, à l’appel de laquelle, des conférences mixtes devaient se tenir. Le cas de la Porte d'Hippone nous semble représentatif : complexité des tâches et complexité des micro-territoires sur l’espace réduit d’une porte de ville (Fig. 9).
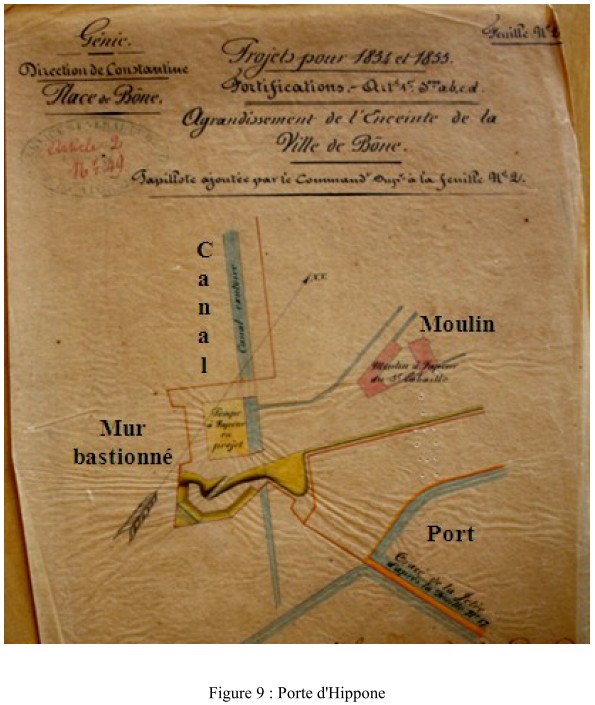
Source : 1H 848, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.
Le moulin Labaille et la darse du port rappellent une économie bônoise en fabrication. Alors que le canal exutoire et le bastion de la porte renvoient à une réalité des rapports de Bône avec un environnement ingrat pour ce qui est du premier, craintif pour le second. Là réside la complexité que nous observons. Elle révèle une autre complexité des appareils d’état en charge de l’espace bônois.
VI. CONCLUSION
Cet article a tenté de révéler les procédures de fabrication des fortifications de Bône. Les conférences dans ce cas précis ont favorisé le consensus. Nous avons vu combien en dépit de la pluralité des conceptions du territoire colonial, c’est celle consensuelle qui, à terme, a vu le jour. En revanche, ce n’est qu’en 1878, au cours de la vérification du bornage de la nouvelle enceinte qu’apparaît Bône comme une totalité. Ainsi, aux projets multiples succède enfin une idée de ville unitaire.
L’arrêt sur le discours impératif du génie militaire aurait facilement masqué ses multiples possibilités de composer avec les autres corps d’état. Il faudra souligner que rien de ces observations n’aurait été possible sans la lecture minutieuse des textes. Leur croisement avec les plans et les avis divers a fourni l’essentiel de l’apport méthodologique de l’article. Car au-delà de la simple manipulation de l’information, ces confrontations sont, à notre avis, indissociables du travail historique qui se veut une certaine rigueur.
BIBLIOGPHIE
[1] Hélène Blais et al (ss la Dir.), 2010, L’Algérie au XIXe siècle, revue d’histoire du XIXe siècle, n°41.
[2] Marie Charvet, 2005, Les fortifications de Paris, de l’hygiénisme à l’urbanisme, 1880-1919, éd. PUR, 312 p.
[3] Hélène Blais, 2009, Fortifier Alger ? Le territoire de la colonie en débats vers 1840, in M@ppemonde (91), N°3.
[4] Frédéric Moret, 2012, La construction des fortifications de Paris, in Annie Fourcaut et Florence Bourillon, Agrandir Paris (1860-1970), pp. 19-31.
[5] Frédéric Moret, 2009, Définir la ville par ses marges. La construction des fortifications de Paris, Revue Histoire Urbaine, n° 24, pp 97-118.
[6] Frédéric Moret, 1996, Un débat militaire, politique, économique, social et urbanistique dans la France de la Monarchie de Juillet : Fortifier Paris 1833-1845, in Troisième Conférence Internationale d'Histoire Urbaine, Budapest, Hongrie.
[7] Jean-Luc Pinol, Claire-charlotte Butez et Emmanuelle Regagnon, 2012, édification et destruction des enceintes militaires au XIX e siècle : le cas de Lyon, agrandir paris (1860-1970), in Annie Fourcaut et Florence Bourillon, Agrandir Paris, (1860-1970), pp. 49-63
[8] Michèle Lambert-Bresson et Annie Térade, textes réunis par, 2013, Architectures urbaines, formes et temps. Mélanges offerts à Pierre Pinon, Ed. Picard, Paris, France, 431 p.
[9] Philippe Grandvoinnet, 2011, Les emprises militaires dans l’urbanisme grenoblois du XXe siècle : des opportunités foncières au patrimoine paysager, In Situ [En ligne].
NOTES DE FIN
1 Deux éléments sont à préciser : le premier concerne notre mobilisation des sources qui a nécessité une restitution stricto sensu pour leur conserver leur contenu ; le second définit la conférence mixte comme étant une forme de réunion de différents corps d’état, elle est souvent organisée à l’appel du génie militaire et comporte un ou plusieurs objets de discussion, cette définition découle de la lecture de toutes les conférences mobilisées pour cet article et pour d’autres situations.
2 P. Y. Saunier utilise dans sa thèse l’expression « hommes » en place et lieu à celle d’« acteurs », de cours aujourd’hui, c’est à lui que nous l’empruntons, avec en arrière plan, cette idée sur les « hommes » à l’expérience probante : P. Y. Saunier, 1992, « Lyon au 19e siècle : les espaces d'une cité », Thèse de doctorat en histoire, Université Lumière-Lyon 2.
3 L’apport méthodologique envisagé par cet article réside dans l’insistance que nous mettons à rendre les réflexes acquis lors de notre approche historique plus visibles : le premier nécessite une implication du chercheur telle que seul le moment ciblé compte pour lui, il acquiert caractère d’« objet » en question.
4 1880, représente une borne limitant le matériau de cet article, car à partir de ce moment, les discussions et les réalisations des fortifications deviennent enchevêtrées et intègrent l’idée du déclassement. Il est plus pertinent de consacrer à cette dernière un autre travail.
5 Les consultations des archives du SHAT (service historique de l’armée de terre) au SHD (service historique de la défense) Paris, Vincennes montrent cette nette distinction du service des fortifications du reste des services du génie militaire. A la fois les documents lui appartenant (dépôt des fortifications) ainsi que le sceau attestant leur véracité peuvent vraisemblablement conforter notre hypothèse.
6 Depuis le début de sa conquête et jusqu’au début XXe siècle, l’Algérie a été, de fait, administrée par des généraux et des maréchaux, sous la tutelle du ministère de la guerre, contrairement aux autres colonies administrées par le ministère de la marine.
7 Sous série 1VH 382, Archives du Shat, Vincennes ; Article 8, Section, Bône.
8 Procès-verbaux et rapports de la Commission nommée par le Roi, le 7 juillet 1833, pour aller recueillir en Afrique tous les faits propres à éclairer le gouvernement sur l’état du pays et sur les mesures que réclame son avenir, Imprimerie Royale, 1834.
9 Sur ce point précisément, un travail historique qui partirait de cette hypothèse d’adaptation, gagnerait à explorer les documents, surtout ceux officiels.
10 Pour témoigner de la prise de Bône, en 1832, lire les multiples mémoires de militaires et de chroniqueurs, citons en exemple les mémoires du Général D’Armandy, personnage déterminant dans cette prise. La prise fut en grande partie réussie grâce à l’aide des habitants qui de crainte de la vengeance du Bey de Constantine, étaient « heureux » d’accueillir les troupes françaises.
11 Sous série 1VH 382, Archives du Shat, Vincennes, Paris.
12 Province puis département de Constantine, conseil général, procès verbaux ou rapports, entre 05/1875 et 10/1875, sur les projets de 1875, visiblement les plus coûteux de l’histoire de l’assainissement de Bône.
13 Expression empruntée à la géographie des frontières : voir les travaux d’Hélène Velasco-Graciet
14 Desmartins l’Ainé dans L’expérience de l’architecture militaire, 1685 ; Bernard Jean-François dans Nouvelle manière de fortifier les places, 1689 ; De Fer Nicolas dans Introduction à la fortification, 1690-1693 ; Ozanam Jacques dans Cours des mathématiques, Géométrie des fortifications, 1693.
15 Procès verbal de conférences, Sous série 1VH 384.
16 Sous série 1VH 384, procès verbal de conférence mixte.
17 Procès verbal de conférence mixte en date du 19 octobre 1849, sous série 1VH 385, repris par une conférence en date du 1855.
18 Constantine le 20 Octobre 1887, Procès verbal de conférence mixte, Sous série 1VH 390, Archives du Shat, Vincennes, Paris.
REMERCIEMENTS
Les auteurs remercient l’ensemble du personnel des centres d’archives où se sont déroulées les investigations : le service historique de la défense à Vincennes, Paris (France) et les archives locales de l’Assemblée Populaire Communale APC d’Annaba (ex Mairie de Bône - Algérie). Les auteurs remercient également le Laboratoire du Ladyss (Laboratoire Dynamique Sociale et Recomposition des Espaces) de l’Université Nanterre-Paris (France) ; laboratoire d’accueil dans le cadre d’un programme de coopération Algéro-Français Profas, ainsi que Mme Hélène Jannière, Professeure en Histoire de l’art à l’Université Rennes 2 pour sa contribution.
Article envoyé par M. D. Bonocori.
©UBMA - 2017
|
Grecs et Corses à Sidi-Mérouan
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N° 182-février 2010
|
L’exil des Uniates du Péloponnèse a été pour eux le prélude de plusieurs exodes, (mot dérivé du grec "exodos"). Fuyant Itylon en Morée du Péloponnèse, ils sont successivement passés à Gênes, puis à Paomia en Corse, pour aboutir via Cargèse, à Grarem et à Sidi-Mérouan à onze kilomètres de Mila et à soixante-sept kilomètres de Constantine, en Algérie Extraordinaire village, qui a la particularité d'avoir été créé uniquement par des familles corses grecques, toutes originaires de Cargèse ou de Piana.
L'installation en Algérie
Depuis son arrivée, la petite communauté grecque de Cargèse, augmentée de la naissance de nombreux enfants, se trouve un peu à l'étroit dans son sillage en Corse. C'est à partir de 1870 que les encouragements pour le peuplement de I'Algérie se multiplient. Nombreux sont ceux qui, persuadés qu'ils sont tolérés mais pas totalement insérés, vont vers 1870-1874, faire des demandes pour s'établir en Algérie où l'un des leurs était alors receveur de I'Enregistrement à Constantine. Les candidats au départ, au nombre de trente-trois d'abord, suivis de beaucoup d'autres ensuite, liquident tous leurs biens dans l’île. À partir de fin octobre 1874, ils s'embarquent sans leurs familles à Ajaccio pour Bône. A leur arrivée à Constantine, ils sont conduits à Grarem, Sidi-Mérouan, Ferdoua où I'administration leur propose des lots à mettre en culture.
Désormais, ne pouvant plus retourner, ni en Corse, ni à Itylon, les voilà avec leurs nombreux enfants confrontés à toutes les difficultés de la mise en valeur dans un milieu hostile, de lots exigus, envahis de figuiers de Barbarie et de lentisques.
Comme les autres colons, ils sont exposés aux fièvres paludéennes en raison de la proximité d'un marais, aux ophtalmies, à la sécheresse, aux invasions de criquets, aux incursions des pillards et surtout au manque de moyens de financement.
En 1975, dans l'édition n°4 d'Études corses, Mme Marie-Claude Barloli souligne que : "Les colons avaient I'habitude de demander des secours en argent". De telles sollicitations, remarquées par les services du Gouvernement général de I'Algérie, trouvent probablement leur explication dans la présence de nombreux enfants dans les foyers gréco-corses ainsi qu'un plus grand isolement que celui de la majorité des colons établis dans les autres régions.
La communauté corse de Grarem et de Sidi-Mérouan
Partis en 1675 d'Itylon, dans le golfe de Messénie, les Uniates ont vu s'évanouir les clochers blancs et les volets bleus des maisons du péloponnèse.
Après leur arrivée à Gênes, leurs descendants, successivement installés à Paomia, puis à Cargèse, en repartirent vers deux villages du Constantinois créés à la fin du Second Empire par M. Luciani, secrétaire général à la préfecture de Constantine. Le village de Sidi-Mérouan, commune de plein exercice de 2711 hectares a été créé en1874 ; celui de Grarem avec ses 1400 hectares en 1885. Toutes ces familles sont installées dans ces deux villages et dans leurs dépendances à Ferdoua et à Siliana où elles ont expressément demandé leur regroupement.
Elles disposent dans ces villages d'une poste et d'une école. En 1900, M. Stéphanopoli dirige l'école mixte franco-arabe de Grarem. Leurs enfants apprennent le français. Au contact des jeunes des douars : Guettara, Ouled-Yahia, Hamala, Siliana, Ben-Haroun et Sidi-Abdel-Malek, ils parlent couramment l'arabe. Inversement les petits musulmans récitent poésies et tables de multiplication avec I'accent corse.
Dans l'édition n° 56 de la revue "Les Africains" de novembre-décembre 1981, Marc Monnet, auteur d’un article sur les villages corses en Algérie, souligne I'excellente qualité de I'enseignement primaire. Plusieurs de ses élèves ont en effet occupé par la suite d'importants postes dans I'administration et la magistrature.
Vingt-cinq ans après en Algérie
En 1900, les villages de Sidi-Mérouan, Grarem et Siliana, abritent des familles nombreuses. Familles dont la solidarité se manifeste de façon très efficace dès que I'une d'entre elles est dans le malheur. Les hommes, exposés à la dureté des conditions d'existence, meurent en laissant des veuves en charge de nombreux enfants. En cas de décès des deux parents, un frère ou une sœur, déjà chargés de famille, élèvent les orphelins.
Les étapes de I'insolite itinéraire des Uniates du Péloponnèse
Les familles conservent la pratique de leur langue maternelle, de leurs coutumes religieuses et de leurs habitudes culinaires. Les baptêmes se célébraient par l’immersion totale du baptisé, avec les prières du ministre du culte orthodoxe uniate, Démétrius Stephanopoli qui officiait en 1900.
Dans les foyers, les plats traditionnels sont toujours cuisinés. Les repas sont composés de "kefkédes" (boulettes à la viande), de "moussaka", de "dolmades" (feuilles de vigne), I'anisette n'avait pas encore supplanté "l'ouzo". Enfin, comme en Grèce, il n'y a pas de dessert à la fin du repas.
Sidi-Mérouan et Grarem : deux villages grecs
En 1900, à Sidi-Mérouan, la mosquée n'est pas très éloignée de la maison du culte grec, dont le ministère est assuré par M. Démétrius Stéphanopoli. Dans ce village, le maire Stéphanopoli vient de céder son siège de premier magistrat à M. Constantin Ragazacci, dont M. Elie Rochiccioli est I'adjoint. En raison de I'exiguïté des concessions, les colons font des cultures maraîchères, cultivent de la vigne dont ils vinifient les raisins. Avec la céréaliculture, ils pratiquent l'élevage des bovins et des porcins.
Dans les deux villages, les exilés se répartissent toutes les tâches et, même si cette liste est forcément incomplète, voici quelques-unes des principales occupations de leurs habitants en 1900 : Draina Polymène garde-champêtre, Sidi-Mérouan ; Dragacci Jean, facteur-receveur, Sidi-Mérouan, Dragacci Polymène, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Dragacci Etienne, entrepreneur T.P., Sidi-Mérouan ; Exiga Antoine, garde-champêtre, Sidi-Mérouan; Exiga Michel, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Frangollacci François, agriculteur-viticulteur, Grarem ; Frangollacci Xavier, agriculteur-viticulteur, Grarem ; Garidacci Drago, maréchal-ferrant, Sidi-Mérouan, Lugarini, menuisier-ébéniste, Sidi-Mérouan ; Lugaro Dominique, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Pantaléonacci, maréchal-ferant, Sidi-Mérouan ; Ragazacci Constantin, maire, Sidi-Mérouan ; Quilici, agriculteur, Grarem ; Rochiccioli Antoine, adjoint au maire, Sidi-Mérouan ; Rochiccioli Thomas, viticulteur, Sidi-Mérouan : Stéphanopoli Démétrius, prêtre orthodoxe, Sidi-Mérouan ; Stéphanopoli Elie, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Voglimaci Michel, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Voglimaci Théodore, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Zannetacci Stéphanopoli, viticulteur, Sidi-Mérouan ; Zannetacci Antoine, agriculteur, Siliana.
Sidi-Mérouan et Grarem : quarante ans après
En 1914, les familles grecques de Sidi-Mérouan, Grarem et Ferdoua ne sont plus tout à fait corses, même si elles maintiennent des liens avec ceux qui sont restés sur l'île. Elles restent toujours très attachées à leur culte orthodoxe de rite byzantin. Après la guerre de 1914-1918, de nombreux noms grecs sont gravés sur les monuments aux Morts des villes et villages d'Algérie.
Par la suite, la culture de la vigne, exigeante en main d'œuvre est progressivement abandonnée dans le département de Constantine au profit de quelques plaines comme celles de la Soummam ou de la Seybouse.
Enfin, comme partout en Algérie, l’enseignement primaire, puis secondaire permet aux nombreux enfants des familles de Sidi-Mérouan et de Grarem, d'essaimer vers le village de Lutaud, dans la région de Batna, dans un premier temps puis vers les carrières de I'administration ou du secteur tertiaire par la suite.
Sidi-Mérouan, Grarem et Lutaud : soixante-dix ans après
En 1939, la communauté française d'origine grecque de ces villages entre dans la guerre. L'année 1940 est celle du départ du dernier pope de Sidi-Mérouan.
Entre 1939 et 1945, les jeunes et les moins jeunes sont incorporés dans l'Armée d'Afrique avec des métropolitains et des fils et petits-fils d'immigrés rhénans, espagnols, italiens, maltais. Ils participent à toutes les batailles de France, du Liban et à partir de 1942, de Tunisie, d'Italie, de France et d'Allemagne. Après la guerre, d'autres noms grecs seront gravés sur les plaques des églises, des écoles ou des monuments aux Morts d'Algérie.
Juin 1962 : autre exode
Près de deux cent quatre-vingt-dix ans se sont écoulés depuis le départ d'Itylon. La communauté française d'origine grecque, fondue dans plus d'un million de Français d'Algérie, en est à son quatrième exode.
Avec la plus grande dignité, les descendants des Uniates d'Itylon, s'embarquent pour recommencer et replonger leurs racines en France.
Réimplantés avec courage et opiniâtreté sur le sol de France, nombreux sont ceux qui témoigneront par l'écrit I'insolite itinéraire de leurs ancêtres, ballottés par I'Histoire, de leur berceau du Péloponnèse à Gênes, en Corse. En Algérie puis en France.
Le bilan de cet exil à I'aube de I'an deux mille
De Grarem et de Sidi-Mérouan, Les Français d'origine gréco-corse se sont répartis dans toute l’Afrique du Nord et notamment dans le département de Constantine à Gravelotte, Lutaud, Youks-les-Bains, Lacroix, Périgotville, Chevreul, puis dans ceux d'Alger et d'Oran. Cette propension à I'essaimage s'est encore développée lors de I'exode massif de 1962, après lequel nous retrouverons leurs descendants dans toutes les villes de France où ils se sont fondus dans la communauté nationale. Hormis les noms qui subsistent, leurs enfants ne parlent plus la langue maternelle et ne goûtent pas plus que les autres Français la cuisine grecque. Avec le développement des moyens de communication, ils ont refait en sens inverse itinéraire de leurs ancêtres en se souvenant des exodes successifs. De tous ceux qui, de part et d'autre, ont vécu ces déplacements toujours douloureux, il est encore difficile de dire qui a le plus perdu.
Probablement pas ceux qui ont subis et qui, dans la cruelle adversité ont eu assez de courage et d'opiniâtreté pour surmonter leurs difficultés. Enfin, en remontant jusqu'au berceau familial, dans le Magne du moderne Péloponnèse, ils se sont aperçus. non sans surprise. que ceux qui y sont restés conservaient le souvenir de ceux qui en étaient partis.
Respectueux du passé de leurs lointains parents, des liens qu'ils croyaient rompus ou distendus se sont reconstitués dans le souvenir des générations précédentes et des sacrifices consentis pour survivre.
Edgar Scotti
Lire les excellents textes de ; Mme Marie-Claude Bartoli intitulé ; Sidi-Mérouan, une colonie gréco-corse en Algérie " publié dans études corses n°1975. M. Lucien Pei-Tronchi, intitulé : « Corses ou Grecs » publié en 1995, dans l'édition n° 50 de généalogie Algérie Maroc Tunisie, maison Alphonse Juin, 29, avenue de Tübingen, 13090 Aix-en-provence.
|
|
MINISTERE de l’ALGERIE 1957
Envoyé Par M. C. Fretat, pages de 105-121
|
PACIFICATION - REFORMES
REFORMES SOCIALES
Les Centres Sociaux
But de ces organismes.
Organisation.
Caractères essentiels.
Instructeurs de I'enseignement primaire.
Assistance médicale gratuite.
Amélioration générale du régime social.
Extension du Fonds National de Solidarité.
Modernisation de l'habitat traditionnel.
Accession des Musulmans à la fonction publique.
Dix millions d'habitants vivent en Algérie, et en 1955 I'excédent des naissances sur les décès a été de 280 000 âmes. Un tel taux d'accroissement pose de façon angoissante le problème du travail dans cet immense pays aux ressources limitées, aux possibilités industrielles réduites.
Sans doute, près de 350 000 ouvriers algériens sont employés en métropole ; mais il reste encore ici plus de 400 000 hommes sans travail et plus d'un million de sous-employés. Procurer de l'emploi à cette main-d'œuvre, tel est le but des réformes économiques et, en particulier, des réformes agricoles. L'éduquer, lui donner la qualification nécessaire, faciliter son accession à certains emplois, d'une manière générale, améliorer ses conditions de vie par tous les moyens, tel est celui des réformes sociales.
Différents organismes ont été créés qui ont pour but d'étudier tous Ies problèmes de main-d'œuvre, de défendre les intérêts des travailleurs algériens en métropole, d'organiser leur départ en sélectionnant et en formant les candidats à l'émigration.
LES CENTRES SOCIAUX
Dans le cadre des mesures prises pour répondre à la situation créée en Algérie par les troubles qui débutèrent le 1er novembre 1954 ont été créés les Centres Sociaux.
LES BUTS DE CES ORGANISMES
L'arrêté du 27 octobre 1955 énumère les buts du Centre Social.
Donner une éducation de base à tous les éléments d'une communauté des deux sexes et de tous âges, qui n'ont pas bénéficié ou ne bénéficient pas de la scolarisation. Mettre à la disposition de cette communauté des cadres spécialisés dans les différentes techniques de l'éducation.
Faire en sorte que cette population dispose d'un service d'assistance médico-sociale.
D'une manière générale, susciter, coordonner, soutenir toutes initiatives susceptibles d'assurer le progrès économique, social et culturel de cette même population.
L'ORGANISATION DES CENTRES SOCIAUX
Le Centre Social est un organisme animé
Par un corps d’éducateurs dotés des moyens nécessaires pour assurer l’évolution d’une collectivité sous-évoluée vers un mieux-être. Il veut mettre simultanément à la disposition de tous les groupes (adultes hommes et femmes, adolescentes et adolescents, enfants) d'une collectivité sous-développée :
1° Les moyens éducatifs (éducation de base) : moniteur d'enseignement général, qui enseignera les éléments du calcul, de la lecture, éventuellement de l'écriture (apprendra tout au moins à signer) ; monitrice d'enseignement ménager et familial ; moniteur rural ; moniteur de préformation professionnelle ; assistante médico-sociale et professionnelle ; éducatrices en matière d'hygiène et de soins aux bébés.
2° Les moyens de tirer profit de l'éducation : secrétariat social, soins médicaux et hygiène, utilisation des ressources locales, accès au travail, augmentation du niveau de vie, orientation professionnelle, informations sociales, économiques, politiques, distractions éducatives et sportives.
Le Centre Social travaille eu coordination avec Ies Services suivants :
- l'Education nationale (1er degré - enseignement professionnel )
- Hygiène scolaire ;
- la Santé publique ;
- I'Agriculture (Paysannale et S.A.R.) ;
- le Travail.
Le Centre Social s'adresse particulièrement à la population démunie des moyens de s'adapter aux institutions modernes. II suscite son intérêt à l'égard de ces institutions auxquelles il I'initie, avec le constant souci qu'elles soient utilisées au maximum.
CARACTERES ESSENTIELS
La tâche du centre Social revêt quelques caractères essentiels
- Son humilité : le Centre Social enseigne les notions de base : compter, lire (un peu), écrire (un peu), ou signer, se soigner, se vêtir, équilibrer son alimentation, augmenter son revenu, « se défendre » dans la vie de tous les jours.
- Son caractère utilitaire : l'éducation qu'il donne a un but avoué : augmenter le niveau de vie par une santé meilleure, par l'accès au travail, par l'amélioration ou la création de ressources, par l'adaptation au milieu social et administratif dans lequel se trouve placé l'homme d'aujourd'hui.
- Son souci d'auto éducation : le Centre Social essaie d'amener les intéressés à sentir la nécessité d'une adaptation et d'une évolution, et il met des éducateurs à leur disposition pour les aider à s'aider eux-mêmes.
Réalités et perspectives.
Les crédits inscrits au budget de l'Algérie pour l'exercice 1956-1957 devaient permettre la création et le fonctionnement des trente premiers centres sociaux mais, eu égard aux circonstances, le rythme des implantations et des constructions n'a pu s'accélérer que vers la fin de l'exercice.
Alors que le premier centre était installé dans le courant du premier trimestre de 1955 et qu'on en comptait quatre en mars 1956, quatorze centres fonctionnaient dès le début de I'année 1957, dont six centres urbains. Les centres urbains étaient implantés dans les bidonvilles de l'agglomération algéroise et les centres ruraux répartis sur deux régions, trois d'entre eux au pied de l'Atlas blidéen, cinq dans les régions du moyen Chélif et des Braz.
Au mois de juin 1957, aux dix-sept centres existants s'ajoutaient seize centres en voie de réalisation et ainsi répartis :
- Centres urbains :
- 4 dans la région algéroise,
- 3 en Oranie (Oran, Mostaganem et Relizane),
- 1 à Bône;
- Centres ruraux:
- 4 dans la région du Chélif,
- 2 dans la région de Mostaganem,
- 2 dans la région de Sétif.
Compte tenu de la nouvelle tâche qui est désormais dévolue aux centres sociaux et pour laquelle ils n'étaient pas prévus à I'origine, c'est-à-dire le renforcement des moyens de scolarisation de la jeunesse rurale, le ministre de l'Algérie a fait établir un plan d'extension de ces organismes lié au développement du programme de scolarisation.
Il a donc été décidé que, en principe, leur nombre devrait s'accroître annuellement:
- de 30 unités en 1957-58, 1958-59 et 1959-60,
- de 60 unités en 1960-61 et 1961-62,
- de 90 unités en 1962-63 et 1963-64
- et de 120 unités en 1964-65
Ainsi, au cours des prochaines années, le nombre des centres sociaux devra pouvoir approcher 600 et atteindre approximativement une population de quatre millions de personnes.
L'ampleur de ce programme permet de mesurer l'intérêt que les pouvoirs publics attachent à une institution révolutionnaire dans ses méthodes comme dans ses intentions, puisqu'elle représente une entreprise d'éducation des masses dont, en dépit des vœux de I'U.N.E.S.C'O.. Il n'existe guère d'exemples dans le monde.
INSTRUCTEURS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Le plan de scolarisation qui prévoyait l'ouverture annuelle de 800 classes a été poursuivi malgré les difficultés créées par la rébellion.
Le problème des maîtres nouveaux a été résolu par le recrutement « d'instructeurs » qui assurent l'enseignement du premier degré dans les classes créées. Au 1er juin 1957, 1500 instructeurs avaient été engagés, dont un tiers de français musulmans.
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
Le décret du 16 juillet 1956 a refondu I'organisation de l'assistance médicale gratuite en Algérie afin d'en accroître I'efficacité en améliorant la qualité des services rendus et en lui permettant d'atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires (voir Documentation Générale : Santé publique).
A cette fin, l'initiative est transmise de la commune à l'Administration qui aura totalement à charge de réaliser un plan d'équipement de I'assistance ambulatoire. Les dépenses d'assistance sont prises en charge par le budget de I'Algérie, la participation des collectivités locales étant désormais proportionnelle à leurs ressources et non plus au nombre d'assistés. D'autre part, il suffira que l'assisté réside en territoire algérien pour bénéficier de l'assistance médicale gratuite.
Afin de permettre la mise en place rapide des médecins nouveaux que réclame l'exécution de ces dispositions, un arrêté du 8 février 1957 a fixé la rémunération de médecins contractuels qui doivent résider dans le bled.
AMÉLIORATION GENERALE DU REGIME SOCIAL
La législation algérienne du travail s'est enrichie au cours de la dernière année de textes nouveaux qui ont profondément amélioré ce secteur (voir Documentation Générale : Législation sociale - Législation du Travail et Sécurité Sociale).
EXTENSION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ
Le décret du 24 novembre 1956 a étendu à l'Algérie les dispositions sur le Fonds national de Solidarité. Toutes les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et démunies de ressources deviennent bénéficiaires d'une allocation dont le montant s'élève à 24 000 francs lorsqu'il s'agit de célibataires ou veufs, disposant d'un revenu annuel inférieur à 201 000 francs, et à 36 000 francs si les deux conjoints sont vivants et disposent d'un revenu annuel inférieur à 258 000 francs.
Ces dispositions, qui ont pris effet à partir du 1er octobre 1956, ont immédiatement été appliquées.
La plupart des dossiers sont déjà instruits et les allocations effectivement versées. Cette mesure concerne 300 000 personnes en Algérie dont plus de 250 000 Musulmans.
MODERNISATION DE L'HABITAT TRADITIONNEL
Sur la base de I'expérience réalisée dans la zone du Chelif par le Commissariat à la Reconstruction, après le séisme de septembre 1954, une politique systématique d'amélioration de l'habitat traditionnel a été menée (voir : Documentation générale, Aspect social : Habitat).
ACCESSION DES MUSULMANS À LA FONCTION PUBIIQUE
A ces mesures sociales qui accélèrent le rythme et rajeunissement les formes d'une action qui se poursuit depuis plusieurs années, il convient d'ajouter les dispositions profondément novatrices touchant l'accession des Musulmans à la fonction publique (décret du 17 mars 1956).
On a parfois voulu y voir une violation du statut de la fonction publique ; elles ont été inspirées en réalité par le souci d'accroître la participation des Français-Musulmans à la gestion des affaires du pays.
Elles tiennent compte du handicap que constituent pour la population autochtone des scolarités difficiles et l'adaptation nécessaire à une langue très différente de la langue maternelle, l'arabe ou le berbère.
Dans tous Ies concours, la limite d'âge a été reculée de cinq ans pour les Français-Musulmans. De plus, le recrutement par contrat et sur titre d'un nombre déterminé de fonctionnaires a été autorisé dans des emplois normalement attribués au concours. La moitié au moins des postes vacants et même les deux tiers pour le recrutement de non-titulaires (arrêtés du 15 avril, 4 mai, 30 mai, 7, 27 et 29 juin, 10 juillet, 9 et 27 août, 25 septembre, 10 décembre 1956) doivent être réservés aux candidats français-musulmans. Ces mesures ont été largement appliquées puisque, au 1er août 1957, 3 852 Français-Musulmans étaient effectivement admis et nommés dans la fonction publique.
Ces 3852 postes ont été attribués ainsi qu'il suit:
- 3152 candidats nommés par l'intermédiaire de la commission centrale, dont :
- 94 en catégorie A (Fonctions de conception et direction),
- 359 en catégorie B (Fonction d'application),
- 1232 en catégorie C (Emplois d'exécution),
- 1147 en catégorie D (Emplois de services et divers)
- 700 candidats nommés par les commissions départementales dans Ies collectivités locales et les services hospitaliers.
Dans le même esprit, il a été décidé que tous les organismes, établissements et entreprises privés qui assurent un service public, qui bénéficient d'une aide, d'une collectivité publique ou qui travaillent pour le compte d'une collectivité, doivent, lors du recrutement de personnel nouveau, réserver au minimum la moitié des emplois à des Français-Musulmans.
Ces mesures consacrent dans les faits, en tenant compte des réalités, l'égalité de droit entre les Français-Musulmans et les autres citoyens français.
RÉFORMES DANS LE DOMAINE AGRICOLE
Réforme agraire:
Législation.
Etat d'avancement de la réforme en juin 1957.
Crédit agricole.
Réformes sociales :
Revalorisation des salaires.
Suppression du Khamessat.
Limitation de la durée du travail.
Repos hebdomadaire.
Congés payés.
Justification et périodicité du paiement des salaires.
Accidents du travail.
Amélioration du régime d'assurances sociales.
RÉFORME AGRAIRE
Certains s'étonnent que la réforme agraire décrétée par le gouvernement au printemps dernier ne se soit pas traduite par l'installation immédiate de milliers de familles de petits propriétaires.
LÉGISLATION
Il s'agit, rappelons-le, d'une mesure qui nécessitait la mise au point d'une législation très complexe et a donné lieu à I'élaboration d'une série de mesures applicables aux différents cas particuliers :
1°) Création, par le décret du 26 mars 1956, d'un établissement public appelé Caisse d'Accession à la Propriété et à l'Exploitation Rurales, chargé des acquisitions de domaines, de leur lotissement et de leur cession aux nouveaux petits propriétaires.
La mise en place de cet organisme revêt une grande importance lorsqu'on sait le rôle joué dans l'application de la réforme agraire en Italie par les nombreux offices ou établissements para-administratifs créés à cet effet.
2°) Limitation du droit de propriété et possibilités d'expropriation dans les périmètres irrigués (décret du 25 avril 1956).
Ce décret donne le droit au Gouverneur d'exproprier sur simple décision administrative les superficies détenues dans les périmètres irrigués par les particuliers, au-dessus d'un plafond variant de 50 à 150 hectares par propriétaire suivant les charges de famille.
3°)Procédures exceptionnelles d'expropriation des grands domaines (décret du 13 juillet 1956).
Deux dispositions essentielles :
a) Une procédure d'expropriation administrative à l'encontre des grands domaines ayant fait I'objet à l'origine d'une concession de l'Etat. Cette procédure, ainsi que le mode d'indemnisation est absolument semblable à la nationalisation des houillères ou de l'électricité.
b) Extension de la notion d'utilité publique aux expropriations de tout domaine agricole dont la Caisse d'Accession à la Propriété peut avoir besoin. Il s'agit d'une mesure jusqu'alors réservée aux terrains nécessaires aux travaux d'intérêt public (routes, voies ferrées, aérodromes) et depuis quelques années seulement aux lotissements urbains.
4°) Cessions gratuites de terrains domaniaux ; le décret du 21 septembre prévoit la cession gratuite à la Caisse d'Accession à la Propriété de terrains domaniaux.
Jusqu'alors les terres domaniales étaient réservées à la colonisation, Celles qui sont encore vacantes iront dorénavant aux bénéficiaires de la réforme agraire.
Ces textes de base pris en application des pouvoirs spéciaux ont force législative et ont nécessité, bien entendu, de nombreux arrêtés d'application qui règlent les moindres détails.
Leur mise en œuvre doit se faire avec sérieux, et, il ne s’agit pas de créer pour les futurs propriétaires des sources de conflits et de difficultés qui Ies empêchent de vivre dans la tranquillité. La désignation des lots, les limites de propriétés doivent être établies avec précision et nécessitent des relevés topographiques complets.
RÉSULTATS ACQUIS EN JUIN 1957
Grands domaines
Par décrets du 20 octobre 1956, les deux plus grands domaines de l'Algérie ont été nationalisés :
a) Cie Genevoise à Sétif : 16 000 hectares.
b) Cie Algérienne : Est constantinois : 66 000 hectares.
La Caisse d'Accession à la Propriété et à l'Exploitation Rurales en a pris possession et en assure la mise en valeur pour la campagne agricole actuelle.
Deux commissions paritaires composées de techniciens de I'administration et de représentants des agriculteurs (notamment des petits agriculteurs musulmans) siègent à Sétif et à Constantine et ont établi le plan de lotissement et la liste des bénéficiaires.
Les lots ont une superficie moyenne de 30 hectares par famille. S'agissant d'une région céréalière, il ne convenait pas, en effet, de constituer un nouveau prolétariat agricole sur des lots trop petits (les expériences des pays de I'Europe de l'Est sont, à ce sujet, suffisamment convaincantes) surtout en raison du grand nombre de personnes constituant chaque famille.
Domaines demandés par la caisse
Une vingtaine de dossiers d’expropriations sont soumis aux préfets qui appliqueront la procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique avec déclaration d’urgence.
Ces expropriations portent sur 30 000 hectares environ dont 15 000 en Oranie et 3 000 en Kabylie.
Périmètres irrigués.
L'inventaire entrepris par les Services de l'Hydraulique a permis de dégager une première tranche de 20 000 hectares irrigables sur lesquels des lots de 3 à 5 hectares seront constitues (cultures légumières et fruitières) en vue du recasement de 5000 familles environ (voir : Documentation générale : L'hydraulique et l'équipement rural).
Terrains domaniaux et Communaux
Il existe des milliers d'hectares non affectés en propriété et objets de locations et de sous-locations. La Caisse d'Accession à la Propriété a décidé de faire porter un premier effort de répartition rationnelle sur une première tranche de 200 000 hectares qui seront remis en priorité par lots soit aux occupants sans titres de certaines terres collectives, soit à de nouveaux exploitants.
Ce travail très complexe permettra de transformer profondément les conditions sociales d'une multitude de petits agriculteurs actuellement sans droits, et qui pourront ainsi emprunter au Crédit agricole et s'équiper en vue d'une meilleure productivité.
Territoires du Sud.
Dans le Sud algérien, un programme spécial prévoit la constitution de lots comprenant 90 palmiers par famille. Plusieurs centaines de ces lots sont en cours de distribution. Les nouvelles palmeraies créées autour des puits récemment forés feront l'objet de répartitions semblables aux oasiens et aux nomades en vue de leur sédentarisation.
Habitat Rural
Le Conseil d'administration de la Caisse d'Accession à la Propriété a décidé de subventionner très largement la construction des maisons destinées à loger les bénéficiaires de la réforme (probablement à 100 %).'
Une première tranche porte sur un programme de 300 millions qui s'ajoute aux programmes généraux de modernisation de l'habitat traditionnel (voir : Documentation générale : Habitat).
Encadrement technique des bénéficiaires.
Le morcellement de grands domaines cultivés selon les méthodes modernes, notamment pour la production de céréales, peut aboutir à une diminution de la productivité et à une récession économique. Rien qu'on ne puisse entièrement parer à ce danger, il convient de constituer les organes d'aide technique en faveur des nouveaux recasés.
Les structures du Paysannat, notamment les Sociétés Agricoles de Prévoyance et les Secteurs d'améliorations rurales permettent de placer les nouveaux petits producteurs dans un cadre social et économique pour leur procurer toute l'aide dont ils auront besoin : crédits de campagne, acquisition de matériel, travaux collectifs de labours et de récoltes, commercialisation des récoltes, distribution d'engrais, de semences, etc... Un corps spécial de moniteurs agricoles vient d'être créé.
Une première tranche de 300 emplois a été inscrite au budget modificatif de l'Algérie. Le recrutement a aussitôt été entrepris, notamment parmi les jeunes Européens et les jeunes Musulmans titulaires d'une bonne formation primaire supérieure ou secondaire.
CONCLUSION.
Tous les problèmes que pose la réforme agraire : élaboration de la législation, expropriation, indemnisation, prise en charge des domaines, travaux de relevés topographiques, plans de lotissements et mise en valeur, désignation des attributions, préparation des organismes d'encadrement, formation des cadres techniques sont menés de front dans des délais aussi courts que possible.
CRÉDIT AGRICOLE
Dans la ligne de l'évolution des crédits agricoles, les décrets n° 56294 et 56 295 du 26 mars 1956 ont unifié la structure des Etablissements centraux de Crédit Agricole en alignant l'organisation de la Caisse de Prêts Agricoles et de la Caisse Centrale des Sociétés Agricoles de Prévoyance sur celle de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel en vue d'assurer leur fonctionnement avec plus de souplesse dans le cadre d'une même doctrine et d'une même méthode.
Afin de faire gérer les Etablissements intéressés par les représentants qualifiés des agriculteurs qui en relèvent, la composition du conseil de la Caisse de Prêts Agricoles et de la Caisse Centrale a été prévue de telle façon que les masses musulmanes soient représentées en leur sein.
Désormais ces représentants figurent pour moitié dans chacune de ces assemblées qui sont à même de gérer d'une façon plus rationnelle Ies fonds mis à la disposition de ces établissements publics en vue d'améliorer les conditions de vie économique et sociale de tous les agriculteurs et plus particulièrement des fellahs.
Par ailleurs, la Caisse de Prêts Agricoles a été habilitée à consentir des prêts aux agriculteurs qui n'offrent pas les garanties réelles suffisantes prévues par le Droit français, grâce à la création d'un fonds de garantie et à l'octroi éventuel des garanties de l'Algérie (voir : Documentation générale : Economie, Agriculture, Le crédit).
RÉFORMES SOCIALES DANS LE DOMAINE AGRICOLE
Revalorisation des salaires.
Un arrêté a prévu la revalorisation du salaire minimum de l'ouvrier agricole qui ne pourra désormais être rémunéré à un taux inférieur à 440 et 525 francs par jour selon les zones (arrêté du 17 mars 1956).
Suppression du khammessat.
Le système de « khammessat », contrat de bail-traditionnel pratiqué essentiellement entre Musulmans, et dans lequel le preneur n'a droit qu'au cinquième des produits, a été supprimé et remplacé par un métayage à mi-fruit (décret du 26 mars 1956).
Cette mesure intéresse 155 000 khammès employés par 101 000 propriétaires. Il faut toutefois signaler que 71 600 de ces propriétaires font appel uniquement à des khammès (superficie: 1 900 000 ha), tandis que 30 000 emploient des khammès et de la main-d'œuvre salariée (superficie : 1 180 000 ha).
Limitation de la durée du travail.
Un décret du 18 février 1957 a limité à 2400 heures par année de 300 journées de travail le temps de travail légal des ouvriers agricoles et similaires de I'un et l'autre sexe et de tout âge.
Repos hebdomadaire.
Le même décret institue le repos hebdomadaire dans les professions agricoles ; l'ouvrier agricole a droit chaque semaine à un jour de repos qui peut être soit le dimanche, soit un autre jour de la semaine fixé par le préfet du département.
Congés payés.
La loi du 27 mars 1956 a modifié le régime antérieur des congés payés ; désormais, le travailleur agricole qui a effectué chez le même employeur vingt-quatre jours de travail a droit à un jour et demi de congé, sans que le total de congé puisse dépasser dix-huit jours ouvrables dans I'année.
Justification du paiement.
Les employeurs agricoles sont tenus de remettre à leurs salariés, lors de chaque paye, un « bulletin de paye » indiquant le nom de l’employeur, l'organisme d'assurances sociales, le nom du travailleur et son emploi, la période et le nombre de journées de travail et le montant de la rémunération ; ces mentions doivent être reproduites sur un livre de paye, coté, paraphé et visé par le juge de paix (décret du 12 septembre,1956).
Périodicité du paiement.
Les salaires des ouvriers de l'agriculture doivent être payés au moins deux fois par mois à seize jours au plus d'intervalle : pour les travaux à la tâche, I'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit l'achèvement du travail (décret du 2 mai 1957).
Accidents du travail.
La législation sur la réparation des accidents du travail est applicable dans l'agriculture en Algérie dans les mêmes conditions qu'en métropole depuis 1922.
Par ailleurs, le décret du 5 octobre 1956 a étendu à l'Algérie les dispositions métropolitaines tendant à considérer comme accident du travail dans les professions agricoles et forestières l'accident survenu à un salarié pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice versa dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
D'autre part, un décret du 18 février 1957 a prévu que devaient être considérées comme maladies professionnelles d'origine agricole en Algérie, Ies maladies mentionnées sur les tableaux établis en métropole, c'est-à-dire tétanos, ankylostomose, spirochétose, charbon, tularémie, etc...
Amélioration du régime d’assurances sociales.
Un décret du 28 mai 1957 a homologué une décision du Gouverneur Général de l'Algérie en date du 24 avril 1957 qui a apporté au régime agricole des assurances sociales, des améliorations permettant de garantir plus largement les assurés sociaux agricoles et leur famille contre les risques sociaux en ce qui concerne :
1°) L'organisation administrative :
- représentation paritaire des employeurs et des salariés dans tous Ies organismes de, gestion des caisses ;
- organisation d'une tutelle administrative par l'agrément des caisses et la communication des procès-verbaux des conseils d'administration aux inspecteurs des lois sociales en agriculture.
2°) Les prestations existant antérieurement (assurances, invalidité, maternité, décès) :
les prestations concernant ces assurances sont calquées sur celles du régime général.
3°) Les prestations nouvelles :
a) Le texte institue une assurance-maladie sur les bases ci-après :
- consultations médicales dans les centres de médecine collective et les consultations externes des hôpitaux;
- si le malade ne peut se déplacer l'assuré social s'adresse à médecin de son choix ;
- dans les deux cas, couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'analyse de laboratoire et de radiologie pour l'assuré social et les membres de la famille ;
- en outre, l'assuré social se trouvant dans l'incapacité de travailler ou de reprendre son travail a droit, à compter du onzième jour et pendant six mois, à une indemnité journalière égale au demi-salaire.
b) Le même texte apporte certains aménagements à I'allocation aux vieux travailleurs (notamment secours viager à la veuve) et institue une allocation de vieillesse en faveur du salarié justifiant au minimum de dix années et au maximum de trente années d'assurances ou assimilées.
Cette assurance-vieillesse est accordée à soixante ans et est égale au maximum à une fois et demie le montant de l'allocation avec des possibilités de majoration pour conjoint à charge et pour charges de famille ; elle comporte le maintien de certaines prestations d'assurances sociales (assurance-maladie) et une reversion de moitié sur la veuve.
Les améliorations résultant de la décision du 24 avril 1957 modifient sensiblement la structure du régime agricole des assurances sociales qui tend à se rapprocher du régime des salariés du commerce et de l'industrie.
Cette réforme s'inscrit ainsi dans le cadre des mesures de progrès social qui doivent contribuer à l'amélioration du niveau de vie des à masses rurales.
Algérie 1957, ministre de l’Algérie
|
|
UN SEUL CLUB EN ALGERIE :
LA PELOTE BASOUE
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°182 - février 2010
|
Seul club de la région à pratiquer le jeu de la pelote basque et ce dans des conditions hors du commun, I'Oranaise était, de fait, maîtresse absolue des règles afférentes à cette discipline dans son sein.
Utilisant comme fronton I'un des grands murs d'enceinte du Château neuf et comme pelotes des balles de tennis percées afin de limiter les rebonds capricieux, faute de possibilités de recul appropriées, la spécificité de l'Oranaise était qualifiée de main nue, appellation dans la réalité non concordante avec celle officiellement en vigueur et qui exige I'emploi de pelotes dures recouvertes de cuir, d'un poids de 95 grammes.
Ainsi aux 7 spécialités reconnues dans I'ensemble des provinces basques s'ajoutait une huitième originale qui présentait l’inconvénient majeur de ne pas permettre pratiquement toute rencontre avec un autre club.
L'absence de comite départemental ou régional, la non-affiliation à une fédération, la non-délivrance de licences sportives, tout cela en définitive, incitait à I'exercice de ce jeu les quelques centaines de sociétaires réellement actifs notamment ceux d'entre-eux dont les vacations de travail revêtaient un caractère particulier (télécommunicants, cheminots, etc... ) et qui, de la sorte, bénéficiaient de la disponibilité du champ de jeu dans certaines tranches horaires.
À la longue de nombreux débutants séduits devenaient des joueurs impénitents, s'entraînant assidûment non seulement pour un plaisir renouvelé mais également parce que stimulés par la mise en compétition, à intervalles variables, d'une coupe offerte par un sociétaire, une personnalité ou le comité du club. Et originalité, tant à I'occasion des préparations que des matches, toutes les catégories d'âge se confondaient s'opposant même parfois volontairement.
Parmi la cinquantaine de participants à ces concours figuraient en forte proportion des adeptes d'une autre discipline, pour eux principale ( football, athlétisme, natation) et qui recherchaient le maintien de leur forme physique tout en trouvant là une matière à divertissement. Et aussi quelques novices à qui s'offrait l'évaluation de leurs possibilités dans la branche.
Conscient que cette dernière ne pouvait que vivoter en raison de ses règles spéciales liées aux particularités du champ de jeu, et du faible intérêt témoigné par la masse de la population sportive manquant de commodité pour assister à des compétitions de surcroît exclusivement inter-sociétaires, d'autre part, le comité de I'Oranaise s'efforça d'éviter que cette discipline ne périclite.
Malencontreusement ses choix en vue de l'obtention d'un emplacement adapté demeurèrent sans aboutissement par suite d'une insuffisance en moyens financiers due notamment à l'absence de spectateurs payants.
L'Oranaise, doyenne des associations sportives d'Afrique du Nord fut, en définitive, victime de sa fidélité à ses locaux d'origine dont I'inextensibilité était de plus en plus marquée à mesure que s'ajoutaient des branches sportives.
Paul Oliva
|
|
| MOUCHARDAGES
De Jacques Grieu
| |
Le surnom de «la mouche », depuis avant Molière,
Distingue un chaland, qui, sans en avoir l’air,
Espionne, observe, écoute ; et a donné « mouchard ».
C’est donc un délateur, rapporteur; un lascar.
La pauvre drosophile n’est pour rien là-dedans,
Mais sans doute est victime de son vol agaçant…
Sous le soleil d’été vibre l’irritant murmure :
C’est la mouche en plein vol, infime créature,
Dont l’aile bourdonnante fend l’air avec entrain,
Toujours à la recherche d’un incertain destin.
Une miette de sucre brille : ô festin triomphant,
Et son vol capricieux s’y pose goûlument.
Elle s’agite, elle tourne et à table s’installe,
Surveillant du coin d’œil la main inamicale.
Nul poids dans ses pensées, aucune loi ne l’arrête ;
Elle savoure de nos règles la tolérance discrète.
Sur le plafond, la vitre, elle fait sa promenade
Et de la pesanteur se fait une rigolade…
Et donc notre « mouchard » qui marche sans visage
En serviteur zélé d’un douteux héritage,
Prend note, ratisse et vend, mais toujours pour la Loi
Et prétend que trahir, c’est défendre un bon droit.
Son oreille va traîner jusqu’aux places publiques,
Les rumeurs des faubourgs, les serments politiques.
Le mouchard doucereux épie nos inquiètudes
Pour bâtir tous ses pièges en bonne certitude.
Son regard est de verre mais sa main délatrice
S’honore de renforcer le cours de la justice.
Sous ses rapports de glace, les consciences s’inclinent,
Et la peur fait régner le froid des disciplines…
Toujours prêt à servir, le zélé mouchard veille,
Il tend sa fine oreille sitôt qu’un mot l’éveille.
Cet investigateur du verbe et du soupir
Ne vit que pour nous ouïr en espérant médire.
Il feint la bienveillance et, mine de rien, glane
Un aveu, un éclat, et qu’ensuite il profane.
Alors, grand « dénonceur », l’ordre a son chevalier ?
Sans lui, que deviendrait le doux art d’espionner ?
Jacques Grieu
|
|
|
Un Suisse orientaliste d’avant-garde :
Jean-Etienne Liotard
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°182 - février 2010
|
Né en 1702 à Genève où il est mort en 1789, Liotard, est un peintre genevois, suisse d’origine française (son père joaillier à Montélimar, s’était réfugié à Genève pour échapper aux persécutions religieuses). Jean-Eienne Liotard a débuté ses études à Genève, chez le miniaturiste Daniel Gardelle (1653-1753) puis dés 1723 à Paris avec Jean-Louis Petitot (1692-1730), dont il copie les émaux et les miniatures avec une remarquable compétence. Il échoue au prix de Rome, mais il se fait une réputation de portraitiste.
Il étudie sous la direction de François Lemoyne et Jean-Baptiste Massé (1687-1767) qui le recommande au marquis de Puysieux auquel il s'attache et qui I'emmène en Italie, à Naples. En 1735 il est à Rome où il peint les portraits du pape Clément XII et de plusieurs cardinaux. De là, il part pour un voyage en Orient dans la compagnie d'un noble anglais, le chevalier Ponsonby (1738-1743). Après un séjour à Constantinople, au cours duquel il fait de nombreux dessins (Louvre et Bibliothèque nationale, Paris).
De retour à Vienne en 1742 où il fait les portraits de l'empereur François 1er et de l’impératrice Marie-Thérèse qu'on cite parmi ses chefs-d'œuvre. En outre, il peint le portrait en pied de la Belle Chocolatière, son œuvre sans doute la plus célèbre (musée de Dresde). Il se rend ensuite à Venise, Darmstadt, Lyon, Genève, avant de se fixer cinq ans à Paris (1748-1753), où les commandes qu'il reçoit de la Cour et de l'aristocratie ne peuvent faire qu'il soit accepté à l'Académie.
Ayant adopté le costume oriental, avec sa barbe et son turban, il est surnommé "le peintre turc ", et a un grand succès auprès de la Cour. En 1744, il se rend en Angleterre où il a peint la princesse de Galles en 1753. En 1756, il passe en Hollande où, l'année suivante, il épouse Marie Fargues.
De nouveau en Angleterre en 1772, son nom figure parmi les exposants à I'Académie royale dans les deux années suivantes avant de revenir à sa ville natale en 1776.
Liotard était un artiste très polyvalent et, bien que sa renommée dépende largement de la grâce et de la sensibilité de ses pastels, dont la Liseuse, la Belle Chocolatière et la Belle Lyonnaise à la Galerie de Dresde sont d'agréables exemples, ses peintures en émail, ses gravures sur cuivre et sa peinture sur verre sont également dignes d'attention critique. Collectionneur expert de peintures par les anciens maîtres, il est également I'auteur d'un Traité sur l'art de la peinture.

Il a vendu à des prix très élevés plusieurs des chefs-d'œuvre qu'il avait acquis lors de son deuxième séjour en Angleterre.
Les musées d'Amsterdam, de Berne et de Genève sont particulièrement riches en exemples de ses peintures et pastels. Le Louvre possède 42 de ses pastels.
Le Musée Albert and Victoria possède un tableau d'un Turc assis et le British Museum possède deux de ses pastels.
Un portrait de I'artiste se trouve dans la Sala dei pittori de la galerie d'Uffizi de Florence.
J-M L
|
|
PHOTOS des métiers
Envois de divers
|
|
| COMPLICATION
De Jacques Grieu
|
Dans les replis d’un monde chaque jour plus compliqué,
Tout se noue et s’installe dans la fragilité.
Au fil des bonnes raisons, l’esprit part de travers
La réflexion s’égare et part dans le dévers.
Il faut dire que l’info dont on est bombardé
Avive ce sentiment sur nos nerfs excités.
Les choses qu’on croyait simples, deviennent alambiquées
Où la pléthore d’options frôle l’absurdité.
Ce qui paraissait clair, pour tout, fait hésiter ;
Notre jugement s’embrouille et nos pensées déviées,
Font qu’on avance en biais et que chaque décision,
Est un choix cornélien pris dans la confusion.
Les données les plus simples sont remises en question
Et même la nature subit la contagion ;
Au fur et à mesure qu’on cerne la matière,
On la voit plus complexe, plus compliquée qu’hier.
Le vivant n’est pas plus à l’abri de cette crise
Car la science, constamment, l’enchevêtre et l’attise.
La sophistication, la spécialisation
Et … l’administration, aggravent cette sensation.
Le « tout blanc », le « tout noir », sont partout remplacés
Par des milliards de gris aux nuances entortillées.
L’analyse des choix augmente la pression
Et rend plus difficile la juste adaptation.
Cette complexité ne valorise rien ;
Elle rend tout plus ardu et donc bien plus lointain...
Ce qui est Vérité ne l’est qu’à un moment
Alors, de tout on doute sur un sable mouvant.
Les jeunes ne sont plus équipés pour ce monde
Dont la complication les dépasse, les inonde.
Rares sont ceux qui conquièrent les armes nécessaires,
Pour venir s’insérer dans la vie qu’on leur sert.
Aristote et Platon nous expliquaient la vie :
Les IA, les Facebook nous la complexifient.
Que dirait Confucius d’Apple ou de Tiktok ?
La réponse… compliquée, tout le monde s’en moque !
Jacques Grieu
|
| |
SOUVENIRS D’ALGER EN 1841
(Extraits du Journal d'un voyage en Algérie.)
Gallica : Revue de l’Orient 1844-1, pages 237-250
|
TRAVERSÈE DE TOULON A ALGER. - PROMENADES DANS ALGER, - LE COLONEL MARENGO ET LES CONDAMNÉS MILITAIRES.
Le 19 octobre (mardi), à six heures et demie du matin, je me rends au port et m'embarque à bord d'un bateau à vapeur de la marine royale, où l'on m'a retenu une place.
Le temps est superbe, et la rade de Toulon parait dam toute sa splendeur ; deux grands bateaux à rames, conduits par des galériens, et partis de l'arsenal, amènent bord une troupe d'hommes, de femmes et d'enfants. La plupart des hommes sont des militaires appartenant à différents corps, artillerie, infanterie, cavalerie, pionniers, et parmi eux un assez grand nombre sont destinés aux corps disciplinaires et à la légion étrangère. Quelques-uns se distinguent par leur mauvaise mine, leur figure trop expressive les Galériens qui les transportent ne peuvent s'empêcher de rire, en pensant que beaucoup de ces passagers ne valent pas mieux qu'eux. Je rends visite au commandant. La dunette et le gaillard d'arrière sont réservés aux officiers les soldats, les paysans et les autres passagers encombrent le pont, sur le gaillard d'avant. Quelques-uns uns de ces voyageurs paraissent très-souffrants et à demi morts. Je vois trois ou quatre pauvres diables qui se gorgent de figues vertes. Un vieux petit rachitique, modèle de misère et de difformité, véritable Quasimodo, se tient à côté de sa jeune mais dégoûtante moitié, qui allaite de sa mamelle flétrie le fruit de leur tendre amour. Il y a quelques dames, parmi lesquelles plusieurs actrices, accompagnées de leurs camarades. Des Zouaves, des Zéphyrs, quelques colons allemands, forment partie de la population de l'avant. Un officier distribue des couvertures grises aux soldats, qui se les arrachent, pour s'en couvrir pendant la nuit. Il y a environ 300 militaires. Nous sommes en retard, parce qu'on n'a pas envoyé l'état des passagers ; le commandant pourrait ne pas admettre un seul homme à son bord avant de l'avoir reçu.
Il arrive enfin. A neuf heures nous partons. Je dis adieu à la rade de Toulon ; nous passons devant le fort Lamalgue, nous doublons le cap Sépé, et nous pointons vers le sud. Le temps fraîchit et la mer devient houleuse.
Pour la première fois de ma vie je ressens un peu de mal de mer.
A bord, je suis bien installé dans le carré du commandant ; ma chambre est assez grande, bien éclairée outre ma couchette, j'ai trois chaises, un secrétaire, et son cabinet de toilette.
C'est un spectacle curieux que celui d'un bateau à vapeur qui porte en Algérie tant de gens de pays, de mœurs, d'habitudes et d'intérêts différents. Une grande partie des militaires, et presque toutes les femmes, ont le mal de mer. Parmi ceux qui se tiennent encore debout, il y en a quelques-uns qui pérorent. Ce sont les loustics qui ont l'air le plus mauvais sujet, et autour desquels se groupent des imbéciles qui les admirent, et cherchent à les imiter. Un saltimbanque à moustaches, à bottes a éperons, à ceinture frangée, à veste à la hussarde, par-dessus laquelle il porte une vieille houppelande, guide sa famille en Afrique ; d'une main Il tient sa trompette, et de l'autre il berce un enfant.
Un vieux mari tient la tête de sa pauvre vieille femme, qui paye son tribut à la mer, au grand scandale des yeux, des oreilles et du nez. Le vent augmente de force, et nous avons grosse mer.
Le diner, à six heures, est simple et soigné. Je dîne avec le commandant et un commis de marine qui va en Afrique rejoindre son bateau à vapeur, et connaît passablement la chronique scandaleuse de Toulon.
Le lieutenant du bord est de Toulon; il est doux, cause bien, et à de bonnes manières il est d'origine normande.
Couché à huit heures. La mer est très-forte, et je suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit par les violentes secousses qu'éprouve le bâtiment.
20 octobre (Mercredi). Lever à sept heures. Le vent continue à souffler nord-ouest. Nous allons à la voile et à la vapeur, et filons six nœuds. Nettoyage de tout le bâtiment. Toilette du matin des passagers. A une heure, le vent tourne au sud. Air chaud et lourd. -L'horizon se couvre de vapeurs. Nous n'avons pas vu une seule voile depuis Toulon. A trois heures nous sommes encore à dix lieues des îles Baléares, et nous voyons déjà quelques oiseaux de mer quelques marsouins paraissent aussi à la surface des flots. A trois heures et demie, nous apercevons, à l'ouest, les îles Baléares que nous laissons à notre droite. A quatre heures, nous ne sommes qu'à neuf milles de l'île Minorque, et nous distinguons le Pic (Monte Toro) qui domine la ville de Mahon, et au sommet duquel est un couvent. Les terres de l’île sont peu élevées, et se prolongent vers le sud, sous la forme d'une langue, au-dessus de l'horizon; elles sont entourées de brumes.
J'assiste à la distribution des vivres faite aux passagers militaires et autres dits rationnaires qui ont le passage gratuit et reçoivent la ration du bord : à un signal donné, ces gens se distribuent par escouade de douze. Un contre-maître donne un billet au chef de chaque escouade pour avoir les rations qui lui reviennent ces gens se rangent par groupe, en cercle, sur le pont.
On apporte au centre douze biscuits de mer, puis un petit baquet rempli de pois, haricots, et gourganes ( fève sèches ). Le chef de l'escouade donne un biscuit à chacun de ses hommes qui puisent avec une cuiller à la gamelle, et reçoivent leur ration de vin dans une petite tasse de fer blanc, dont ils sont munis. Ces aliments sont grossiers, mais paraissent bons; seulement, comme on vomit dans des baquets semblables à ceux de la soupe, l'aspect de cette soupe donne mal au cœur aux délicats.
Dans chaque escouade, qui se ressemble s'assemble nous en avons remarqué deux surtout, l'une composée de disciplinaires, et l'autre de certains paysans Allemands, qui par leurs gestes, leurs propos, l'expression de la physionomie, leurs sales plaisanteries, leur langage, mêlé de termes d'argot, ressemblent à de vrais bandits ou à des échappés du bagne; mais il faut rendre justice aux autres groupes: leurs rationnaires étaient tranquilles, honnêtes entre eux, et faisaient contraste avec les précédents.– L'ancien hussard qui se rend à Bone avec sa femme et son enfant pour y exercer la profession de maçon, sonne le boute-selle, afin de divertir les passagers ; effet prodigieux de la trompette sur l'équipage. Nous dînons chez le commandant conversation sur l'Algérie et nos colonies. Pendant le dîner, des dames passagères dansent sur le pont au son de la flute. – Ciel étoile. – Mer phosphorescente, air doux, belle nuit d'été.
21 octobre, jeudi. La nuit a été calme ; levé à sept heures. Les troupiers et les Allemands chantent en chœur, et assez juste. -Je visite la machine, elle est d'usine française, de la force de 160 chevaux ; - il y a six fourneaux et neuf chauffeurs. Les chauffeurs ont chacun deux fourneaux à soigner et se relèvent toutes les trois heures. Nous, nous aidons des voiles, et nous faisons 2 lieues à l'heure. – Le bateau a en tout 75 hommes d'équipage.
Il y a de Toulon à Alger 130 lieues de marine, environ 180 lieues de poste. Le trajet se fait entre soixante-quatre et soixante-dix heures. Les îles Baléares se trouvent à peu près à mi-distance de ces deux villes.
A neuf heures, un brick sous voile apparaît à l'est sur l'horizon. A dix heures, nous en voyons un second à l'ouest, et à trois heures un troisième à l'est.- Les cancans de Toulon et ceux du bord.- Une actrice se fâche avec son jaloux de mari, le cajole et se raccommode;elle ressemble un peu à la Grisi, mais est moins bien. La plupart des femmes du bord sont des femmes des militaires ou d'employés de l'Algérie. La soirée est délicieuse, la mer un peu houleuse, mais le ciel pur et .le vent chaud. Les passagers font un concert. La dame émule de mademoiselle Puget. Le lieutenant de chasseurs d'Afrique guitariste. Le couché a lieu par escouade.
Les femmes sont plus difficiles au coucher que les hommes. A onze heures et demie du soir, on aperçoit le phare d'Alger.
22 octobre, vendredi. A une heure et demie du matin, nous voyons à droite la pointe et les terres assez élevées de la Pescade, devant nous, le phare, et à gauche, une longue ligne de terres basses. - Nous hissons nos feux.
Un coup de canon avertit le pilote de se rendre à bord, et dans un instant, malgré la force de la mer, il vient à nous dans un petit canot, monté sur le pont, conduit notre navire, et à trois heures du matin, nous mouillons au milieu du port qui est ouvert aux vents de nord-est et de l'est, malgré le môle et la jetée qu'on construit pour briser la force des vagues.
Comme la nuit est encore assez noire, et qu'on ne distingue que difficilement les objets, je retourne à ma chambre et dors jusqu'à sept heures.
En montant sur la dunette, on jouit d'un très-beau spectacle. Alger ne ressemble à aucune des villes que je connais ; elle s'élève en pyramide à une grande hauteur. Ses édifices et ses maisons de forme carrée, à pans droits et terminées par des terrasses, munies de petites fenêtres, s'élèvent les unes au-dessus des autres et paraissent superposées. La couleur blanche éclatante de leurs murailles, teintées d’un jaune brunâtre par place réfléchie par la lumière du soleil, fatigue la vue. Elles se dessinent d'une manière crue sur un ciel de d’azur le plus pur. Cette coloration a été parfaitement rendue par plusieurs de nos peintres, et par Gudin en particulier. –La ville est surmontée par le château fort où la Kasbah, près de laquelle on voit quelques touffes d'arbres ; quelques palmiers lèvent aussi à de rares distances entre les maisons. Le port est couvert de navires marchands de toutes les nations ; ceux du commerce qui mouillent au-dessous de la place du Gouvernement mal abrités. A droite, nous voyons le bâtiment de la Marine, au-delà duquel se prolonge la jetée, et un peu plus loin le phare qui est à éclat et projette ses feux à plus de dix lieues en mer. A gauche est la Maison-Carrée, occupée par une faible garnison de ce côte, les terres sont basses et se terminent par le Cap Matifou ; au-delà, s'élèvent une suite des montagnes dont les contours aigus, bleuâtres et vaporeux bornent l'horizon : ce sont les collines du Sahel, et plus vers le midi, les sommets du petit et du grand Atlas.
A huit heures, on débarque les passagers ; on commence par les militaires et les rationnaires, qu'on entasse successivement au nombre de 120 ou 130 dans chacun des grands chalands ( il y en a trois), qui sont remorqués par une petite barque où rament des Bédouins. Ils partent en chantant la Marseillaise. Ils sont d'une gaieté que malheureusement ils ne conserveront pas longtemps.
Je prends congé du commandant et des autres officiers, et à neuf heures, nous débarquons. La douane nous visite à peine et s'en rapporte à notre parole. On timbre nos malles en grosses lettres rouges, et un Maltais, chargé, de mes effets, monte rapidement les rues escarpées et tes escaliers qui mènent à la place du gouvernement et à l’hôtel de l'intendance, vaste et belle maison, où je m'installe. C'est le meilleur hôtel d’Alger.
Visite au marché. C’est là qu'il faut aller pour voir la réunion des figures, les plus hétéroclites, des costumes les plus variés, les plus bizarres, les plus grotesques ; le marché est pour un étranger un véritable bal masqué où abondent les deux sexes de tout âge et de toute condition. Il se tient sur une place à gauche de celle du gouvernement et dans les rues adjacentes.
Les marchands, hommes et femmes, sont assis ou accroupis sur le sol, et devant eux, sont étalés les denrées qu'ils vendent. Parmi les marchands, on voit des Maures, des Turcs, des juifs, des Maltais, des Espagnols, et quelques Français ou Françaises. Les légumes et les fruits y abondent : ils sont beaux et pas très cher. Les transactions comme commerciales se passent assez doucement seulement les acheteurs et les marchands, ne s’entendent pas de langage, s'entendent difficilement pour les prix, et sont souvent obligés de compter par leurs doigts. Les acheteurs me paraissent plus marchander que les vendeurs ne surfont. On trouve là tous les fruits et légumes de nos climats, des choux, raves, pommes de terre, tomates, haricots verts, salade de diverses espèces, patates, betteraves, et parmi les fruits, belles pommes, poires, raisins, citrons, limons, jujubes, grenades, etc.. Dans d'autres endroits sont les marchands de volaille, d'œufs, du gibier, ou les vendeurs de graines, de fécule, de semoule, etc..
On peut dire, qu'en général, vendeurs et acheteurs, ne sont ni beaux ni propres, presque tous sont de la plus dégoûtante malpropreté marchent nu-pieds ou chaussés de mauvaises babouches sales. Presque toutes les physionomies portent l'empreinte de la brutalité, de la stupidité, de l'astuce et de la férocité ce sont de vilaines espèces, et le ramassis, l'immondice des races auxquels ils appartiennent ajoutez à cela une foule de mendiants, couverts de haillons, de dartres et de vermines, et vous aurez une idée du marché d'Alger.
Poissonnerie. – Elle est abondamment fournie, et le poisson n'y est pas cher. La plupart des poissons et coquillages sont nouveaux pour moi et étrangers à nos côtes; parmi ceux de connaissance, je remarque des vignots, des huîtres, des bernard-l'ermite, de fort belles crevettes qui sont excellentes, des raies,, de petits thons, beaucoup plus petits que ceux des côtes de Provence, et dont la chair est moins rouge, d'énormes rougets, des daurades, des tortues de mer énormes qui se débitent comme ta viande de boucherie, des roussettes, le requin-marteau que l'on dépouille et débite aux pauvres gens, des homards d'une forme particulière, des seiches, des poulpes, de petits poissons blancs très-allongés, des sardines fort belles à 4 sous la livre, des petites anguilles de mer. La poissonnerie est placée à gauche de la place du gouvernement, contre la mosquée.
Du côté de la rue, au devant de la mosquée, sont, les marchands de fruits étalagistes; leurs boutiques sont garnies de beaux fruits frais et secs ; ces marchands crient pour appeler les chalands, ce qui me rappelle tout à fait les marchands de Catania, avec lesquels ceux d'Alger offrent quelques points de ressemblance.
Place du gouvernement. Elle est vaste, occupe une position élevée, et de sa balustrade on jouit d'une admirable vue sur le port, le môle et la rade, jusqu'au promontoire Matifou. On l'a plantée l'année dernière en gros orangers qui paraissent avoir fort bien repris. Au milieu se trouve l’hôtel de l'intendance (ou de la Tour-Dupin ), à gauche le palais du dey puis une belle mosquée, dominant une batterie de 12 pièces de 24 ; à droite de ce vaste panorama, près de la Maison-Carrée, on voit l'Awach, rivière malsaine, près de laquelle on avait établi un camp qu'on a été obligé de lever à cause de son insalubrité.
Nous voyons un Imam à énorme turban entrer dans la mosquée, suivi d'une foule d'Arabes et de Turcs, qui tous en entrant retirent leurs babouches, qu'ils portent à la main.
Nous visitons les immenses magasins voûtés qui sont construits sous la place du gouvernement l'un est rempli de beau blé amassé en tas autour des piliers massifs qui soutiennent la voûte; l'autre est un entrepôt de vins.
Rues. Les nouvelles rues sont larges, bien alignées ; les maisons qu'elles séparent sont bien construites, à la française, et ornées de petites boutiques, comme seraient celles de nos villes de province. Les anciennes rues sont plus curieuses à visiter pour un étranger: elles sont étroites, tortueuses, obscures et fraîches. Dans quelques endroits, elles sont voûtées comme des passages. Le jour est, en quelque sorte, un accident pour les rues d'Alger. Dans beaucoup d'endroits les maisons se soutiennent mutuellement par des étais de bois; elles sont plus rapprochées en haut qu'en bas, de sorte que le soleil ne saurait y pénétrer qu'avec peine, et qu'elles sont fraîches pendant l'été et chaudes pendant l'hiver. Ces rues sont mal pavées, sales, souvent disposées en forme d'escalier à larges marches : elles sont occupées par une foule qui s'y presse comme dans les rues de Gènes.
La rue du Soudan, que nous visitons, peut être citée comme type des vieilles rues d'Alger ; ses maisons sont occupées par des boutiques étroites, obscures, dans lesquelles le marchand se tient immobile au milieu des marchandises les plus disparates dont il a le débit. Ce marchand sort comme un bouquet flétri au milieu des paniers de pommes, de raisins, ou de marrons dont il est entouré. Au marché, il y a des marchandes; dans les boutiques arabes je n'ai vu que des hommes. Les maisons, bâties d'une manière qui n'est pas sans élégance pour quelques-unes, sont percées de fenêtres étroites comme des meurtrières, à travers lesquelles on aperçoit de temps à autre l'œil ! ou le visage de femmes, dégoûtantes sirènes qui, par leurs chants monotones, attirent les hommes ; et il n'en manque pas à Alger.
Nous visitons le bazar du Divan ; il est nouveau, assez beau et bien éclairé ; au milieu, il y a un bâtiment carre, colonnes, colonnettes, et galerie au premier étage; la voûte est en verre. Architecture mauresque fort élégante. Ce bazar est occupé par des Maures qui tiennent des boutiques de tailleurs, de passementiers, etc. Les types des hommes et des enfants sont beaux. Les femmes sont volées, mais ont de beaux yeux noirs. Les Maures et les juifs teignent en rouge les cheveux de leurs enfants, et les jeunes femmes se teignent les ongles de la même couleur.
Nous montons la rue Neuve, qui est fort vieille, et conduit à la porte du même nom. Celle-ci est occupée par un poste de la garde nationale, que l'on excède de factions à Alger. Cette porte, placée au-dessous de la Kasbah, domine toute la rade d'Alger, et de là nous voyons les collines voisines qui sont arides et couvertes seulement d'agaves et de cactus. Beaucoup de maisons sont en démolition. Elles étaient construites en pierres, mais surtout en briques et en terre mêlée avec de la chaux pour ciment.
Ces constructions sont très-solides, et les murs fort épais. Nous traversons une partie de la cour de la Kasbah à laquelle je ferai d'autres visites, et nous redescendons par la rue de la Kasbah. Beaucoup des maisons y sont occupées par des filles publiques, dont le costume est très-diversifié.
Nous voyons dans une boutique un fabricant de pipes turques il a deux demi-moules, il met entre eux une masse de terre glaise rouge, les rapproche, les presse par une pièce de bois, puis introduit au milieu un cône en bois, destiné à creuser le foyer central de la pipe et un morceau de bois dans le trou réserve pour le tuyau la pipe est faite. Il enlève les bavures, la fait sécher, et cuire ensuite.
Plus loin nous remarquons un tourneur d'anneaux et de ronds de serviette en corne il est assis sur son derrière de la main droite fait aller l'archet pour mettre sa pièce en rotation, il tient de la main gauche l'instrument tranchant, qu'il fixe et dirige avec le gros orteil du pied droit.
Les noms des rues sont très-variés je retiens les noms de Barberousse, de Sophronisme, de Charles-Quint, du Teinturier ; elles sont mal étiquetées ; quelques-unes portent des noms en français et en arabe.
Nous entrons dans le tribunal et nous voyons le cadi assis devant son pupitre, couvert de vieux bouquins ; il n'y a pas de cause en ce moment.
Nous sommes dans le Ramadan, et les imans, du haut des tours ou minarets, appellent toutes les heures les fidèles à la prière. C'est pendant le Ramadan que les Maures font jouer dans leurs cafés le fameux Garragousse, héros fantastique, le roi des Ribauds, dont on ne voit que l'ombre, car ce spectacle ressemble à nos ombres chinoises. Garragousse se fait voir dans beaucoup de cafés, qui sont, pour les Maures, ce que sont les musicos pour les Hollandais.
Nous montons la rue de la Kasbah à sept heures et demie du soir, et nous visitons le café Grec, appelé par les Arabes le café Le Pucelle ; on monte un petit escalier, et on entre dans une grande chambre carrée, autour de laquelle sont des bancs garnis de Maures, d'Arabes, de Kabyles, de juifs, qui fument, boivent du café, écoutent la musique, et regardent le spectacle qu'ils ont sous les yeux. Le comptoir du cafetier, tenu par une femme vêtue à l'européenne, est près de la porte, et chaque visiteur, en entrant, paye 5 sous, et a droit à une tasse de café ou à un verre de limonade. II fait une chaleur étouffante l'atmosphère est obscurcie par des nuages de fumée de tabac. Les musiciens sont placés sur une espèce de théâtre ou d'estrade, et richement vêtus; au milieu d'eux, comme Apollon au sommet du Parnasse, se tient un beau et superbe Maure, à la peau brune, aux yeux noirs de jais, qui joue d'un gros violon qu'il tient comme une basse. De chaque côté sont deux musiciens qui jouent de la mandoline, du tambour de basque, et, à droite tout à fait, une grande et forte Mauresque, à visage découvert, qui, avec sa main droite, frappe sur un petit tambourin; elle chante d'une manière cadencée et monotone un air qui me semble toujours le même, et parait faire plaisir à ses nombreux auditeurs. De temps à autre, elle donne quelques coups d'un petit sifflet, puis recommence son éternelle psalmodie, qu'accompagne la musique. Cette femme est colossale; elle porte des feuilles d'or collées sur le nez et les joues. Son costume est brillant. Sa face est large, ses lèvres épaisses, et en chantant, elle tient habituellement la main gauche sur sa bouche, par pudeur.
Elle fume presque continuellement un cigare, et fréquemment se rafraîchit avec un verre d'absinthe. Dans le fond de la salle est une pièce séparée par une cloison jour, et destinée au spectacle de Garragousse, espèce de Robert-Macaire maure, dont le compagnon ou Bertrand est toujours en scène. Les deux héros ont des nez énormes ; les autres personnages sont la femme de Garragousse, des femmes juives, des gendarmes, etc. ( il nous est impossible d'exprimer le trait le plus saillant du personnage de Garragousse, ni la nature des scènes qu'il représente.) Les figures ont environ 8 pouces; elles sont mal devinées ; leurs membres sont mobiles, et ceux, qui les font mouvoir, et simulent les dialogues, ont une grande adresse pour faire agir leurs personnages ; des éclats de rire continuels partent de chaque partie de la salle. Ce sont les étrangers qui rient le moins. Rien de plus ignoble, de plus dégoûtant que ces scènes de Garragousse; le cynisme le plus crapuleux y est mis sous les yeux des spectateurs ; et, pour la honte des femmes, quelques juives et Mauresques assistent et rient à de semblables turpitudes Sodome et Gomorrhe ne devaient avoir rien de mieux; et je commence croire qu'Alger mérite le nom qu'on lui a donné, de bagne en liberté.
Nous sortons de ce triste lieu, et en passant, nous voyons encore plusieurs cafés Garragousse, dont les scènes s'aperçoivent de la rue. La police française a voulu supprimer ces spectacles, mais on lui a conseillé de n'en rien faire, les Maures y tiennent beaucoup Le spectacle de Garragousse a été défendu en 1842. Les autres cafés maures sont des boutiques de forme longue, étroites, voûtées, sans fenêtres, et autour desquelles sont des bancs sur lesquels les musulmans fument et prennent le café ; à l'extrémité se tient un conteur, un chanteur et un joueur d'instrument.
Le haut de la ville d'Alger est occupée surtout par les Arabes, et le bas par les Européens. La ville est assez mal éclairée.
(Après avoir employé trois jours à visiter la cathédrale, les deux synagogues (ancienne et nouvelle), le théâtre, l'hôpital du Dey, l'hôpital de la Salpetrière et quelques autres établissements d'Alger, le voyageur consacra la journée du 26 octobre à rendre visite au colonel Marengo, aux prisons et aux ateliers de condamnés militaires que ce digne colonel a organisés avec tant de succès, et qui témoignent qu'on peut, sans le supplice de l'emprisonnement solitaire, et par le seul usage de la discipline et du travail, moraliser des hommes qui ont failli aux lois de la société, et qui ont été condamnés comme criminels.)
Le gouverneur militaire de la ville d'Alger, vieux soldat des armées impériales, le colonel Marengo, par la discipline qu'il a introduite chez les condamnés militaires, par les habitudes d'ordre et de travail qu'il leur a incrustées, est parvenu à améliorer d'une manière remarquable des gens pervers, tandis que presque tout ce que nous envoyons de bon en Algérie se détériore parte désordre et le relâchement qui existent dans la colonie. La justice seule du colonel Marengo égale sa sévérité aussi est-il autant aimé que craint. Il fait de ses hommes tout ce qu'il veut, il semble les conduire par la force magnétique de son regard. Ponctuel à son service, il donne l'exemple du devoir ; et, dans des occasions difficiles, il a armé ces condamnés, a marché à leur tête, a rendu d'importants services à l'armée, et a ramené tous ces hommes heureux et satisfaits, et sans qu'il en manquât un seul. Une portion de ces hommes est actuellement en campagne. Les condamnés sont toujours prêts à être armés, et ils ont, dans des occasions périlleuses, accompagné des convois, porté les blessés sur les brancards, de grandes distances ( Il faut douze hommes pour porter un blessé, parce qu'ils sont souvent obligés de se relever). En campagne, les condamnés conservent leur coutume, ils sont seulement munis d'une giberne fixée au devant de leur ceinture et d'un fusil.
Le colonel Marengo est encore dans la force de l'âge : il est l'œuvre de lui-même, ne s'occupe que de son affaire, a fait exécuter les travaux les plus remarquables aux condamnés, a considérablement amélioré leur régime, leur hygiène, qu'il entend parfaitement, et me para!t mieux comprendre la colonisation que nos phraseurs qu'on envoie de France en un mot, son petit gouvernement peut être cité comme un modèle. Le colonel me fournit des renseignements sur le régime des prisons militaires, et sur les condamnés qui sont logés dans le Fort Neuf et dans le fort de vingt-quatre-heures
Il modifie le régime des condamnés en été et en hiver. Les soins sont admirablement entendus, relativement au lever et au coucher, au travail et au repos, aux vêtements, à la literie, à l'alimentation, aux exercices et aux distractions. – Malades, le colonel les envoie à l'hôpital ; de retour, il a pour eux une maison de convalescence, située sur le penchant d'une colline, où ils respirent un air frais et pur.
Il y a deux prisons militaires, l'une pour les officiers, l'autre pour les soldats elles sont placées dans la même rue, vis-à-vis l'une de l'autre.
Nous sommes conduits par un officier, qui recommande au geôlier, militaire allemand, de nous faire visiter tout en détail.
Prison des officiers : Elle est placée en haut de la maison au-dessus des terrasses sur lesquelles les prisonniers peuvent se promener; elle est saine, bien aérée, et très-propre; elle peut contenir huit dix prisonniers ; iI n'y en a que deux, un jeune prince de cavalerie qui, par la lecture, prend son temps en patience, et dans une petite chambre un chef arabe de la province de Constantine, qui est couché et blotti dans sa toge comme un beau lion du désert : il en a la tête, le poil et le regard.
Un ami qui m'accompagnait durant cette visite étant redescendu avant moi avec le geôlier, la porte se referme tout à coup, et me voilà, moi, prisonnier avec l'officier et l'Arabe. Le geôlier avait mal compris la parole de l'officier qui nous avait conduits, et il avait supposé que j'étais un officier qu'il fallait retenir par surprise, comme cela se pratique quelquefois pour les fous. Apres des explications, la porte se rouvrit pourtant, et je goûtai pour la première fois cinq minutes de captivité.
Prison des soldats : Placée en face de la précédente, elle pourrait à la rigueur, contenir 300 prisonniers ; elle n'en renferme que 260, qui sont déjà trop encombrés. Il y en a 10 à 12 à l'hôpital sur lesquels 9 Arabes.
Le préau est une cour carrée, dallée, autour de laquelle sont 8 cachots ouverts d'ans le jour, qui renferment chacun de 8 & 10 hommes. Ces cachots sont carrelés, propres, inodores, assez bien aérés les Arabes y sont mêlés avec les Français. Les salles des étages supérieurs sont numérotées, et renferment 20, 25, 30 ou 40 prisonniers. Les salles sont également propres et inodores; les prisonniers sont mieux vêtus que dans nos prisons civiles.
La prison des soldats renferme un atelier où y a actuellement 8 tailleurs, 13 selliers, qui travaillent pour la gendarmerie et l'artillerie. Chaque homme peut gagner de 60 a 75 cent. par jour.
Les prisonniers ont la ration de campagne, moins le vin.
Cette prison renferme les accusés et les condamnés. Un soldat français à la double chaîne, condamné pour vol avec effraction; un vieux nègre les fers aux pieds, condamné à mort pour avoir coupé le cou à un adjudant-major; un autre, accusé d'espionnage; quatre Maures de la province de Bone, condamnés à mort pour assassinat. Ils sont en appel.
Il y a, dans cette prison, une salle où languissent seize prisonniers femmes et enfants ; ce sont des prisonniers de guerre ils sont dans un état qui fait peine à voir. En entrant dans la salle, on croit pénétrer dans la loge d'une ménagerie ou l'on aurait entassé des animaux du désert accroupies, enveloppés de couvertures ou -de burnous sales, et tombant en lambeaux pâtes, décharnées, dans une tristesse profonde, la plupart tatouées au visage et affectées d'ophtalmie ces malheureuses créatures inspirent encore plus de pitié que de dégoût. Une d'elles est accouchée dans la prison, et son enfant nouveau-né, ficelé de vieux chiffons, comme une carotte de tabac, gît à coté d'elle sur la planche du lit de camp, et se trouve assailli par les mouches. Le Fort-Neuf placé sur les bords de ta mer, à droite de la porte Bâb-el-Oued servait de magasin de laines au dey d'Alger.
La partie basse du fort renferme les ateliers et les logements des condamnés ; on y descend par plusieurs escaliers; et de la cour, qu'arrosent de fraîches fontaines, on arrive au bâtiment, qui est carré et présente beaucoup de ressemblance avec la grande salle de l'hôpital de la Salpetrière. Les voûtes, soutenues par d'énormes massifs et piliers, sont à l'épreuve de la bombe.
Ce bâtiment renferme neuf salles qui, chacune, peuvent contenir 124 Hommes ; de sorte qu'on pourrait y loger 1200 hommes. - Il n'y a actuellement à Alger que 250 condamnés aux travaux ; le colonel Marengo en a envoyé environ 500 aux camps.
Il ne faut que 6 soldats pour garder les prisonniers du Fort-Neuf, et le service des condamnés d'Alger n'en demande qu'environ 30.
Les salles sont parcourues dans leur longueur par deux longues estrades en charpente, auxquelles sont fixés les hamacs des condamnes. Ces salles sont très-propres et inodores.
On remarque en outre dans le Fort-Neuf la salle d’enseignement mutuel, avec une chaire, des tables et des tableaux. Les condamnés y apprennent à lire et à écrire. Il y a 150 élèves.
La salle de récréation, avec prêche pour la lecture, est une grande salle voûtée, éclairée par des réverbères et garnie de bancs de chaque côte. Les prisonniers s'y rassemblent, ne sont jamais seuls, et sont ainsi préservés des mauvaises et honteuses habitudes auxquelles ils ne sont que trop enclins.
A l'extrémité de la salle existe une chapelle où l'on dit la messe, et que l'on ferme pendant la récréation.
Le théâtre : Le colonel a fait construire, à l'extrémité de la salle voûtée, un théâtre on les prisonniers s'exercent à l'art mimique. Il parait qu'ils y réussissent d'une manière remarquable; il y a des loges en bois et un parterre qu'occupent les condamnés.–Quelques jolies et grandes dames de la ville ont assisté plus d'une fois à leurs représentations.
Dans une des cours sont sept cabinets de latrines, sous lesquels passe un canal commun qui, du .temps des Maures, conduisait un courant d'eau.
- Le colonel a fait construire par les condamnés, au-dessus des latrines, dix cellules ou cachots pour les récalcitrants; ils sont presque toujours inoccupés.
La cantine. On y vend du pain, du fromage, du tabac, du papier, mais pas de vin ; celui qu'on donne aux condamnés est suffisant.
La cuisine. Elle est bien installée, dans un petit bâtiment nouvellement construit et accolé aux murailles du fort. Nous goûtons le riz, les haricots et le lard il sont bons. Les marmites jumelles en fonte qui y sont installées sont d'ordonnance.
Dans la cour d'entrée il y a d'énormes arcades soutenues par des piliers armés d'anneaux de fer auxquels les Turcs suspendaient leurs barques.
Le haut du Fort-Neuf, sur la terrasse duquel nous montons et où nous voyons plusieurs des boulets de marbre dont se servaient les Algériens est occupé par d'immenses magasins que le génie fait construire pour renfermer les blés, par une batterie de 15 pièces de carions, et par le magasin des armes que l'on donne aux condamnés quand on les envoie à quelque expédition, et qu'ils rapportent fidèlement après la campagne.
Les jardins des condamnés sont placés en dehors du rempart d'Alger, un peu plus loin que le Fort-Neuf de l'autre côté de la route. Jadis, l'emplacement occupé par ces jardins n'était que le versant d'une colline aride, traversée par un profond ravin, couverte de tombes arabes, d'agaves, de cactus, de palmiers nains et de broussailles. On a remplacé ces pentes, après avoir comblé le ravin, par de grandes et magnifiques esplanades, placées les unes au-dessus des autres et que soutiennent des murs secs, aussi bien construits que ceux de Faron ( à Toulon ), avec les pierres des tombes arabes. L'eau circule en abondance dans ces jardins, et sort jaillissante de plusieurs bassins pour fournir aux irrigations. Tous ces travaux ont été exécutés sous la direction du colonel Marengo, par tes condamnés : on se fait difficilement une idée de la quantité de terre qu'il a fallu apporter, de pans de montagne qu'il a fallu abattre pour établir et niveler ces jardins, dont la pente vers la mer se fait peine sentir. Le génie a estimés ces travaux à 800,000 F
Ces jardins se trouvent au-dessus de la grande route, dont ils sont sépares par une muraille et une haie de cactus épineux. Ou y arrive par une rampe douce, traversant une longue haie d'agaves alignés, nouvellement plantés, qui les sépare de la route de Bâb-el-Oued et la borde. En dehors de la muraille, à gauche, sous un massif d'arbres et de cactus est un petit cimetière arabe, que le colonel Marengo a fait restaurer, et auquel il a fait ajouter un petit monument à colonnes, sur lequel est une inscription indiquant que là se trouve un type de cimetière arabe. Les tombes, tournées vers le haut, formées de pierres carrées ayant la forme d'auge, sont très-simples et blanchies à la chaux. Une vieille femme vient lés blanchir très-souvent.
Les portes inférieures ou de mer des jardins, sont au nombre de deux : l'une, plus éloignée de la ville, est la porte d'Orléans ; l'autre, plus proche, par laquelle nous entrons, est ornée de deux pilastres de pierre, sur chacun desquels est une plaque en bronze, dont les inscriptions en relief indiquent que ces jardins sont ceux des condamnés, et invitent les visiteurs à les respecter. Ces plaques ont été moulées et fondues par les condamnes.
Sur la terrasse inférieure sont cultivés des légumes d'une fraîcheur remarquable. Il y a des allées et des berceaux de vignes qui ne sont plantées que depuis quatre ans, et dont le tronc de plusieurs ceps, a déjà plus de 2 pouces de diamètre.
Aux terrasses supérieures, les allées sont plantées, mais il y a encore beaucoup de plantations faire; nous voyons là croître avec vigueur les bananiers, les caroubiers, les cactus, les agaves, les aloès, les yuccas, les palmiers nains, les oeillets, les géraniums, etc.
Sur la seconde terrasse est le Belvédère du 14 juin 1830, sur lequel le colonel a fait placer une colonne, que, comme vieux grognard, il a élevée et dédiée aux braves de la vieille et de la jeune armée. Sur le piédestal sont sculptes, d'un côté le chapeau et l'épée de Napoléon, des autres, les noms de nos principales victoires et des capitales où nous avons porté nos armes.
Sur la terrasse supérieure se trouve un bassin, avec une grande vasque en marbre blanc. Cette fontaine existait à Alger, à l'endroit où est actuellement la place du gouvernement.
L'allée au milieu de laquelle jaillit cette fontaine aboutit, en haut, à la porte supérieure, et, en bas. se termine une estrade où le colonel doit placer un superbe buste en marbre blanc que le roi lui a envoyé.
Au-dessus des jardins des condamnés nous visitons un pauvre village arabe occupé par des potiers de terre rien de plus misérable et cependant de plus pittoresque que ce village ; c'est de l'Afrique toute pure.
Les cases des Arabes disséminés par groupes, peintes en blanc, bâties de pierre et de terre délayée, ne reçoivent le jour que par la porte et quelques petites fenêtres en meurtrières : elles sont sales et puantes, sans meubles ou plutôt misérablement meublées de quelques escabeaux en planches, de nattes, de vases de terre, de tours grossiers pour les potiers. - Sous des toits de chaume sèchent les cruches et les tuyaux de fontaines nouvellement fabriqués. En dehors de ces maisons, de petits porcs, des chèvres.
Pas de femmes, mais cinq ou six Arabes déguenillés et nous regardant comme des bêtes farouches. Tout cela au milieu d'un terrain accidenté, sévère, aride, où se dessinent seulement de distance en distance un beau palmier couvert de dattes qui ne mûrissent pas, des touffes d'agaves, de cactus ; d'énormes souches d'où s'élancent, dans toutes les directions, des tiges de palmiers nains dont les vertes aigrettes sont balancées par le vent. Voyez ce paysage, borné dans son court horizon par le sommet d'arides collines couvertes de broussailles, éclairé par un soleil brûlant et dominé par un ciel de l'azur le plus pur, et vous aurez une idée d'un paysage africain.
Nous allons près d'une grande carrière de pierres calcaires noires, très-dures, que les condamnés exploitent pour le service du génie et de la marine. La quantité de pierres qu'ils en extraient est réellement prodigieuse; on les voit travailler avec ardeur, faire ébouler les pierres, les brouetter, les entasser. Ils sont gardés par trois ou quatre factionnaires placés sur les hauteurs qui dominent la carrière; le tambour annonce la cessation des travaux et alors ils se rendent de toute part sur la route, où ils s'alignent en plusieurs pelotons séparés, sous la surveillance des soldats préposés à leur garde. Le tambour est un condamné.
Sur 1,200 condamnés, il n'y en a guère qu'une trentaine qui le sont au boulet ; les plus récalcitrants le sont au double boulet. Ce boulet pèse huit livres.–Le peloton de ceux condamnés au boulet n'est pas le plus mauvais ceux qui ne le portent pas sont bien plus coupables, ne devraient pas sortir de prison et c'est par grâce spéciale qu'on les envoie aux travaux, où ils reçoivent de 30 à 40 centimes par jour.
Ils partent tambour battant pour rentrer au fort de Vingt-quatre-heures. Au bas de la colline, nous voyons sept Arabes condamnés qui, font un nivellement. Ils portent un anneau de fer au pied ; ce sont des maraudeurs condamnés. Ils sont sous la surveillance d'un Français condamné lui-même au boulet ; vigoureux compère qui porte 800 livres pesant sur les épaules, soulève une pièce de canon et a l'énergie nécessaire pour conduire les hommes qu'il surveille. Le colonel leur fait cesser le travail.
Le colonel nous quitte pour aller à ta parade de la garde nationale, et sous la conduite d'un capitaine qui nous a accompagnés, nous visitons une jolie mosquée, qui domine les jardins des condamnés le marabout auquel le colonel a fait du bien, et auquel il nous a recommandés, nous reçoit avec affabilité. Au pied d'un beau palmier qui se balance au-dessous de la mosquée est-un petit cimetière de prédilection dans lequel on ne peut reposer sans avoir payé fort cher; il se compose de sept ou huit tombes blanchies à la chaux.
Nous sommes introduits dans la mosquée. Nous ne sommes pas obligés de quitter nos souliers ; nous marchons sur des nattes de jonc. Les parois des corridors et des galeries sont incrustées de mosaïques de faïence, et portent des inscriptions arabes, extraites de passages du Koran. La grande salle de la prière est simplement mais richement ornée, couverte d'inscriptions arabes, tapissée d'arabesques, ou revêtue de mosaïques en faïence. Dans l'intérieur, sur l'un des côtes, sont deux tombeaux de grands personnages, à chaque angle desquels s'élèvent des faisceaux de drapeaux et d'étendards. La salle est éclairée par un jour mystérieux.
Le coup de canon qui annonce aux musulmans, pendant le Ramadan qu'ils peuvent manger, se fait entendre: pour ne point retarder le repas de ces bons marabouts, nous prenons congé d'eux, après force salutations. En rentrant en ville, nous voyons une escouade de malades qui sortent de l’hôpital, sous la direction d'un militaire chargé de les conduire à Alger, où ils sont remis à l'officier, qui tes envoie aux corps auxquels ils appartiennent, et de les empêcher de s'arrêter en route dans les cabarets mesure sage, car les cabarets, qui abondent à Alger, causent bien des rechutes chez les convalescents.
J. C.
|
|
MINISTRE de l’ALGERIE 1987
(Envoyé par M. C. Fretat) pages 1-34
|
|
DOCUMENTATION GENERALE
HISTOIRE
Préhistoire - Phéniciens - La paix romaine. - Les Vandales et Byzance. - La conquête arabe. - La domination turque. - L'Algérie française. Appendice : - Les appellations successives de l'Algérie.
Préhistoire.
Les Berbères (du latin : Barbari) sont les populations les plus anciennement identifiées de I'Afrique du Nord. Cependant, leur origine reste pratiquement inconnue. Dès le début du néolithique, on trouve dans ce pays un peuplement complexe aux types variés dont les Berbères d'aujourd'hui descendent probablement.
Phéniciens.
La coupure entre histoire et préhistoire se situe ici vers 1200 avant J.-C., époque à laquelle les Phéniciens introduisent chez les Berbères néolithiques l'usage du bronze et du fer. Les comptoirs qu'ils fondent sur le littoral, véritables fenêtres ouvertes sur les civilisations méditerranéennes, deviennent parfois de riches colonies, dont Carthage, que les guerres puniques opposent à Rome (246 à 146 avant J.-C.), fut la plus célèbre.
La paix romaine.
Après la destruction de Carthage, Rome étend sa domination sur la côte et s'engage avec prudence dans l'intérieur du pays, combattant les princes berbères ou s'alliant avec eux. Pendant les premiers siècles de la domination romaine qui s'attacha à refouler v-ers le sud les populations nomades (ce qui expliquerait la parenté étroite qui paraît unir les Touareg du Sahara central aux Kabyles, ces autres Berbères du Nord de l'Afrique), les habitants vivent dans le calme et la paix. L'agriculture prend dans les vallées et les plaines un essor notable, les relations à travers le pays s'organisent. Les ruines d'aqueducs, de voies romaines, de villes importantes (Timgad, Djemila, Tipasa, Césarée) témoignent de cette prospérité.
Les Vandales et Byzance.
Dès le IV° siècle, le déclin de la puissance romaine entraîne des désordres intérieurs qui ne font que s'aggraver à la suite des invasions vandales, puis de I'occupation byzantine. L'insécurité et I'anarchie préparent les voies à la conquête arabe.
La Conquête arabe
Au cours du VII° siècle, le Maghreb central (Maghreb : occident), malgré une énergique résistance des Berbères, est incorporé, comme le reste de l'Afrique du Nord, à l’immense domaine musulman. Il reçoit une foi nouvelle qu'il conservera jusqu'à nos jours et connaît aux X° et XI° siècle une prospérité matérielle et culturelle certaine. Les explorateurs arabes, que n'arrêtent pas les sables du Sud, poussent des reconnaissances jusqu'au Niger et répandent dans le monde de l'Islam la connaissance du Sahara.
Malheureusement, les bienfaits de la conquête arabe seront en grande partie anéantis par les invasions de nomades orientaux qui, au cours du XI" siècle, s'abattent sur ces régions. L'élément sédentaire des régions cultivables, agent de la prospérité agricole, est mis en échec par les principales tribus nomades et réduit en servage. Les cultures reculent en raison de la vie pastorale menée par les envahisseurs et ne reprendront plus la place qu'elles avaient autrefois occupée.
Par contre, la vie maritime, un moment interrompue, reprend et les villes du littoral trouveront dans le commerce extérieur, et surtout la piraterie, les ressources. qu'un arrière-pays dévasté par les nomades ne peut leur procurer.
La domination turque
Au début du XVI° siècle, l'Espagne réussit à prendre pied sur la côte et s’empare de Mers-El-Kébir, Oran, Bougie et de l’îlot qui se trouve en face d'Alger. Devant cette menace précise, le Maghreb accueille favorablement les corsaires turcs qui deviennent désormais les maîtres du pays et expulsent progressivement les Espagnols qui ne conservent qu'Oran (jusqu'en 1792).
Alger, résidence des deys, devient la capitale du pays et connaît, grâce à la course, une ère de prospérité qui va durer jusqu'au XVIII° siècle. La «régence d'Alger » est divisée en trois Beyliks qui, à la fin du XVIII" siècle, s'inscrivent approximativement dans les limites de nos départements actuels.
Mais la Régence, malgré son apparente organisation, ne constituait jamais un véritable Etat. L'esprit d'indépendance des différentes tribus se manifestait surtout à l'occasion des collectes d'impôts qui prenaient souvent l'allure d'opérations guerrières. La débilité du pouvoir central égala très vite celle des monarchies arabes à leur déclin et l'insécurité des campagnes anéantit la vie sédentaire, condition essentielle de prospérité : la Régence turque d'Alger restait, à moins de cent kilomètres de la côte, le pays de nomades que les invasions du XI° siècle avaient profondément marqué.
L’Algérie française
L'intervention de la France en 1830 transforme le destin de ce pays à qui elle donne dès 1839 le nom d'Algérie française.
Pour la première fois depuis de longs siècles, la pacification de ces régions peuplées de tribus turbulentes est entreprise. Organisée par l'armée au fur et à mesure de sa progression, I'administration du pays évolue rapidement dès 1857 vers un régime civil. Dés cette époque, l'Algérie du Nord trouve le calme et la Paix.
Au milieu du XIX° siècle, la nécessité d'étendre la pacification au nord du Sahara se faisant sentir, la pénétration vers le sud commence et en 1902 est décidée la création administrative les territoires du Sud» rattachés à l'Algérie
Ainsi se parachève l'organisation de cette entité administrative et politique qu'est l'Algérie actuelle.
Pour la première fois dans l'histoire, la France a su grouper les différentes populations de ces territoires vastes de plus de deux millions de kilomètres carrés et leur donner le sentiment qu'elles pouvaient vivre en une même communauté.
LES APPELLATIONS SUCCESSIVES DE L'ALGÉRIE
Le mot Algérie est une appellation géographique qui, par décision du ministre de la Guerre en date du 14 octobre 1839 a remplacé l'expression peu précise de « Possessions françaises dans le Nord de l'Afrique ».
L'instabilité du pays a fait que celui-ci a reçu au cours du temps un grand nombre de noms. Citons : Lybie, ou Libya, employé par les Grecs (Homère, Hésiode, Hérodote et les géographes jusqu'à Strabon).
Ce terme attribué d'abord au continent, se restreint à l'Afrique du Nord, et, à l'arrivée des Arabes, ne désigne plus que la Cyrénaïque et la Tripolitaine.
Il est supplanté par Africa, nom donné par les Romains à I'Afrique du Nord et qui s'étend au continent, en supplantant Libya.
Un siècle et demi avant notre ère, la personnalité géographique des territoires comprenant l'Algérie est déjà distincte sous les noms de Numidie, Maurétanie, Gétulie.
Avec l'arrivée des Arabes, les provinces géographiques et administratives que les Romains avaient implantées disparaissent, à l'exception d'Ifriqiya, transcription arabe de Africa.
L'Afrique du Nord est désignée par les Arabes sous le terme vague de « Maghrib el Aousit » le pays situé à l'occident de Damas et Bagdad ».
Sous la domination turque, le pays algérien prend le nom de « Régence d'Alger : Oualiyat el Djezair puis Mamelakat el-Djezair ».
Pour les chrétiens, Alger était situé en Barbarie (d'où barbaresque). On parlait aussi de Régence ou Royaume d'Alger.
Ces différentes appellations ont eu des fortunes diverses. Maghrib-el-Aousit et El-Djezaïr sont encore employés en Arabe. El-Djezaïr s'est transcrit sous la forme Alger qui a donné Algérie.
L'ALGÉRIE EN 1830
Un Etat ?
Absence de sentiment collectif. - Absence d'autorité unique. Une administration rudimentaire. - Un gouvernement sans souci ni conscience de sa mission.
Une nation ?
Absence de conscience nationale, - Une injustice essentielle. - Des injustices quotidiennes. - Une seule réalité : la tribu.
Appendice :
Les entreprises des pirates barbaresques.
UN ÉTAT ?
Un Etat suppose quatre caractères essentiels :
- une réunion d'hommes suffisamment nombreux et unis par le sentiment de constituer une collectivité originale ;
- un territoire fixe ou le groupe est établi de manière permanente ;
- une autorité publique suffisamment assise et stable pour diriger l'Etat à l'intérieur et le représenter dans ses relations extérieures ;
- un objectif social, à savoir la conservation et le développement de la collectivité.
L'Algérie de 1830 présentait-elle les caractères spécifiques de l'Etat authentique ?
ABSENCE DE SENTIMENT COLLECTIF
Le pays, depuis un siècle, était indépendant de la porte.
La nomination du dey était notifiée à la Porte ottomane qui, dans tous les cas, ne faisait que confirmer. En se soumettant à cette confirmation, le dey faisait simplement acte de déférence envers l'autorité religieuse du chef de l'islamisme, sans en reconnaître pour autant la souveraineté. Il se considérait seulement comme I'allié de la Porte dont il ne recevait au demeurant aucun ordre. L'allégeance des gouvernements d'Alger envers l'Empire ottoman avait cessé depuis 1669, et le dey entretenait des relations politiques directes avec les puissances étrangères.
Sans doute les habitants d'Algérie, au nombre de deux millions environ, auraient-ils pu constituer une collectivité économiquement viable puisqu'on y trouvait pasteurs, agriculteurs, lettrés, artisans, marchands, soldats.
Mais ils ne connaissaient rien qui ressemblât à un sentiment collectif. L'Algérie était constituée par une mosaïque de groupes, unis par des liens tribaux ou religieux, et fermés sur eux-mêmes. Ces groupes étaient perpétuellement divisés par des luttes dont l'enjeu était soit la possession d'une parcelle de territoire, soit des rivalités dynastiques. Bref, on rencontrait un agglomérat, mais rien qui ressemblât à une unité, encore moins à une union.
ABSENCE D'AUTORITÉ UNIQUE
Si la domination turque fit cesser en Algérie, dès le début du XVI° siècle, l'anarchie régnante, apanage des empires arabes décadents, elle n'y parvint que grâce à un système de gouvernement brutal dont I'administration possédait une solide armature militaire.
Elle ne put maintenir sa suprématie jusqu'en 1930 qu'avec l’aide des républiques kabyles et des royaumes arabes dont la Régence s’assura le concours par une politique de « bascule » exploitant les différends qui opposaient ces divers groupements.
Mais vers 1830, la prépondérance turque était à son déclin. Le dey Hussein et les trois deys de Constantine, d'Oran et du Titteri n'exerçaient vraiment leur autorité que sur une portion restreinte du territoire algérien (1/6" environ). Ils dominaient une partie de la plaine, mais n'étaient pas maîtres de la montagne, fief des tribus berbères toujours jalouses de leur indépendance.
L'organisation s'appuyait, d'après L. Rinn, sur quatre territoires politiques et administratifs :
1°) Dar Es-Soltâne ou domaine de la couronne sous la dépendance directe du dey d'Alger et comprenant les villes d'Alger, Blida, Koléa, Cherchell et Dellys et des districts et cantons appelés El-Watan, sous les ordres de caïds turcs;
2°) Beylik el-Titteri (beylik signifie « territoire gouverné par un bey»), chef-lieu Médéa, comprenant un certain nombre de districts et de tribus ;
3°) Beylik Ouarane, chef-lieu Oran, comprenant des groupes de tribus sous le commandement de trois chefs : l'agha des Douairs, l’agha des Zmela et le Khalifa Ech-Chenoy ;
4°) Beylik Qsantina, chef-lieu Constantine, comprenant surtout des territoires entourant cette ville, le reste de la province étant sous la dépendance de puissants chefs arabes ou berbères.
Le territoire de chacune de ces provinces englobait un certain nombre de tribus rattachées au souverain par des liens qui variaient de la soumission à l'indépendance complète. Ces tribus avaient, par ailleurs, de sérieuses raisons économiques de se battre entre elles deux fois par an : au printemps, pour s'assurer les meilleurs pâturages, à l’automne, pour labourer les meilleures terres, sans compter entre temps les enlèvements de femmes et la razzia des troupeaux.
UNE ADMINISTRATION RUDIMENTAIRE
Mais les différences de races, les aléas de l'occupation auraient pu s'atténuer, puis disparaître, sous l’action d'un Gouvernement et d'une Administration conscients de ces réalités et solidement organisés.
Le Gouvernement.
Militaire et électif, il avait à sa tête un souverain absolu, le dey. Tous les auteurs s'accordent pour souligner que la désignation du dey, qui s'effectuait à la faveur d'intrigues ou d'émeutes, n'était aucunement dominée par des préoccupations politiques, mais bien par les désirs et les ambitions de quelques milliers de janissaires. (Julien, dans son « Histoire de l'Afrique du Nord », indique que sur trente deys qui se succédèrent de 1671 à 1818, quatorze furent imposés par l'émeute après I'assassinat de leur prédécesseur.) Aussi comprend-t-on que le dey eût souci de satisfaire ses pairs qui I'avaient élu et le toléraient au pouvoir pour autant seulement qu'il flattait leur cupidité et leur relâchement, beaucoup plus que de remplir des obligations de droit. Désireux avant tout de gouverner, et peu soucieux de gouverner réellement le pays, « il s'entoure souvent de gens incapables dans le dessein de gouverner sans contrainte » (Lettre du 18-11-1809 de Dubois-Thainville, consul général de France à Alger).
Son entourage se désintéresse des problèmes de gouvernement : « Vous êtes notre maître et notre père, vous seul pouvez savoir ce qui nous convient. Si vous faites bien, vous serez récompensé ; si vous faites mal, le mal tombera sur vous. » Rien qui ressemble à un gouvernement conscient et organisé.
Le personnel administratif comprenait les cinq membres du conseil, le trésorier public, le chef de l'armée de terre, le ministre de la Marine, le Directeur des domaines, le Receveur des tributs.
Ils étaient assistés de quatre grands écrivains ou secrétaires, de deux petits écrivains, pour les fonctions administratives, deux interprètes, de commis chargés des magasins, de l'octroi et des domaines, et de huit agents de la police.
On remarque combien ces fonctions sont déterminées par les seules préoccupations de ce gouvernement : armée, marine (course), finances. En fait, le dey administrait la seule province d'Alger.
Le reste du territoire était divisé en trois provinces ayant à leur tête des beys à peu près indépendants, qui se contentaient de présenter, tous les trois ans, le produit des impôts à l'autorité centrale. Chaque province comprenait un certain nombre de cantons réunissant plusieurs tribus, divisées à leur tour en douars. Les beys exerçaient leur autorité par l'entremise de caïds et de chefs de tribus dont la mission principale était de lever I'impôt. Certaines tribus étaient exonérées de charges à condition d'assurer auprès de leurs voisines la rentrée des impôts ou I'exercice de la police. La présence turque ne se manifestait vraiment qu'au moment de la collecte des impôts.
Elément d’un gouvernement sans assise et permanence, tout ce personnel ne connaissait d'autre règle que I'intérêt : s'il ne recevait pas ou peu d’appointements, il s'enrichissait par tous les moyens : « Il n’y a pas jusqu'à la place de négociants qui ne soit tenue à présenter tous les ans des pommes, des châtaignes, des anchois, des olives, etc., aux grands et petits qui sont employés dans le gouvernement. Les actes de bienséance, de cérémonie, de politesse sont toujours suivis à Alger d'une donation en argent ou en effets. » (Venture de Paradis : « Alger au XVIII° siècle» (1898), page 112)
Rien ne protège le fonctionnaire contre l'arbitraire : il est élevé, abaissé, déplacé selon le caprice du maître. Si I'on rencontre des agents publics, il n'existe pas de Fonction publique.
L’Armée.
Source de tout pouvoir, la milice comprenait en 1830 6 000 hommes, mais, imposée au pays, elle n'en était nullement issue, puisqu'elle ne comprenait, à part la cavalerie arabe, que des Turcs et des Coulouglis.
En cas de nécessité, le dey réquisitionnait dans les seules tribus makhzen, et il devait payer fort cher les troupes levées dans le pays.
Les seuls soldats sûrs étaient ceux de la milice ; encore était-il dangereux de différer leur paye d'un seul jour. « La milice était redoutée par son chef lui-même qu'elle empêchait de s'endormir dans l'oisiveté fatale aux despotismes orientaux, car un dey endormi était un dey appauvri et par là condamné aux yeux de la milice qu'il eût été incapable d'enrichir. »
Fondement du régime, cette armée n'était donc ni sûre, ni organisée. W. Shaler, consul général des E.U. à Alger, déclare à ce propos dans les esquisses de l'Etat d’Alger, 1830 : « Simplement enrôlés, ils ne sont soldats de fait que lorsque le temps ramène l'époque de leur service, et ne donnent pas la moindre idée de ce que nous appelons organisation et discipline. C'est au contraire le corps militaire le plus insignifiant qui fut jamais. Les janissaires appartiennent à des baraques où ils sont incorporés à leur arrivée et où, par rang d’ancienneté, ils parviennent à être chefs de détachement et de corps ; c’est sous ce seul rapport qu'ils peuvent être regardés comme une troupe soumise à une organisation systématique.
En 1830, « elle ne suffisait plus à maintenir les Algériens dans l'obéissance. Ceux-ci relevaient la tête, des janissaires étaient rossés la nuit sans que les coupables pussent être découverts et le dey se vit obliger de recommander à ses Turcs de fermer les yeux » (Esquer).
Les finances.
Les principales ressources du budget étaient les impôts, les tributs envoyés tous les trois ans par les beys, les tributs que versaient les nations européennes pour être à l'abri de la course, Ies monopoles des grains, les présents des consuls, la piraterie (marchandises, rachat des esclaves). Shaw mentionne également des ressources extraordinaires : « Si le dey éprouve un besoin pressant d'argent, il y remédie quelquefois en donnant I'ordre d'étrangler un ou deux beys, ou quelques Maures opulents dont les richesses deviennent alors sa proie, de faire une excursion chez les Bédouins, ou bien de déclarer la guerre à quelque nation européenne. » ( l)
Le tableau des dépenses du gouvernement, donné par Shaler, indique pour 1822: - ouvriers, artistes, etc., qui travaillent dans les chantiers 24000
- achat de bois de charpente, cordages, etc,.. .... 60000
- solde des officiers de mer et des marins 75000
- solde des militaires de tout grade 700000
(dollars espagnols)
Si le Trésor était fabuleusement riche, « incalculable », on voit que les fonds publics étaient destinés en quasi-totalité à l'armée, c'est-à-dire à la minorité turque : « Il ne sort du trésor, pour les dépenses, courantes, que les sommes fixées et arrêtées depuis un temps immémorial. »
Aussi ne faut-il pas s'étonner que le gouvernement ne se soit aucunement soucié des travaux publics et de l'assistance.
Les travaux publics.
Si la ville vint à s'enrichir de jardins et de demeures, ce fut grâce à l'initiative de particuliers. Les deys n'utilisent pas le Trésor à cet effet : « Dans les occasions même les plus urgentes, tout se fait par corvées », même les travaux de fortification.
La lutte contre les sauterelles retombe sur les Juifs, l'Etat ne désirant pas en assurer la charge.
Les travaux publics se faisaient également par contributions d'argent exceptionnelles.
L’assistance.
- L’aide était dispensée par des établissements religieux ; non par l'Etat.
En matière d'assistance médicale, les seuls hôpitaux dignes de ce nom avaient été fondés par les missionnaires.
Tout était à créer en matière d'assistance hospitalière à cette époque, car on ne pouvait vraiment pas qualifier d’hôpitaux les rares asiles annexés à certaines mosquées, Ies « moristans », où de malheureux indigènes, malades, infirmes, ou fous étaient parqués et mouraient dans un état de malpropreté repoussante.
Peu de contrées au monde étaient aussi malsaines et inorganisées. Les épidémies de toutes sortes et les famines faisaient régulièrement des hécatombes massives, varioles, paludisme, typhus, dysenterie, fièvre typhoïde, peste, choléra, entre autres, sévissaient à l’état endémique.
La mortalité infantile était effrayante.
Au surplus, en cette matière I'éloquence des chiffres est amplement suffisante : la population de I'Algérie en 1830 a été évaluée à moins d'un million et demi d'habitants. Les Turcs ne procédaient jamais à des recensements. On n'inscrivait ni naissances, ni décès. Les décès toutefois devaient être déclarés afin qu'une succession n'échappât point au curateur des successions vacantes. Aussi doit-on se référer à certains ouvrages de I'époque :
1) M. William Shaler, consul des Etats Unis à Alger, pensait que la population des Etats d'Alger était plutôt au-dessous qu'au-dessus d'un million, (Sketches of Algiers, Boston, 1826 page 12 traduit en français sous le titre : « Esquisse de l'Etat d'Alger », Paris 1830 page 22)
2°) M. Ch. Picquet cite « Le Journal des sciences Militaires » qui « évalue la population de la Régence d'Alger à dix-huit ou dix-neuf cent mille âmes ». Il estime ce chiffre très exagéré et se rallie à l'estimation précédente (« Aperçu sur l’Etat d’Alger, à l’usage de l’armée expéditionnaire d'Afrique », Paris 1830, page 119)
3°) Le baron Jochereau de Saint Denys estime que « la population doit être de 800 000 âmes » (« considérations sur la Régence d'Alger », Paris 1831, Page 41)
Si I'on songe à l'importance des invasions arabes qui se sont succédé à partir de la fin du VII° siècle - et notamment de la dernière, celle des Hilaliens (XI° siècle) - qui totalisaient près d'un demi-million d'hommes dont beaucoup sont demeurés en Algérie, s'ajoutant à la population berbère autochtone, on constate que celle-ci n'avait pas subi d'augmentation sensible en près de quatorze siècles.
Conclusion.
On voit donc que le gouvernement se désintéressait des charges qui, normalement, lui incombent et que les seules dépenses dont il s'acquittât directement étaient, outre celles qui figurent au tableau ci-dessus :
- les frais provenant des négociations politiques ;
- l'entretien de certains édifices publics ;
- les frais causés par I'exploitation des monopoles.
Au demeurant, le budget était annuellement en déficit (424 000 dollars en 1822).
Il est donc faux de s'appuyer sur le fait que le Trésor était très riche pour déclarer que l'Algérie était alors un pays prospère et actif.
La justice.
Les imams, ministres du culte, les muftis, docteurs de la loi (charia), et les cadis, juges en matière religieuse, composaient le tribunal appelé à sanctionner les infractions au Code des Musulmans dont les prescriptions étaient contenues dans le coran, livre sacré et immuable, et la Sunna, recueil de hadiths qui relatent les paroles, les faits et gestes de Mohamed « envoyé de Dieu ».
Dans ce recueil figurent non seulement les prescriptions qui règlent la vie de famille, le mariage, la vie des femmes, l'éducation des enfants, mais aussi le régime de la propriété, celui des contrats et les principes du droit pénal.
Le cadi était à la fois juge, notaire et protecteur des incapables. II rendait la justice à tous les Musulmans qui s'adressaient à lui. Sa compétence ne connaissait pas de limites territoriales et ses jugements étaient rendus sur le champ.
Mais si le cadi détenait la juridiction civile, le souverain d'Alger, ,le dey jugeait toutes les causes criminelles. Il déléguait parfois ses pouvoirs aux caïds. Ses décisions étaient toujours prises, sans débats, sans délais, sans frais, sans appel.
On peut quelquefois faire révoquer la sentence à force d’argent... Comme un cadi ne vient à Alger que pour s'enrichir et que sa charge lui coûte toujours cher, il se laisse assez aisément corrompre par les parties. »
« C’est une place de conséquence et qui enrichit celui qui la fait, à cause des rétributions qu'il a de ceux qui cherchent à arranger une mauvaise affaire. »
Les sanctions étaient sévères (pal, emmurement, bûcher, étranglement, amputation).
En pays berbère régnait un droit particulier, issu de vieilles coutumes ancestrales et enfermé dans des codes locaux, appelés « kanouns ». La justice était rendue par une assemblée d'anciens appelée « djemaâ ».
L’Instruction.
« Il n’y avait à Alger, ni ailleurs, rien qui pût faire songer aux universités musulmanes d’«El Azhar » au Caire, de la « Zitouna » de Tunis, de la « Qaraouyine » de Fès. Il n'y avait véritablement aucune organisation de l'Instruction publique, mais on donnait de nombreux cours, surtout religieux... L'enseignement demeurait partout médiéval, scolastique et suranné. « (Henri Weiler, Les Medersas.)
Les « habous », ou fondations pieuses, étaient consacrés à l'entretien des centres culturels: écoles coraniques ou zaouïas.
On distinguait à l'époque différents degrés d'enseignement que l’on peut assimiler, à un niveau inférieur cependant, à ce que l’on a coutume d'appeler l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur :
L'enseignement primaire était dispensé dans les écoles coraniques qui avaient pour unique programme l'étude du coran. on y enseignait des rudiments d'arabe, lecture et écriture, qui permettaient aux élèves d'apprendre par cœur les sourates coraniques. On comptait environ 3 000 écoles coraniques en 1829.
Les zaouïas, foyers culturels et religieux d'origine maraboutique, et les mosquées enseignaient des matières d'un niveau plus élevé et préparaient les élèves à suivre des cours supérieurs dans les grandes mosquées d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Les grandes mosquées formaient des magistrats, les cadis (juges et notaires) et des mouderrès (professeurs).
L'enseignement, coupé des grands centres culturels, était en décadence. Le gouvernement ne faisait rien pour y porter remède ; au contraire, il pillait les œuvres pieuses qui le dispensait.
« A Biskra, ils ont mis la main sur les medersas et sur les fondations pieuses dont ils dilapident le revenu. C'est ce qui cause la disparition de l'instruction et du savoir. »
Ainsi : « Il est inutile de parler de l'état des sciences à Alger ou elles n'existent pas, où elles sont méprisées ; la médecine même y est sans prix. »
L'enseignement et la vie culturelle de la Régence étaient demeurés complètement étrangers aux grands courants scientifiques, philosophiques et artistiques de I'Occident.
L'Agriculture.
L'économie était essentiellement rurale. Il existait seulement dans les villes une petite industrie artisanale, qui complétait l'industrie familiale, sans se substituer à elle.
Cependant, dans un pays qui ne manquait pas de fertilité, l'agriculture n'était pas en honneur et I'administration turque, exclusivement attachée à accroître le rendement fiscal des tribus, ne se souciait aucunement d'organiser l'économie rurale. La condition des agriculteurs était des plus misérables. « Il n'y a point d'êtres plus malheureux que Ies Maures qui cultivent la terre d'Alger. » (Venture de Paradis.)
La terre n'était pas labourée, on ne greffait pas l'olivier. Certes, les nomades, pasteurs avant tout, ne se préoccupaient guère d'agriculture ; la vie de la tribu nomade, formation guerrière, est une perpétuelle transhumance : on ne s'arrête que pour laisser paître les troupeaux ou pour semer et récolter hâtivement une maigre moisson, sans quitter des yeux la plaine où l'ennemi peut apparaître. Les sédentaires de la plaine redoutaient la jalousie et les déprédations des Turcs. Ainsi, selon Venture de Paradis, la Mitidja c’est une superbe plaine... Il s'en faut malheureusement de beaucoup qu'elle soit toute cultivée ; mais elle est remplie de lacs et de terres en friche » (1er C., p. 6).
La politique de prohibition eut pour effet de porter « le produit de l'huile et des grains souvent au-dessous et jamais au-dessus des besoins des habitants. En 1819, il y eut une si grande disette de grains qu'on fut obligé d'importer de l'étranger plus de 50 000 boisseaux de blé seulement pour la consommation d'Alger ».
D'autre part, la complexité du régime des terres selon le droit musulman n'était pas faite pour favoriser l'essor de l’agriculture :
Le Droit musulman fait une première distinction entre les terres mortes et les terres vivantes. Les « terres mortes » sont celles qui ne produisent rien et qui ne sont la propriété de personne.
Quiconque vivifie la terre en la défrichant, en construisant ou en plantant, en devient propriétaire : la mise en valeur du sol est un moyen d'acquérir. D'autre part, la terre vivifiée meurt de nouveau lorsqu'elle cesse d'être cultivée.
Une seconde distinction est celle des terres de dîme et des terres de tribut.
- En terre de dîme, le Musulman est véritablement un propriétaire et la dîme qu'il est tenu de payer à son fondement dans une obligation religieuse.
- Les terres de tribut sont celles qui appartenaient aux vaincus ; ceux-ci ont pu être laissés en possession de leurs biens, mais ils sont devenus, en quelque sorte, les fermiers de l'Islam et le tribut (Kharadj) qu'ils doivent toujours payer comporte une idée de soumission, d'humiliation.
Enfin, les biens « habous » dont la constitution a été ainsi définie : « L'acte par lequel le constituant fait sortir du commerce, dans un but pieux, une chose qui était sa propriété, et dispose de I'usufruit, seul reste disponible entre ses mains, en faveur de une ou plusieurs personnes désignées dans l'acte de constitution, qui jouiront successivement de l'usufruit, suivant un ordre qui doit être combiné de telle sorte qu'en dernier lieu tout au moins, sinon immédiatement, l'usufruit arrive entre les mains d'une personne morale d'ordre religieux.»
Une telle institution était commode en ce qu’elle permettait :
- de modifier un ordre successoral, en particulier en exhérédant les femmes ;
- de mettre les biens à l'abri des confiscations arbitraires du dey.
En bref, quelles que fussent Ies catégories de terres existant en Algérie en 1830, on peut avancer que la propriété foncière telle que nous la concevons, n'y était pas organisée. On rencontrait une propriété tribale, non individuelle.
En somme, on trouve en Algérie une économie archaïque, sans grands échanges commerciaux, précaire, soumise étroitement aux conditions climatiques et aux aléas de tous ordres. Une mauvaise récolte, une sécheresse qui décime un troupeau et l'existence de la famille et de la tribu est gravement menacée, sans secours ni recours. Aussi, la vie économique de l'Algérie de 1830, faute de réserve et de crédit, est-elle dominée par deux phénomènes : la disette et I'usure. Il n'existait aucune exploitation minière (à l'exception de quelques gisements à ciel ouvert de faible importance) à l'arrivée des Français qui, en ce domaine, ont pris la relève de Rome. Seuls, en effet, des vestiges romains, puits et descenderies, ont été retrouvés dans le gisement de l'Ouenza, au moment de la mise en valeur.
Le Commerce.
Il pouvait être florissant, les Maures étant volontiers artisans et marchands. En fait, les pouvoirs publics ne firent rien pour l'aider.
La famille patriarcale était la cellule politique et sociale sur laquelle reposait l'activité économique musulmane.
La communauté familiale tendait à se suffire à elle-même. Elle formait un organisme autarcique de production et de consommation, récoltant ou fabriquant les produits nécessaires à sa subsistance et les distribuant selon les besoins de chacun. Elle réalisait un circuit économique fermé, dans lequel les mouvements commerciaux constituaient des faits isolés et dont quelques échanges, seulement, marquaient le courant. Ces échanges permettaient à la famille de se procurer ce que ne pouvait lui fournir son industrie trop primitive : armes, tissus d'apparat, bijoux.
C'est dans les centres urbains qu'avaient lieu ces quelques transactions commerciales. Là vivait un monde évolué d'intellectuels, «I'artisans et de marchands. Le fellah ou le pasteur, en échange de produits de son champ ou de son troupeau, y trouvait les quelques objets de luxe qu'il convoitait. Le commerce n'était au demeurant pas facilité par la pluralité des monnaies. On en comptait une douzaine qui avaient cours en Algérie en 1830.
Les villes étaient d'ailleurs très rares. La Cité, produit de la civilisation, tenait peu de place au Moghreb, au regard des immenses espaces occupés par la population rurale.
L'Etat se réservait le monopole des principaux produits et le vendait au plus offrant. Le dey et le trésor y gagnaient, mais le pays perdait ainsi une importante source de richesses, au profit des compagnies étrangères, américaines, anglaises, françaises et surtout de Juifs de Livourne. (Cf. texte de Shaleri : « importations-Monopole », qui renferme un tableau des importations et des exportations pour 1822, accusant un déficit de 937 000 dollars).
Par ailleurs, dans leur imprévoyance, les Turcs, confiants en la course, négligeaient les relations commerciales avec l'intérieur de I'Afrique.
Les relations avec l'étranger.
Elles sont actives, mais les nations européennes se plaignent de l'arrogance des Turcs : « On ne voit à Alger d'un bout de l'année à l'autre que des usages et des manières qui affligent l'amour-propre. Les consuls de toutes les nations sont ici regardés comme des otages », dit le consul général des Etats-Unis.
Les traités signés avec les Turcs, en raison de la mauvaise foi de ceux-ci, assuraient une paix toujours précaire et si la Régence était tolérée pour des motifs commerciaux, on n'accordait à la parole de ses chefs aucune valeur de répondant et de garantie.
UN GOUVERNEMENT SANS SOUCI NI CONSCIENCE DE SA MISSION
De l'étude de ce gouvernement, il ressort clairement que la Régence ne se souciait nullement de la sauvegarde et de la promotion de la « personnalité » du pays.
Les Turcs n'essayèrent jamais d'adapter leurs droits ou leurs coutumes aux besoins du pays. Ils ne cherchèrent jamais à le mettre en valeur et ne se préoccupèrent aucunement du bien-être des populations. Ils n'avaient aucun idéal moral ou politique. Sans aucune conscience de leurs responsabilités, ils gouvernèrent avec I'insouciance et l'imprévoyance d'aventuriers vivant au jour le jour.
Jamais ils n'ont recherché I'adhésion des indigènes, ni tenu compte de leur présence. Les contemporains s'accordent sur le fait qu'ils ne leur demandaient que deux choses : les impôts et la libre circulation des troupes, les laissant libres d’agir à leur guise par ailleurs.
Les droits de la personne.
Si la liberté existait en principe, encore qu’il demeurât dans la Régence des esclaves qui n’étaient pas tous des européens, elle était entravée, en fait, de diverses façons.
Aucun respect de la personne : « la politique d'Alger est très cruelle envers les Maures et les Arabes ; pour la plus légère faute, on les fait mourir. Baba-Ali étant agha essayait souvent son fusil sur les gens de la campagne, par pure fantaisie. L’agha d’aujourd’hui, dans le temps des bombardements, faisait écraser entre deux pierres tout Maure campagnard qui se rencontrait dehors. Le gouvernement algérien, a pour principe de dépouiller les Maures et de leur faire toutes sortes d'injustices et de vexations pour les tenir asservis. »
Des enlèvements de femmes et de jeunes garçons avaient lieu constamment et les victimes étaient emmenées dans les casernes, lieux francs ou ne pénétrait pas la police.
Indigènes asservis aux soldats turcs ; soldats turcs asservis au dey, nuI n'est libre et pas même le dey ; « despote sans liberté, roi d’esclaves et esclave de ses sujets » (dit l'ecclésiastique espagnol Juan Cano).
Les inégalités sociales.
Nulle égalité sociale dans ce régime où le riche est maître et achète faveur et pardon: on distinguait en effet :
Ahl-El-Maghzen, ou gens du gouvernement, occupant une superficie d'environ 3500 000 hectares et qui constituaient deux catégories :
- les groupes guerriers ;
- Ies tenanciers, fermiers, auxiliaires, employés.
Les rayat ou sujets, taillables et corvéables à merci (4 000 000 ha) ; ils formaient « El Outane », les pays, sous les ordres des caïds, tous relevant de l'agha des Arabes, chef de l’armée du dey.
Les vassaux qui, tout en conservant leur autonomie, avaient avec Ies Turcs des relations qui en faisaient des alliés. Ils occupaient ou parcouraient une superficie totale d'environ 7 500 000 hectares.
certains d'entre eux étaient souvent plus puissants que les beys turcs gouverneurs des provinces et leur alliance coûtait fort cher.
Les indépendants, constitués par certains groupes organisés en républiques fédératives (Kabyles) ou en fiefs dynastiques (nomades sahariens), occupaient une superficie d'environ 3500000 hectares. Leurs territoires échappaient au contrôle des Turcs.
Les indigènes n'ont aucun droit politique : « prenant le droit de conquête pour principe de leurs institutions, les Turcs mirent à la disposition des janissaires toutes les places auxquelles étaient attachés la considération, la confiance et l'argent. »
Il n'y avait pas davantage égalité entre les races.
CONCLUSIONS
Le caractère artificiel et incohérent du gouvernement de la Régence a été souvent souligné, notamment par Shaler : « Le gouvernement algérien, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est nullement susceptible de perfectionnement ; le caractère barbare et l'ignorance des Turcs ne permettant pas d'espérer la moindre amélioration » ; par M. Hadj-Sadok :
« N'ayant en vue que la conservation d'une classe d'aventuriers, la domination turque ne fut qu'un phénomène superficiel qui n’a pas effleuré les profondeurs » ; par Nettement : « Après trois siècles de durée, la domination turque n'était guère plus assise qu'au premier jour dans le pays, elle n'y était que campée ».
Ce qui constitue vraiment l'Etat en tant que valeur spirituelle et non seulement en tant que présence matérielle, ce n'est pas la population, le territoire et la stabilité du pouvoir :
« Ce qui est capital, c'est la manière d'être de cette population, ce sont les rapports qui unissent ses membres, les fins qu'ils se proposent, leurs sentiments à l'égard des chefs qui Ies commandent. La population, matériel brut, doit se transformer en communauté. Elle doit pour cela former un ensemble cohérent, une nation. » D'autre part : « à la place de la passivité primitive ou de l'incompréhension qui caractérise les groupes non évolués, un sentiment d'ordre politique apparaît quant à la signification du pouvoir dans la Société. Et lorsque ce sentiment est favorable, c'est-à-dire qu'it y a consentement, rien ne s'y oppose plus, du côté du groupe, à la formation de l'Etat Nation et consentement tels sont donc les conditions d'existence de l'Etat.
On verra plus loin l'aspect « national » de la Régence de 1830.
Quant au consentement, tous les auteurs s'accordent sur le fait que les indigènes gardèrent toujours un farouche sentiment d'indépendance, source d'incessantes révoltes, sans qu'ils fussent pour autant effleurés par un sentiment d'ordre politique qui eût pu les porter à remettre leur destinée à un pouvoir unificateur et responsable de leur promotion.
Le territoire.
« Limites précises, les frontières cernent la réalité du pays et lui permettent l'unification intérieure en fournissant le cadre stable, nécessaire au développement des « Travaux Publics », de la réglementation, de la propriété foncière, de l'exploitation des richesses naturelles, de la défense nationale, et l'aménagement de la puissance publique selon une répartition entre des centres locaux. »
Or, nous n'avons trouvé ni frontières fixes ni ligne douanière (les marchandises étaient taxées dans Ies ports et les marchés), ni ligne militaire (simple occupation de certains points stratégiques). La faible partie du territoire relevant de la puissance turque ne s'arrêtait pas sur un tracé géographique, mais s'effrangeait en zones d'insécurité, domaine des tribus non soumises et mouvantes comme elles.
En ce qui concerne le pouvoir, il existait, encore que chancelant, et, de l'aveu «le tous, s'acheminant à la faillite, un semblant d'Etat turc, mais d'Etat algérien, nullement. En effet, les Turcs se refusèrent à se rapprocher des indigènes autrement que pour une cohabitation forcée.
Enfin, si le pouvoir turc désirait persévérer en son être, ce n'était nullement pour assurer la continuité d'une richesse commune d'ordre temporel, ou d'une valeur morale et spirituelle.
Un voit, dans ces conditions, ce qui sépare l' »Etat turc » de ce qu'est, en son essence, l'Etat : « le fondement des règles juridiques autour desquelles s'organise la recherche du bien commun ».
UNE NATION ?
En l'absence d'Etat organisé et viable, il aurait pu au moins exister une conscience nationale, un sentiment de communauté, né de la terre, de la race, de la langue, des traditions.
Que l'idée de nation n'ait pas existé chez les Turcs d'Algérie, aventuriers déracinés, recrutés dans tout le Proche-Orient, rien d'étonnant.
Mais, en face de cette minorité, y avait-il chez les « naturels » une conscience nationale ? En aucune façon.
ABSENCE DE CONSCIENCE NATIONALE
Le lien territorial est inexistant ; le lien tribal compte seul. Toute dynastie est donc précaire en pays musulman et Ibn Khaldoun ne lui assigne qu'une durée maximum de trois générations.
Diversité des races.
Elle était considérable. Les Berbères d'avant la conquête arabe, les Arabes, les Maures d'Espagne, les Juifs, les nègres, les Turcs, se dirigeaient selon des règles propres (n'existait-il pas un chef appelé par dérision : roi des Juifs et un autre : roi des Nègres ?), et suivant leurs propres traditions : par exemple, dans les écoles juives on apprenait les textes hébraïques et non le Coran ; le droit kabyle différait du droit des Arabes, etc...
A l'intérieur de chaque groupe, aucune unité : « Les Kabyles forment la classe la plus nombreuse de la population algérienne et bientôt ce serait d'eux que les autres recevraient des lois, s'ils étaient capables d'union, mais ils sont partagés en un millier de petites républiques tourmentées continuellement de guerres intestines. »
En présence étaient des éléments ethniques irréductibles l'un à l'autre : tribus nomades arabes, tribus berbères sédentaires, tribus berbères transhumantes.
Jamais, ni avant ni pendant I'occupation turque, les tribus ne cherchèrent à s'unir. Leurs soulèvements fréquents ne prirent jamais la forme de coalition, chacune se révoltant, en tant qu'élément politique indépendant, pour assurer ses propres privilèges et sa propre conservation.
Pluralité des langues.
A l'absence d’unité administrative et ethnique, s'ajoutait la pluralité des langues, aussi grande que celle des races : le turc demeurait la langue officielle ; l'arabe dialectal gardait une place importante ; Kabyles et Mozabites parlaient des dialectes berbères. Esclaves, commerçants européens, renégats d'implantation récente, utilisaient la « lingua franca », destinée aux relations pratiques et composée de mots arabes, turcs, italiens, espagnols et portugais.
Seule la religion pouvait constituer un lien. Mais elle ne réussit pas à neutraliser le particularisme jaloux, les querelles de famille.
Abd-el-Kader en fit l'expérience lorsqu'il essaya, en 1845, de réaliser l'union contre la France. Même les tribus non encore soumises aux Français le repoussèrent (Djurdjura, Djelfa, Tiaret, Mascara). Le moment pourtant aurait pu cimenter l'union.
Témoignages et Opinions.
Shaler notait que le départ des Turcs n’aurait pas amené la formation d'une nation:
« L'état d'abaissement des naturels et l'absence complète d'instruction politique seraient cause que ce peuple se partagerait en plusieurs tribus indépendantes ; la guerre naîtrait de petites jalousies locales et toute espèce d'esprit de perfectionnement périrait par suite du caractère naturellement inconstant et féroce des habitants qui rentreraient dans l'état sauvage et feraient un désert de ce beau pays. » (1er C., p. 125)
Les Musulmans eux-mêmes reconnaissent le fait : « Si les Turcs n'ont rencontré que très peu de réaction, s'ils n'ont pas été chassés par les Arabes et par les Berbères, c'est parce qu'ils avaient trouvé le pays dans une anarchie politique telle que l'idée d'indépendance nationale ne pouvait se faire jour », écrit M. Hadj Sadok.
Et l'on n'a pas oublié la déclaration de M. Ferhat Abbas en 1936 et intitulé ;
« En marge du Nationalisme, la France c'est moi. »
« Mon opinion est connue : le Nationalisme est ce sentiment qui pousse un peuple à vivre à l'intérieur de ses frontières territoriales, sentiment qui a créé ce réseau de nations. Si j'avais découvert la « Nation algérienne », je serais nationaliste et je n'en rougirais pas comme d'un crime.
« Les hommes morts pour l'idéal patriotique sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur. Et cependant je ne mourrai pas pour la « patrie algérienne » parce que cette patrie n'existe pas. Je ne l'ai pas découverte. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les morts et les vivants, j'ai visité les cimetières: personne ne m'en a parlé. Sans doute ai-je trouvé « l’Empire arabe », « l’Empire musulman » qui honorent l'Islam et notre race. Mais des empires se sont éteints. Ils correspondraient à l'Empire latin et au saint Empire Romain Germanique de l'époque médiévale. Ils sont nés pour une époque et une humanité qui ne sont plus les nôtres.
« Un Algérien musulman songerait-il sérieusement à bâtir l’avenir avec ces poussières du passé ? Les Don Quichotte ne sont plus de notre siècle.
« La France, c'est moi parce que je suis le nombre, je suis le soldat, je suis l'ouvrier, je suis l'artisan, je suis le consommateur. Ecarter ma collaboration, mon bien-être et mon tribut à l'œuvre commune est une hérésie grossière.
« Les intérêts de la France sont les nôtres dès I'instant où nos intérêts deviennent ceux de la France. »
UNE INJUSTICE ESSENTIELLE
Si l'union ne se faisait pas contre les Turcs, elle pouvait se faire avec eux comme guides et comme soutiens.
La vie publique.
Les naturels se trouvent dans les petits emplois : au Trésor, dans la police de la ville, dans certains services de la maison du dey : le drogman, des interprètes, des chaouchs.
Mais dès qu'un poste comporte des responsabilités ou des avantages, il est réservé aux seuls turcs, pas même aux Coulouglis. Les gardiens du palais, poste de confiance, les cuisiniers, poste des plus lucratifs, sont tous et toujours des Turcs. Dans le corps des chaouchs, on trouve bien des Maures, mais « s'ils ont des appointements, c'est à titre de domestiques et non point d'hommes de paye »
Dans l’ensemble : « tout ce qui sert dans ce palais doit être turc d’origine ou renégat, mais point coulouglis ».
Les titulaires de hautes charges et le dey sont toujours turcs et des Turcs non originaires d'Algérie : « Il suffit d’être né en Turquie et musulman pour être reçu dans le corps de milice d'Alger et pour parvenir aux premières places et à la dignité de dey. »
Si certaines tribus assuraient la police, si les cheikhs aidaient le bey à percevoir les impôts, c'était en vendant leurs services, non par droit.
L’Armée.
Les Maures forment des corps spéciaux (cavalerie) commandés par des Turcs. Quant à la milice, si les coulouglis peuvent y entrer, ils n'accèdent jamais aux hautes charges : Ies renégats même ont le pas sur eux.
DES INJUSTICES QUOTIDIENNES
Les impôts.
L'impôt ordinaire des Juifs est de 500 livres par semaine et celui des Maures de 700. Les impositions extraordinaires sont prélevées un quart sur les Juifs et les trois quarts sur les Maures.
La Justice.
Les peines varient suivant les races : « Les Juifs qui méritent la mort sont toujours brûlés, les Maures et les chrétiens ont la tête coupée ou sont pendus, les crocs ne sont que pour les Maures dans des cas graves. »
Distinctions fondées sur les races
Des lois somptuaires existent à l'égard des Maures : « Ils ne peuvent porter de I'or sur leurs habits ni aucune espèce d'armes. »
Les vexations les plus mesquines sont pratique courante : « Partout un Turc a la préséance sur un naturel, et dans les rues ce dernier lui laisse toujours le passage libre.» (Shaler).
« Outre les qualités légales dont ils sont privés à Alger, les Juifs ont encore à souffrir d'une affreuse oppression : il leur est défendu d'opposer de résistance quand ils sont maltraités par un musulman, n'importe, la nature de la violence. Ils sont forcés de porter des vêtements noirs ou blancs ; ils n'ont le droit ni de monter à cheval ni de porter une arme quelconque, pas même de canne.
« Mais y a-t-il des travaux pénibles et inattendus à exécuter, c'est sur les Juifs qu'ils retombent. Dans l'été de 1815, le pays fut recouvert de troupes immenses de sauterelles, qui détruisaient la verdure sur leur passage.
« C'est alors que plusieurs centaines de Juifs reçurent ordre de protéger contre elles les jardins du pacha ; et nuit et jour, il leur fallut veiller et souffrir aussi longtemps que le pays eut à nourrir ces insectes. Je crois qu'aujourd'hui les Juifs d'Alger sont peut-être Ies restes les plus malheureux d'Israël. » (Shaler).
Ni les droits ni les devoirs n'étaient comparables dans une société où, l'intérêt mis à part, les distinctions étaient fondées sur la race : les Turcs, Coulouglis, Renégats et Juifs, Indigènes formaient des communautés distinctes. Aussi a-t-on pu parler de politique « humiliante, dégradante, dépersonnalisante, appauvrissante, obscurantiste et discriminatoire » (M. Ben Aboud).
A la fin du XVIII° siècle, Venture de Paradis écrit : « Les Turcs, au milieu de tant de peuples qui sont intérieurement leurs ennemis, suffisent pour maintenir tout dans l'ordre et l'obéissance, mais ce n'est que par une extrême vigilance qu'ils peuvent y parvenir, et ils ne doivent jamais I'oublier. Les Coulouglis sont encore plus leurs ennemis que les Maures et il n'y a peut-être dans Alger que les consuls européens qui désirent leur prospérité. » (p. 3.)
Ricaud, ingénieur au service de l'Espagne, écrivait à la même époque : « La population de la ville et de la plaine, ennemie du gouvernement, les Kabyles, encore plus les ennemis du gouvernement »
Et au XIX° siècle : la situation n'a pas changé.
D’ailleurs, les Turcs ne tenaient aucunement à la fusion. Si les Maures voyaient favorablement, pour des raisons d'intérêt, les mariages de leurs filles avec des turcs, ceux-ci ne faisaient que brimer les enfants nés de ces unions : « Le dernier des Ottomans rejette avec mépris toute espèce de comparaison entre lui et un naturel : et la maxime enseignée pendant plusieurs générations que les Turcs sont nés pour le commandement et les Algériens pour l'obéissance, a perdu avec le temps son caractère odieux et n'est ici qu'un simple axiome politique », écrit Shaler en 1830.
Si l'on s'en tient à la définition des rapports nationaux donnés par M. Ben Aboud, délégué du Maroc : « coopération, justice, respect mutuel », la conclusion s'impose d'elle-même.
UNE SEULE RÉALITÉ : LA TRIBU
De cette étude faite d'après des textes le plus souvent contemporains, certains étrangers, d'autres musulmans, et émanant de gens qui ont bien connu le pays (notamment Venture de Paradis, un savant français qui a écrit ses notes à Alger même, Shaler, consul général des Etats-Unis à Alger qui aimait infiniment le pays, tout en regrettant qu'il fût si mal administré, Shaw, voyageur anglais, etc...), on peut tirer les conclusions suivantes :
- l'Algérie de 1830 n'était pas un Etat organisé et viable ;
- l'idée de nationalité était inconnue, la seule réalité pour les populations musulmanes étant la tribu.
L'idée de nation n'a pu se former qu'au contact des Européens et devant leur effort pour développer les communications matérielles et morales, pour unifier le pays sous les mêmes droits et les mêmes devoirs, et pour assurer une sécurité totale.
Idée si peu empreinte en l'esprit des Arabes du temps, que le bey du Tittery put écrire au maréchal de Bourmont : « Un Arabe ne se soumettra jamais à un autre Arabe ; un gouverneur turc, quand bien même il serait aveugle ou paralysé, serait mille fois préférable et les aurait de suite soumis. Les Arabes ne veulent point de gouverneurs arabes. »
L'Algérie n'a pris la conscience de sa vie et de son âme collectives que dans les formes de la vie nationale française.
LES ENTREPRISES DES PIRATES BARBARESQUES
La conquête de l’Algérie en 1830 a marqué à peu près le terme de la piraterie barbaresque, qui fut une des activités les plus florissantes de la Méditerranée à l'époque de la domination turque.
Alger en particulier était « une nation vivant de la course et ne vivant que par elle» malgré les attaques des puissances européennes, malgré les désordres et les révolutions qui éclatèrent si souvent dans la Régence.
Si un climat d’insécurité a toujours existé sur les frontières de la Berbérie, et dans les eaux méditerranéennes, c'est surtout à partir du XVI° siècle que la Course barbaresque devint la vie même d'Alger.
Cette piraterie fut marquée par le courage, coutumier à l'époque, «les corsaires barbaresques. Mais elle fut aussi I'occasion de scènes de carnage, de rapts, de dévastations d'une violence et d'une cruauté sans limites.
« O Alger, repaire de forbans, fléau du monde, combien de temps encore les princes chrétiens supporteront-ils ton insolence ? » écrit Haëdo vers 1580.
La Course avant 1540
L'expulsion des Maures de la Péninsule Ibérique, après la prise de Grenade en 1492, donna à la Course un accroissement important. La Course devint une sorte de guerre sainte contre les navires et même contre les ports espagnols.
Isabelle la Catholique, reine d'Espagne, envoya dès 1505 une armada de plus de cent bâtiments, montée par plus de dix mille hommes. Mers-el-Kébir fut occupé en 1505, puis Bougie, Oran et Tripoli en 1509.
Alger se soumit à l'Espagne et lui livra un îlot rocheux situé à une centaine de mètres en face de la ville : le « Penon de Argel ».
Ténès, Dellys, Cherchell, Mostaganem demandèrent à leur tour à payer tribut. En quelques années, l'Espagne était devenue maîtresse des principaux points du littoral.
Ces forteresses espagnoles devaient tomber quelques années plus tard sous les coups de Khaïr-ed-Din, connu sous le nom de Barberousse, et « qui fut le véritable fondateur de la Régence d'Alger, avant d'être l'organisateur et le grand amiral de la flotte ottomane »
Barberousse prêta hommage au sultan de Constantinople qui le nomma émir des émirs et lui envoya 6 000 janissaires ainsi qu'une importante artillerie.
Le « Penon de argel » fut pris en 1529. Barberousse fit raser les murs de l'enceinte espagnole et fit construire un véritable port de guerre.
Déjà maître de Collo, de Bône, de Cherchell, de Ténès, il étendit sa domination jusqu'à Tunis dont il s'empara aux dépens des Hafsides en 1534.
Charles-Quint, assuré de la neutralité du roi de France, reconquit Tunis l'année suivante, grâce à la révolte des nombreux esclaves chrétiens.
- En 1541, il tenta de s'emparer d'Alger, au moyen d'une armada de 516 voiles et de 36 000 marins et soldats. Ayant réussi à débarquer et à gagner les hauteurs d'Alger, I'armée de Charles-Quint fut mise en déroute et 140 navires étaient détruits par la tempête.
L'âge d'or de la Course commençait pour Alger.
La Course organisée
C'est au XVII° siècle que la Régence atteignit l'apogée de sa puissance maritime. Ses corsaires tinrent tête au monde entier, remplaçant la guerre sainte par une « guerre de rapines » au profit d'une population cosmopolite, oisive et turbulente.
Pendant deux siècles et demi, la Régence d'Alger va voir affluer sur ses marchés les métaux précieux, les soieries et brocarts d'Amérique, des Indes, du Levant, pendant que les esclaves vont être l'objet d'un fructueux commerce.
« Sans peur, sans pitié », telle est la définition des pirates barbaresques que donne Delvert dans son ouvrage sur le port d'Alger.
Leur férocité indéniable devint, avec le développement de la course de plus en plus implacable. Les XVI°, XVII° et XVII° siècles sont remplis de leurs exploits et de leurs cruautés. La Course, limitée primitivement à la Méditerranée occidentale, s'étendit du côté du Levant, vers Alexandrie, Smyrne et Chypre, puis, avec I'apparition des navires de haute mer, les Corsaires franchirent le détroit de Gibraltar, s'attaquèrent aux bateaux bretons, normands, anglais.
En 1616, le fameux Mourad-RaÏs écume les côtes d'Islande.
En 1617, Ies pirates attaquent l'Ile de Madère, la ravagent, massacrent une partie des habitants, enlèvent jusqu'aux cloches des églises et emmènent en captivité plus de 1 200 esclaves.
Pendant ce temps, les côtes de I'Italie, de la Sicile, de la Corse, de la Sardaigne, de l'Espagne étaient soumises à un pillage périodique. En beaucoup d'endroits, le désert se fit jusqu'à plusieurs lieues du rivage.
Les vaisseaux de guerre étaient attaqués, Ies bâtiments de commerce enlevés, les villes maritimes incendiées et pillées, les habitants emmenés en esclavage et vendus sur les marchés d'Alger.
Tout ce qui flottait était déclaré de bonne prise et aucun pavillon n'était épargné. La Course prit de plus en plus d'essor entre les mains de renégats qui affluaient de toutes parts, convertis à I'Islam par l'appât du gain. De Grammont cite le cas d'un capitaine flamand, nommé Simon Dausa, qui était venu se faire corsaire à Alger vers l'an 1606 et qui apprit aux Algériens la manœuvre des vaisseaux de haut bord .
Tout cela permettait à la Régence de prospérer « entretenue dans son oisiveté favorite par les dépouilles de la Chrétienté »
Les Barbaresques tiraient d'ailleurs plus de profit des captifs que des marchandises pillées.
« De retour à Alger ou à Tunis, on déversait le cheptel humain sur le marché. Les chalands examinaient les captifs, comme des bêtes sur un foirail, inspectaient leurs dents, leurs yeux et leurs mains, tâtaient leurs chairs, et les faisaient marcher, sauter et cabrioler à coups de bâton. Leur valeur variait selon l'usage ou le bénéfice qu'espérait en tirer l'acheteur. Les jeunes filles ou les jeunes garçons dont le sort était fatal, les gens présumés de qualité, dont on espérait rançon, et les ouvriers spécialisés dans la navigation, les travaux du port et de l'artillerie, étaient particulièrement recherchés. Le maître avait la libre disposition de son esclave qui devenait un objet de spéculation en vue du rachat. »
Réactions des puissances chrétiennes et décadence de la course.
Les fières puissances chrétiennes, ne pouvaient châtier ces pirates, devaient souvent traiter avec eux : elles furent ainsi amener à envoyer à Alger des missions, laïques et surtout religieuses, pour le rachat des captifs.
Les Trinitaires, l'ordre de Notre-Dame de la Merci, les Rédemptoristes, puis les Lazaristes avec Saint-Vincent de Paul, se consacrèrent à cette œuvre. De même le gouvernement des Etats protestants envoyait des missions.
Les rois eux-mêmes traitèrent souvent avec les Algériens pour le rachat d'esclaves qui leur étaient chers. L'historien Raynal note qu'en 1785 le roi de France fit libérer 315 esclaves au prix de 614 200 livres et 60 pour 275 000 livres.
Mais des exactions particulièrement graves, ou les violations de traités, entraînèrent souvent des réactions plus vigoureuses :
Les Anglais bombardèrent Alger en 1622, 1655, 1672.
Les escadres françaises firent de même en 1661 et 1665, puis en 1682 et 1683 avec Duquesne. Cette dernière opération entraîna de graves représailles : le massacre des résidents français, entre autres du Père Le Vacher qui fut attaché à la bouche d'un canon.
Au XVIII° siècle, ce fut surtout l'Espagne qui lança des attaques contre la ville : un corps expéditionnaire fut débarqué sans succès en 1775, Alger fut bombardé en 1783 et en 1790.
Plus encore que les bombardements, les habitudes prises par les navires de commerce de naviguer par convois et de se faire escorter et les réactions de plus en plus vigoureuses des navires de guerre firent péricliter la Course barbaresque.
La piraterie continua, mais au XVIII° siècle, elle devint de plus en plus difficile et de moins en moins fructueuse.
La prospérité d'Alger, due essentiellement aux profits de la course, diminua et le Port ne connut plus son activité d'antan.
Une sérieuse recrudescence de la Course est cependant à noter dans les dernières années du XVIII° siècle, mettant à profit les guerres entre nations européennes.
Mais cette résurrection fut sans lendemain.
En effet, dès la signature des traités de paix de 1815, les puissances européennes s'entendirent pour agir et secouer définitivement le joug :
Les Etats-Unis, décidés à faire respecter leur pavillon, bombardèrent Alger en 1815.
En 1816, la Conférence de Londres établit un projet pour la suppression des Corsaires.
La même année, l’escadre anglaise de Lord Exmouth, jointe à la flotte hollandaise de Van Cappellen bombarde Alger.
Les Barbaresques ne s'avouaient pas vaincus : aux Puissances européennes, assemblées à Aix-la-Chapelle en 1818 et qui I'invitaient à renoncer à la Course, le dey Hussein répondit sèchement qu'il traiterait en amis ses amis et en ennemis ses ennemis.
La course continua: le pavillon pontifical lui-même ne fut pas respecté, ce qui entraîna l'arrivée d'une frégate française, « La Galathée », dans le port d'Alger. Le commandant du navire demanda et obtint réparation.
En 1825, l'amiral anglais Neal bombarde Alger. Le coup d'éventail au consul de France en 1827 entraîne le blocus d'Alger. Les Corsaires tentèrent une sortie, combattirent courageusement, puis rentrèrent au port.
Enfin, le 4 février 1830, après qu'un dernier vaisseau parlementaire, « La Provence », eut essuyé le feu des canons des forts du front de mer, le Gouvernement français annonça à toutes les puissances chrétiennes « son intention de détruire I'esclavage et la piraterie sur toutes les côtes d'Afrique et de rétablir la liberté de navigation dans la Méditerranée par la suppression du tribut que les puissances chrétiennes paient à la Régence ».
L'Algérie allait connaître la paix française.
Algérie 1957, cabinet du ministre de l’Algérie
|
|
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
|
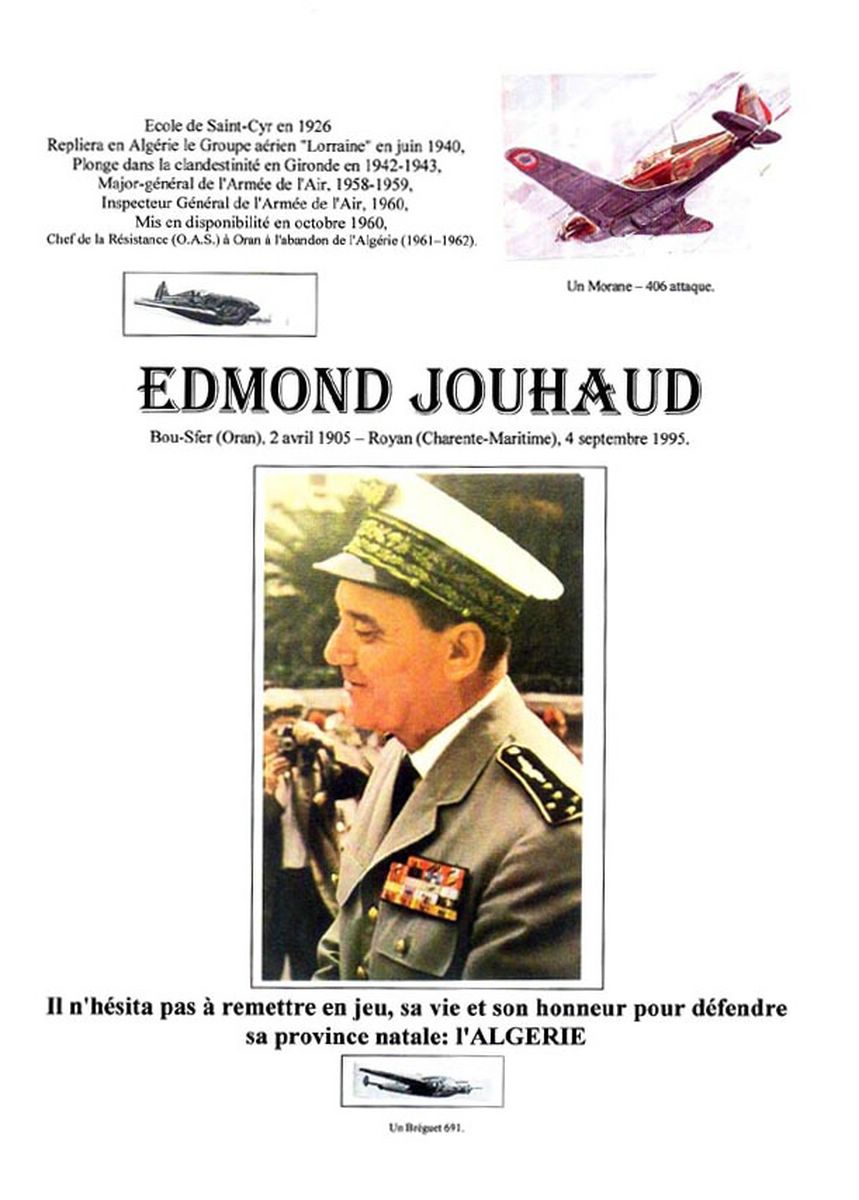 A SUIVRE
A SUIVRE |
|
PHOTOS de BONE
Envois de M. R. Bussola
|
BAIE DE BÔNE

CENTRALE ET LE PORT

CHAPUIS

KOUBA

LE PORT

VUE GENERALE

|
|
| ABSENTÉISME
De Jacques Grieu
|
Le plus mauvais des choix est l’absence de choix.
Du latin « absentia », l’absence nous côtoie.
« Briller par son absence » est… brillant contre sens
Et qui ne risque pas d’assurer la présence.
Si l’absence de preuve est preuve d’innocence,
La preuve de l’absence arrange la défense.
L’absence est signifiante et souvent décisive.
Jamais de vacuité vraiment inoffensive.
La critique la pire : l’absence de critique
Qui pour certains auteurs est injure publique !
Si l’image est mensonge, l’absence de l’image
Est encore un mensonge ; il y a enfumage.
L’existence de Dieu ne serait qu’une absence ?
Mais l’absence éternelle est l’Enfer en puissance !
L’absence de raisons qui seraient bonnes à croire,
Fait que les hommes adhèrent à celles sans espoir.
Nier de Dieu l’existence est une prétention,
Qui fait que Son absence serait révélation.
Le bonheur serait-il, l’absence de soucis,
Comme notre santé, l’absence de maladies ?
L’absence de désir est la morosité;
Mais l’absence de doute est-elle sérénité ?
La mémoire est miroir où l’on voit les absents,
Où les trous de mémoire nous les tuent sûrement.
« Mieux vaudrait mauvais goût que l’absence de goût »,
Assurent des esthètes exempts de tout dégoût.
De bien des expériences, les absences nous façonnent,
Bien mieux que de présences qu’on cultive et moissonne.
J’aurais aimé vanter la chaleur de présences,
Mais demeure tout coi : soudain, j’ai une absence….
Jacques Grieu
|
| |
|
Un vétéran anglais dit son chagrin,
honte à l’Occident !
Pour lui, « le sacrifice » « ne valait pas la peine » quand on voit l'état de la Grande-Bretagne aujourd'hui.
Le petit extrait a fait le tour du monde. À l’approche du 11 Novembre, un vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale, a été invité, vendredi dernier, dans l’émission Good Morning Britain.
 Alec Penstone est impressionnant. Il est tout courbé, a le visage parcheminé et les mains noueuses. Mais tout centenaire qu’il est, celui qui se battit jadis dans la Royal Navy a belle allure, avec son béret blanc, son placard de décorations sur la poitrine et le coquelicot - chez nous, c’est le bleuet - qu’il arbore fièrement en souvenir de ses copains tombés à ses côtés.
Mais l’entretien du « Poppy Day », comme on appelle le 11 Novembre là-bas, ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. Car à la question « Quel est votre message ? », il répond, visiblement très ému : « Je vois en pensée ces rangées et ces rangées de pierres blanches et ces centaines de mes amis qui ont donné leur vie, pour quoi ? Pour le pays d’aujourd’hui ? » Pour lui, « le sacrifice » « ne valait pas la peine », quand on voit l'état de la Grande-Bretagne aujourd'hui. La présentatrice Kate Garraway tente de le réconforter, lui dit que « toutes les générations » qui l’on suivi, « y compris [elle] et [ses] enfants », « sont très reconnaissantes de [son] courage », comme de celui des autres militaires… mais il n'en démord pas.
Commandeur
Il est la statue du commandeur. Un reproche vivant. Les vétérans sont presque tous morts. Ou bien trop affaiblis pour faire montre de colère. C’est bien commode, on leur rend hommage - parfois très mal, d’ailleurs ; on se souvient du dobitchu mémoriel de 2016 : 3.400 jeunes avaient couru sur les tombes, devant les mines ravies de François Hollande et d’Ursula von der Leyen -, on dit que « leur sacrifice nous honore et nous oblige » - tu parles -, et après avoir déposé la couronne de chrysanthèmes, on s’estime quitte.
Il m’est souvent arrivé, lors d’une des ces commémoraisons qui sonnent, dans beaucoup de villes, comme une case que l’on coche rapidement, la « génuflexion oblique des dévots pressés » à la sauce républicaine, de penser à une vieille histoire qui circule entre chiens et loups dans les internats, les tentes de scouts et les maisons de famille quand les enfants cherchent à se faire peur : « Rends-moi ma jambe ! Rends-moi ma jambe ! », chuchote, d’une voix sépulcrale, un vieil unijambiste, du fond de son tombeau, à ses héritiers qui tentent de revendre sa prothèse.
Ce sont le Soldat inconnu, l’ossuaire de Douaumont et tous les cimetières militaires qui pourraient bruisser d’une même voix : « Rends-moi ma France ! Rends-moi ma France ! » L'inclinaison pleine de componction de ceux qui nous gouvernent devant ces cénotaphes sont l’hommage du vice à la vertu, celui du cambrioleur qui boit aimablement à la santé du propriétaire dont il a crocheté la cave et bradé les bouteilles : la famille, l’armée, l’agriculture, l’industrie, la culture, l’éducation, la santé, la religion, rien que des valeurs sûres, des siècles d’âge, allez hop ! toi, tiens, prends-ça, tout doit disparaître. C’est la FOB. La France-Open-Bar. Et dire qu’ils sont morts pour elle. Et pour ses frontières ouvertes à tout vent.
Tombe pillée
Mais Alex Penstone lui, a encore bon pied, bon œil. On ne peut pas faire semblant de prétendre que les fantômes n’existent pas : ce n’est pas une voix d’outre-tombe. Mauvaise nouvelle pour Keir Starmer, déjà bien en peine avec Nigel Farage qui s’envole dans les sondages.
Honte à l’Angleterre. Mais soyons honnêtes : nous ne valons guère mieux. Comme tous les Occidentaux dont les aïeuls se sont battus dans l’enfer de ces deux guerres mondiales.
Il y a quelques jours, à Thézillieu dans l’Ain, la tombe du capitaine Barrucand, héros de la Première Guerre locale, a été vandalisée et pillée. Quel symbole !
https://www.bvoltaire.fr/edito-tant-de-sacrifices-vains-un-veteran-anglais-dit-son-chagrin-honte-a-loccident/?utm_source=Quotidienne_BV&utm_campaign=cd0f40252d-MAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-cd0f40252d-30332173&mc_cid=cd0f40252d&mc_eid=d76c6e44fa
|
|
ENTRETIEN AVEC MADAME
ANDREE ORTIZ
VERITAS N°9, janvier 1997
|
|
Madame Ortiz est seule, avec ses souvenirs, depuis bientôt deux ans. Son époux l'a quittée le 16 février 1995, victime d'une hémorragie cérébrale.
Elle aurait beaucoup de choses à raconter si I'on voulait, seulement l'écouter, elle qui a été, pendant toute une vie, la compagne et la confidente de l'homme des Barricades.
Mais ses réminiscences sont empreintes d'amertume. Ne voit-elle pas se déchaîner, à l'heure actuelle une foule de prétendus témoins qui ont, tous, fait merveilles ( à se demander pourquoi nous avons perdu notre chère Algérie ?) et qui se substituent, volontiers, aux vrais héros, aux derniers témoins, des faits, totalement, imaginaires ne servant que leur gloire usurpée.
Il a fallu insister, la forcer un peu, Andrée Ortiz, pour qu'elle se mette à parler, pour qu'elle comprenne qu'il n’y avait pas de piège, pas d'ambiguïté, pour qu'elle sache que VERITAS ne souhaite que la Vérité.
Elle nous a alors, en premier lieu, exprimé sa réprobation son ressentiment devant I'attitude du Général de Gaulle à l'égard de son époux.
De Gaulle s'était écrié : - « Un Ortiz, ce qui n'est même pas français, se levant contre la France ? Mais c'est ridicule ! Il ne faut pas donner de l'importance à ces gens-là.»
Gageons qu'à ce moment-là, le Général ne se souvenait même plus, d'une certaine famille Kolb ! ( Voir Alain Peyrefitte).
Pourtant, Français, Joseph Ortiz l'était bel et bien. Il était, même, pupille de la Nation parce qu'avant lui, un autre Ortiz, celui qui lui avait donné la vie, été mort pour cette Patrie, la France, qui, par la bouche de de Gaulle, avait I'air de le renier.
Alors, parce qu'il était français, tout comme l'étaient, en Algérie, les Bouaraf, les Zerbib, les Mastroni et les Durand qui ont, dans tous les conflits, généreusement offert leurs vies à la Mère-Patrie, Joseph Ortiz s'engagea lors de la seconde guerre mondiale et, après avoir vaillamment combattu pour son pays, la France, il fut fait prisonnier à Dunkerque.
Prisonnier, déporté dans un camp en Allemagne, il tenta, à trois reprises, de s'évader et ne réussit qu'à la troisième où il put rejoindre la zone libre pour continuer le combat.
Il s'appelait Ortiz, c'est vrai. Ses lointains ancêtres étaient venus d'Espagne pour s'installer sur une terre française baignée de soleil et cette terre ils I'avaient aimée au point de se fondre dans un creuset d'où sortait une race, aujourd'hui disparue, de pionniers, de braves, de patriotes français !
Et peu lui importait de s'appeler Ortiz. Il était Algérois et chauvin. Sa terre d’Algérie était une terre française qu’il était prêt à défendre en versant son sang, exactement comme il l'avait fait sur la terre de France, à Dunkerque.
Lorsqu'il comprit que l'homme du 18 juin était en train de trahir sa parole et d'entamer un dialogue honteux avec des terroristes barbares, minorité ennemie de la France, vaincue sur le terrain ou en passe de l’être le patriote qui s'appelait Ortiz ne put le supporter.
Il fonda le F.N.F. (Front National Français), mouvement qui prit une ampleur immédiate et insoupçonnée par la métropole puisque la majeure partie des Français d'Algérie et bon nombre de Français-musulmans y adhérèrent, spontanément.
Elle se souvient.... Andrée Ortiz, avec émotion, avec tendresse, des milliers et des milliers de pauvres gens qui venaient déposer, entre les mains de son grand homme, leurs espoirs et leur confiance.
Elle se remémore, aussi, le temps des Barricades. Cette période troublée où, bien que flairant le piège, son époux avait angoissé le Prince de l'Equivoque dont le complot avait bien failli échoué.
Elle revoit les quinze cents bottes noires des C.R.S qui sont descendus du Forum, canon pointé, affirme-t-elle, et non la crosse en avant... Elle évoque le fusil-mitrailleur, traquenard disposé là par les hommes du pouvoir, qui, du Forum, tirait, aussi bien sur les manifestants que sur les C.R.S....
Elle parle du désespoir des insurgés devant les morts français de part et d'autre. Désespoir, dit-elle, qui les a contraint à se retrancher dans leurs camps pour éviter toutes nouvelles effusions de sang,
Cette attitude a fait échouer, en partie, la conspiration qui prévoyait un bien plus grand nombre de morts, de part et d'autre afin de pouvoir dire à la France : « Les Pieds-Noirs sont des assassins qui ne mérite pas de vivre et doivent être abandonnés à la vindicte du F.L.N.»
Elle parle aussi de l'exil de son époux. Ces quelques mois de cavale, dans son propre pays puis son départ vers l'Italie. Le temps, infiniment long, où, étroitement surveillée par la police, elle ne pouvait ni le voir, ni même avoir de ses nouvelles.
Elle se rappelle des amis proches... Lorsque son époux put s'embarquer pour l'Italie, Jean Brune et pierre Bruno l'attendaient, sur le port de Gênes. C'est Jean Brune qui I'aida ensuite à gagner la Suisse d'où il parvint à prendre un avion pour Madrid. Toute cette cavale d'un patriote pour continuer à servir, détendre sa patrie et sa terre...
En l'écoutant, je sens, aussi, l'émotion me submerger. Que d'épreuves difficiles avons-nous supportées lorsque que nos époux se sont rendus coupables du crime de patriotisme ! Elle racontait, d'une voix hachée, son angoisse permanente et, à l'autre bout du fil, moi qui ne pleure pas facilement, je sentais sourdre à mes yeux des larmes amères. Se dire « Je ne sais pas où est mon époux... j'ignore, même, s'il est vivant...» Il faut avoir connu pareille situation pour comprendre. Son époux après les Barricades connaissait les fonds de cale et la peur, le mien, après le putsch, a été l’hôte de « la police parallèle » des Tagarins. Il faut avoir connu cela pour se sentir soudain, malgré le temps, malgré la distance, unies comme deux victimes du même sort, comme deux êtres atteint par le même virus, comme deux sœurs...
A ce moment de la conversation, Chère Andrée Ortiz, j'ai eu envie de vous serrer dans mes bras et de vous dire :
« Quand on est deux, on a moins mal et on trouve la force de témoigner.... »
Vous avez conclu en approuvant, totalement, I'analyse de Michel Sapin-Lignières. Vous avez rappelé que, pendant quelques jours, Joseph Ortiz avait été « le maître d'Alger » tandis que, renfermé à la Boisserie, par une campagne jaunie par la pluie qui fouettait les vitres, le chef de l'Etat tremblait.
Dix ans d'exil, une condamnation à mort par contumace et plus tard, enfin, I'amnistie, l’installation en terre française et ce militantisme, qui n'a jamais vacillé, pour que soient dénoncée l'ignominie et que triomphe la vérité.
Français, homme d'honneur et de parole, tel était Joseph Ortiz, votre époux. Merci d’avoir témoigné pour lui.
Interview d'Andrée Ortiz
Propos recueillis par Mme Cazal
|
|
|
Vous n’avez rien à déclarer ?
Envoyé par M. Marc DONATO
|
|
C’était dans les années 60.
Une époque où notre pays avait encore des frontières, des vraies, avec des barrières qui se levaient ou s’abaissaient ; des douaniers, des purs, le front marqué à jamais par un képi porté depuis trop longtemps, chemise bleu marine, pantalon bleu marine, galon rouge, et tout et tout…
Les frontaliers les connaissaient bien, eux qui allaient fréquemment faire leurs emplettes en Belgique ou au Luxembourg, de nombreux produits étant moins chers qu’en France. Et les douaniers étaient chargés de vérifier que ces fraudeurs, dont je faisais partie, ne dépensent pas trop d'argent dans les pays voisins. Pour le carburant, notamment, toujours surtaxé chez nous. Ainsi, avant de franchir la barrière, il était obligatoire de cocher sur un bulletin remis par le préposé des Douanes, le chiffre approximatif du nombre de litres de carburant dans le réservoir avant passage et qui devait correspondre au niveau de la jauge au retour.
Il me faut confesser d’un cœur réellement meurtri que j’ai bénéficié de certains privilèges. Comme j’avais les enfants de ces douaniers dans ma classe !!! Mais je dois avouer aussi que je n’ai jamais failli à l’intégrité et à la vénalité. Les douaniers de même, assurément. De toute façon, il y a prescription pour ce qui, somme toute, restait des vétilles.
Alors, pour les contrebandiers d’occasion, tout le jeu consistait à éviter les contrôles. Peut-être qu'à l'heure de la sieste ? … Ou par temps de pluie ? … Ou encore la nuit ? …
Justement cette nuit-là, Bingo ! Sur le coup de minuit, de retour d'une séance cinéma à Luxembourg-Ville, le douanier de service nous attendait à la barrière. C'était un Guadeloupéen, à moins qu'il fût Martiniquais, allez savoir, dans la sombre nuit, comme aurait Victor (Hugo) ! Seule sa lampe torche révélait sa présence, dispensant généreusement un rayon inquisiteur à un moment où la lune, absente, honorait certainement un rendez-vous avec le soleil. Une Trenet, celle-là. (Excusez, je n’ai pas pu m’en empêcher !).
Aie ! On les savait sévères, ces Ultramarins, pleins de la rage que l’Administration les ait nommés aux antipodes glaciaux de leur île chaude et ensoleillée. Ils déversaient alors leur vindicte sur le menu fretin avec l’application stricte, voire tatillonne, de la législation. N’avaient-ils pas subi avec succès les épreuves d’un concours - oh combien difficile ! - qui aurait dû leur permettre de rester au pays ? Alors un peu de zèle ça ne nuit pas pour l’avancement et à la notation pour une demande de mutation… Mon copain au volant avait, bien sûr, fait le plein d'essence pensant bien échapper aux gabelous à cette heure avancée de la nuit. Le faisceau lumineux de la torche de l’autorité douanière trouva directement l’endroit de la jauge impartiale qui attestait du délit. Mais le suspect de contrebande ne s’est pas démonté de son aplomb qui faisait sa réputation : avec une outrecuidance et une effronterie à nulles autres pareilles, il fit remarquer que, passant à tel poste frontière, à l’aller, la voiture penchait vers l'avant, alors que de retour au poste actuel, elle penchait vers l'arrière et ainsi la jauge variait. Il fallait l’inventer celle-là ! Qui pouvait adhérer à un tel discours ? C'était énorme, et affirmé avec une telle impertinence que le douanier en fut estomaqué. Désarçonné devant l’outrecuidance de l’argument, désabusé, il a répondu sur un ton qui enchante encore mon oreille aujourd'hui :
- Alo vous me penez pou un con. Allez ciculez !
L’audacieuse effronterie avait eu raison de la Loi. Plus c’est gros, plus ça passe !
Et nous avons filé sans demander notre reste avec la jouissance puérile d’avoir trompé le fonctionnaire.
À une autre occasion, revenant de Valenciennes, j'avais ramené un ou deux Maroilles. Vous savez, le ch’ti fromage, le « Marouelles » qui fait l'orgueil des gens du Nord. La Picardie à son Maroilles comme l'Aveyron son roquefort, la Corse son brocciu, l'Alsace son Munster... J’arrête là. Révisez votre petit Charles de Gaulle illustré et ses 258 variétés de fromage.
Ah ! Le Maroilles ! D’aucuns vous diront grossièrement qu'il pue, d'autres, dont je suis, préfèreront dire qu'il a du caractère, ou sur un mode poétique déclareront la bouche en cul de poule, qu’il offre “une touche aromatique persistante et onctueuse“. Ah ! Ça pour être persistante, elle est persistante la touche aromatique !
Au point qu'on peut difficilement cacher à un douanier (ne dit-on pas que ces gens-là ont du nez !) qu'on transporte du Maroilles, fromage par ailleurs tout à fait hors de la liste des produits interdits d’importation et qui ne suscitait pas l'amende.
Après avoir longé la frontière en Belgique, prix de l’essence obligeant, je rentrai en France et tout naturellement, à la douane, le gabelou de service me demanda d'ouvrir le coffre.
- Vous n'avez pas besoin de me dire ce que vous transportez !!!
Il était finaud, quand même ! Rien ne lui échappait à celui-là ! Avec un flair pareil, il a certainement fait carrière !
Voilà qui me fait penser que ce serait un bon moyen quand on dérobe les bijoux du Louvre de les faire passer de l’autre côté… dans un Maroilles.
Mais, chut ! Vous ne vous voyez pas avec une émeraude de la reine Hortense sous la molaire ???
Marc DONATO
|
|
Les retraités responsables ? Non !
L’État, oui !
|
|
En 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, chef de l’État français, avait mis en place un gouvernement communiste.
Pour les communistes, l’une des préoccupations majeures était de replacer au premier rang les droits des travailleurs, ouvriers et salariés, face à la prépondérance du patronat et du capitalisme.
L’un des principaux projets fut d’élaborer puis de mettre en pratique un système de retraite général, à l’intérieur d’un régime de sécurité sociale pour tous.
Deux solutions étaient envisageables pour les économistes de l’époque : la première consistait à un système par capitalisation (mais ce mot était particulièrement honni par les socialo-communistes). Il s’agissait, pour chaque salarié, de se voir prélever une certaine somme sur son bulletin de paye chaque semaine ou chaque mois, complétée par une partie égale versée par l’employeur.
Ces sommes, placées dans des mutuelles de gestion de retraite, permettraient à chaque salarié de bénéficier d’une retraite au bout de X années « retraite qu’ils s’étaient payée eux-mêmes ». Cette solution paraissait la plus valable.
Le problème majeur de ce système demeurait celui des salariés n’ayant jamais cotisé et arrivant successivement à l’âge de la retraite à partir de 1946 et les années suivantes.
La seconde solution, pour répondre justement à ce dernier point : celui des 2 millions environ de salariés « n’ayant jamais cotisé », serait que « ces sommes prélevées sur les bulletins de salaire » serviraient non pas à payer sa propre retraite « mais celle des salariés nés dans les années 1875 et les suivantes, et qui étaient en droit de faire valoir immédiatement leur droit à un départ en retraite à partir de 1945. »
Ce fut cette seconde solution qui fut retenue par le gouvernement de gauche de l’époque : ceux qui cotisaient payaient pour ceux qui partaient en retraite.
On peut affirmer, aujourd’hui, que ce ne fut pas un bon choix, puisqu’il est à l’origine de tous nos problèmes actuels.
D’autant plus que l’âge du départ à la retraite était fixé à 65 ans, alors que l’espérance de vie, à l’époque, était de 63 ans pour les hommes et de 67 ans pour les femmes.
Il eût été bien plus judicieux de réserver un « fonds de 2 à 3 milliards » pour payer les retraites de ces quelques 2 millions de « salariés » qui n’avaient jamais cotisé. (À l’époque cela était tout à fait possible grâce aux 13 milliards du « Plan Marshall »)
Il est vrai que, toujours à l’époque (1946) il était difficile d’imaginer que d’une part la natalité baisserait à un tel point et que, par ailleurs, l’allongement de la vie serait aussi important. Et que les 5 actifs qui cotisaient pour 1 retraité ne seraient plus que 1,4 pour un retraité en 2025. Et que l’espérance de vie est, aujourd’hui, de 85 ans.
N’accusons pas les retraités d’être coupables de cette situation catastrophique alors qu’il s’agit de la diminution drastique des « cotisants ».
Et ce ne sont pas les centaines de milliers de migrants en situation irrégulière qui sauveront notre système de retraite, ni d’ailleurs les migrants en situation régulière car leur taux de chômage est bien plus important que celui des « nationaux ».
Manuel Gomez
14 novembre 2025
|
|
Fiasco total
13 novembre 2025 Jacques Guillemain
|
Détournement d’un MIG-31 russe
armé d’un missile Kinzhal
Le FSB vient de déjouer une tentative de détournement d’un MIG-31 armé d’un missile hypersonique Kinzhal. Cette opération, une provocation apparemment d’origine ukro-britannique, destinée à simuler une attaque russe contre une base Otan en Roumanie, afin d’impliquer directement l’Alliance dans le conflit, aurait pu avoir de lourdes conséquences et rendre la situation incontrôlable.
La défaite de Kiev se profilant à l’horizon et Trump semblant se lasser de cette guerre « qui n’est pas la sienne mais celle de Biden », Zelensky et les têtes brûlées britanniques qui le soutiennent semblent avoir joué dangereusement avec le feu nucléaire ces derniers jours.
Car ces fous furieux veulent absolument impliquer l’Otan dans une guerre totale contre Moscou. Et il serait bien naïf de penser qu’un tel affrontement de titans se limiterait aux armes conventionnelles. La Russie ayant un avantage écrasant dans le domaine hypersonique, les Américains ne pourraient répliquer qu’avec l’arme nucléaire tactique, voire stratégique dans le scénario du pire.
Il faut croire qu’au Royaume-Uni, quelques fous furieux sont prêts à risquer l’Apocalypse pour vaincre la Russie à n’importe quel prix. Voilà 45 mois que Zelensky attend l’engagement de l’Alliance à ses côtés. Certains Européens, dont Macron, en rêvent aussi.
Résumons
Le renseignement ukrainien a tenté de soudoyer un équipage de MIG-31, pilote et officier système d’armes, pour voler un appareil armé d’un Kinzhal et aller se poser sur une base Otan en Roumanie. Tarif : 3 millions de dollars et un passeport avec citoyenneté d’un pays étranger.
Contacté, le pilote a refusé. Le renseignement ukrainien s’est alors tourné vers le navigateur, lui proposant de liquider le pilote en enduisant son masque à oxygène de poison. Ce qui paraît assez fantaisiste puisqu’un navigateur ne peut en aucun cas poser l’avion. Si le pilote est en incapacité de piloter, une seule issue : l’éjection.
En fait, l’avion n’avait pas vocation à se poser. Il devait être abattu à l’approche de la base Otan, créant ainsi un prétexte pour l’entrée en guerre de l’Alliance. C’était du moins l’objectif de l’opération.
Bref, l’équipage n’est pas tombé dans le panneau. Le FSB, informé dès la première prise de contact entre les Ukrainiens et l’équipage, a suivi le déroulement de l’opération et l’a sans doute pilotée dans le dos de Kiev.
Cette tentative nous rappelle la sinistre histoire du détournement d’un hélicoptère russe. Cette fois-là, les Ukrainiens ont réussi leur coup. Le pilote a posé son hélicoptère à la frontière ukrainienne, mais a dû liquider ses camarades qui ne voulaient plus s’associer à cette trahison. Mauvaise pioche : on l’a retrouvé mort en Espagne quelques mois plus tard.
Ne prenons pas les services de renseignement russes pour une entreprise de bienfaisance…
La conclusion de tout cela est qu’il faut s’attendre à d’autres attaques sous faux drapeau pour attiser les braises et accuser Moscou. Il en est ainsi depuis février 2022.
Puisse cette guerre se terminer au plus vite afin que les têtes brûlées européennes soient écartées définitivement du conflit. Elles sont capables du pire pour ne pas assumer leur humiliante défaite. Car ce sera bien leur défaite et celle de Biden. Trump quant à lui, s’en lavera les mains.
|
|
« Je n’ai pas un goût particulier pour le renoncement et le déshonneur »
(Lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume).
L’actualité de notre foutu pays est désespérante et je n’ai pas envie de la commenter. J’en ai assez de me faire traiter de pessimiste, voire de défaitiste, alors que je pense très sincèrement être… lucide. Tout va mal et, depuis l’arrivée au pouvoir de Macron, tout s’accélère. J’assiste, impuissant, à la descente aux enfers de notre nation. Je n’ai plus envie d’en parler, j’ai l’impression de radoter.
Je suis nostalgique d’un passé où la France tenait encore son rang dans le monde, où la « fille aînée de l’Église » n’était pas devenue la catin de l’islam, et où elle ne tapinait pas non plus pour les maquereaux de Bruxelles. Mais peut-être sont-ce les frimas et la pluie de ce triste mois d’octobre qui me rendent si morose ? Je trouve notre époque vile, sale, décadente et dégénérée. On a même tué l’esthétique et la beauté dans notre cinéma qui s’inspire des productions violentes, braillardes et vulgaires américaines. Ceux qui trouvent que je noircis le trait devraient regarder les films français des années 1960-1970. Ce qui frappe quand on revoit ces films c’est… la propreté.
Je vais très rarement au cinéma, mais il arrive, de temps en temps, qu’une chaîne de télé nous ressorte un bon film ; un vieux Gabin, sur des dialogues d’Audiard, comme récemment Un taxi pour Tobrouk. Où, il y a quelques jours, Le Crabe-Tambour de Pierre Schoendoerffer, tiré du roman éponyme du même. J’ai lu tous les livres de Schoendoerffer. Le Crabe-Tambour est un roman émouvant. Je le préfère au film qui, bien que servi par de bons acteurs (Jacques Perrin, Jean Rochefort, Claude Rich, Jacques Dufilho…) sur des images de Raoul Coutard (1), est à mon avis, moins réussi que La 317e section, L’honneur d’un capitaine ou Diên-Biên-Phu.
Toute l’œuvre de Pierre Schoendoerffer – romans ou films – raconte des histoires d’hommes, de soldats, de camaraderie, de causes perdues, d’honneur. Le Crabe-tambour est très fortement inspiré par la vie d’un officier de marine, un héros oublié, le lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume auquel je veux rendre hommage aujourd’hui car il le mérite. Il pourrait être un exemple, un modèle, pour les jeunes générations qui ne savent pas ce qu’est un idéal. Ce n’est pas de leur faute, le fric-roi, l’égocentrisme narcissique et le matérialisme athée ne peuvent pas tenir lieu d’idéal. On connaît la citation de Napoléon « Quel roman que ma vie ». Pierre Guillaume aurait pu en dire autant d’une vie périlleuse et mouvementée au service de la France ; une vie de droiture, de courage et de devoir.
Pierre Guillaume est né le 11 août 1925 à Saint-Servan-sur-Mer (aujourd’hui Saint-Malo). Il est le fils de Maurice Guillaume, saint-cyrien, général de brigade de réserve et directeur de journaux.
Après avoir appartenu à l’entourage de Lyautey au Maroc, il se lança dans la politique en créant l’hebdomadaire de droite Choc. Il fut chargé des questions nord-africaines au cabinet de Pétain, qui le promut général en 1943, ce qui lui valut des démêlés avec la justice à la Libération.
Dans la famille Guillaume, on cultivait la foi chrétienne et un nationalisme exacerbé.
Pierre entre à l’École Navale en 1945, puis il part en Indochine où il sert dans une Division Navale d’Assaut, les célèbres « Dinassaut ». Il fera trois séjours en Indochine (1945 ; 1948-1950 ; 1953-1955). Marin et soldat d’exception, il participe, entre autres, aux opérations contre le Vietminh en Cochinchine. Après les accords de Genève, en 1954, qui marquent la fin du conflit en Indochine, il termine la guerre avec le grade de lieutenant de vaisseau. Désobéissant au haut commandement, il va sauver 1600 catholiques vietnamiens qui fuient le communisme (2) en les embarquant sur des bâtiments de la marine. Puis il décide de regagner la France, seul à bord d’une vieille jonque, le « Manohara » (3), mais il s’échoue sur les côtes somaliennes, le 13 novembre 1956. Il est recueilli par une tribu locale, assez fascinée par ce prisonnier aux cheveux roux, au point qu’il ne sait pas très bien s’ils le considèrent comme un prisonnier ou comme un dieu.
La marine paiera une rançon pour le faire libérer. Fin 1956, il rentre à Paris, alors qu’un nouveau conflit fait rage en Algérie.
Le 22 mars 1957, il apprend que son frère Jean-Marie, 29 ans, lieutenant parachutiste, est tombé à la tête de son commando dans le secteur de Mouzaïaville, en Algérie.
Pierre Guillaume demande immédiatement son changement d’arme et obtient d’être muté (provisoirement) dans l’armée de terre, pour remplacer son frère à la tête de ce qui deviendra le « commando Guillaume ». Il suit une formation commando et passe son brevet para. Il sera le chef du « commando Guillaume » pendant dix mois, puis le marine réclamera sa réintégration. Après un temps de commandement sur l’escorteur l’« Agenais » en 1958-1960, il est nommé à l’état-major du commandant en chef des armées françaises en Algérie. Comme beaucoup de militaires et de pieds-noirs, il vit mal les changements de discours du pouvoir puis la trahison gaulliste. Il pressent le bradage de l’Algérie française. Lors du putsch des généraux du 21 avril 1961, Pierre Guillaume a choisi son camp. Il passe à la dissidence et sera l’adjoint « marine » du général Challe. Arrêté, il est condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. La peine est légère et pourtant il n’a rien fait pour l’atténuer. Lors de son procès, il déclare : « Je ne regrette qu’une chose, c’est que nous ayons provisoirement échoué ». Et, parlant de ses chefs de la marine en Algérie, il dit : « Je les jugeais irrécupérables… ». Désireux de continuer le combat, il repart en Algérie et devient l’adjoint du général Edmond Jouhaud passé dans la clandestinité. Arrêté en mars 1962, il est condamné à huit ans de détention, il en purge quatre à la prison de Tulle, avec les généraux Salan et Jouhaud, les colonels de Sèze et de La Chapelle, les commandants Camelin, Robin et Denoix de Saint Marc.
À sa libération, il préside la Guilde européenne du raid (4) – une association se consacrant à l’aventure – à sa fondation en 1967. Il travaille avec l’ex général Challe et occupe diverses fonctions dans des sociétés d’affrètement maritime. Les deux hommes finiront par se brouiller pour des motifs qui n’appartiennent qu’à eux. L’un comme l’autre étaient des caractères entiers qu’il était sans doute difficile de faire travailler ensemble trop longtemps.
J’ai connu plusieurs anciens combattants de l’Algérie française. Certains étaient des amis : le général Edmond Jouhaud, le seul pieds-noirs du quarteron de généraux du putsch d’Alger d’avril 1961. Je lui avais été présenté, lors d’un méchoui à Royan, par mon ami Marcel Bouyer. Pour rire, le général Jouhaud m’avait décerné le titre de pieds-noirs d’honneur pour mes écrits en faveur des harkis et de l’Algérie française. Le colonel Pierre Château-Jobert dit « Conan » que j’ai vu à plusieurs reprises chez mon ami Jean Briard. Le commandant Henry-Jean Loustau qui fut président de l’Union Nationale des Parachutistes. Marcel Bouyer, résistant, député UDCA (5) et co-fondateur du réseau « Résurrection-Patrie » de l’OAS-métro. Un engagement qui lui vaudra six années de prison.
Jean Briard, son bras droit dans l’OAS, qui écopera de neuf mois de prison sans procès ; « le temps d’une grossesse » aimait-il à dire. Pierre Sergent lors d’une dédicace de livres. Et quelques autres moins connus, des « soldats perdus » de l’Algérie française, qui ont tout perdu sauf l’honneur.
J’aurai aimé connaître Pierre Guillaume mais j’ai raté le coche. En 1978, un ami m’avait dit que Le Crabe-Tambour traînait au port de Lorient. En douce, il affrétait un vieux chalutier breton, rebaptisé « l’Antinéa », qui était officiellement un navire océanographique mais qui, en réalité, allait permettre à Bob Denard et quarante trois mercenaires de débarquer aux Comores pour renverser le régime marxiste d’Ali Soilih et rétablir Ahmed Abdallah au pouvoir.
Ensuite Pierre Guillaume se consacre au renflouement de bateaux. Entre 1981 et 1987, il est en Arabie Saoudite, où il s’occupe des systèmes de défense maritime de l’émirat.
Sur la fin de sa vie, il rédige ses mémoires, en collaboration avec Élisabeth Escalle (6) mais il lui demande de ne les publier qu’après sa mort. Et c’est également après sa mort que Georges Fleury lui consacrera un livre (7). Le vieux marin vivait à bord de son voilier, L’Agathe, dans le port de Saint-Malo.
Quasiment jusqu’à son décès, il a animé un « Libre Journal » hebdomadaire sur Radio Courtoisie. Pierre Guillaume est mort le 3 décembre 2002, à 77 ans, au terme d’une existence faite de courage, d’abnégation, d’honneur et de sens du devoir. Il est inhumé à Rueil-Malmaison.
Eric de Verdelhan - 1er novembre 2025
1)- Raoul Coutard est un ancien d’Indochine comme Pierre Schoendoerffer.
2)- Ces chiffres sont avancés par les survivants eux-mêmes.
3)- En fait ce n’était pas une jonque mais un ketch à bouchains vifs de 8 mètres de long.
4)- Dont l’actuel président est l’écrivain Sylvain Tesson.
5)- UDCA : Union de Défense des Commerçants et Artisans ; le mouvement Poujade
6)- Mon âme à Dieu, mon corps à la Patrie, mon honneur à moi de Pierre Guillaume et Elisabeth Escalle ; Plon ; 2006
7)- On l’appelait le Crabe-Tambour : Le destin du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume de Georges Fleury ; Perrin ; 2006
|
|
LES UNITES TERRITORIALES DISSOUTES
Par MICHEL SAPIN-LIGNERES
VERITAS N°9, janvier 1997
|
|
Déjà s'éclaircissent les rangs de ceux des nôtres qui ont servi dans les U.T. Bientôt, il faudra expliquer aux jeunes que ces initiales sont celles des Unités Territoriales qui, en Algérie, dans toute l'Algérie, ont fait, consciencieusement, leur devoir, permettant, ainsi, à l'Armée de faire le sien et, ce n'est plus un secret pour personne de rappeler qui, si la guerre fut gagnée sur le terrain, elle fut, diplomatiquement, perdue par la volonté d'un homme pour lequel nous avions, pourtant, déblayé les avenues du pouvoir. Il ne nous aimait pas et il nous a, sciemment, menti.
DES MILIEUX AFRICAINS AUX U.T.
Il faut bien reconnaître, d'ailleurs, que la participation de la population civile à la défense de l'Algérie ne fut pas une invention de cette guerre. Déjà, en 1830, le Général Clauzel avait eu recours aux «Milices africaines ». Elles surent se battre si bien qu'elles purent s'emparer d'un étendard brandi par des Hadjoutes qui se croyaient invulnérables parce que l'ensemble de l'Armée guerroyait en Oranie. Ils ne savaient pas que, dans les murs d'Alger restait, avec le Général Rapatel, un escadron de Chasseurs d'Afrique et l'escadron des Milices africaines. Non loin de Boufarik, ils rejoignirent les agresseurs, les défirent et leur étendard resta entre nos mains.
A chaque fois, la paix revenue, les milices furent dissoutes, sauf les pompiers qui ont, là, leur origine
Il convient de se souvenir que l'Algérie a répondu «présent» à toutes les demandes lancées par la Patrie, que ce soit en 1870, en 1914 ou en 1940 et, à chaque fois, les Algériens rentraient chez eux - moins nombreux, certes - mais le cœur gonflé par les propos chaleureux qui les avaient accompagnés : sacrifice inoubliable.... auxquels ils crurent mais durent déchanter quand ils virent une partie importante de la métropole refuser de leur venir en aide.
Il est vrai que les gouvernements de la France ont bien souvent exprimé qu'ils n'aimaient pas l'Algérie, que ce soit les Orléanistes en 1830, les républicains en 1848, le Front populaire en 1934, les communistes, toujours et, enfin, les gaullistes.
Parce que je fus aux U.T. un des leurs et même, un certain temps, leur chef, j'ai pensé qu'il était de mon devoir, avant l'oubli, de dire aux jeunes générations ce que furent leurs pères; mais si j'aborde ce travail en témoin, je le fais, aussi, en historien, c'est-à-dire que tous mes propos sont vérifiables, certifiés par d'authentiques preuves ou d'irrécusables témoins.
LES U.T.: POURQUOI ?
Face à la guerre révolutionnaire qui nous était imposée, l'Armée avait deux missions essentielles. L'une, mission active s'il en fût imposait de courir aux katibas rebelles et de les détruire ; l'autre, passive, consistait à protéger la population contre le terrorisme. C'était une mission sans gloire, tout aussi indispensable que l'autre mais qui se montrait grande dévoreuse d'effectifs car il fallait être présent et en armes partout, être vigilant, de jour et de nuit, à la porte des écoles, bien sûr, mais, aussi, sur les marchés, dans les transports publics et même devant les cinémas ou les bals, faire la chasse aux paquets abandonnés, se méfier de circulations intempestives, agir de telle sorte que, avec la sécurité revenue et la peur éradiquée, renaissent le calme, la confiance et, par eux, une santé morale à toute épreuve. En un mot, c'était mettre la population toute entière et d'un bout à l'autre de l'Algérie dans des conditions telles que, réagissant comme un humain attaqué par un virus, elle en vienne à sécréter, elle-même, les anticorps qui la délivrait de ses agresseurs ou les réduirait à quelques foyers localisés que l'Armée, alors, viendrait détruire.
Comme on ne sait pas où les terroristes vont frapper, il faut être présent partout pour démoraliser les agresseurs, dépister les lanceurs de grenades, contrôler les identités, pour déceler des déplacements inopportuns, quadriller toute la ville, se montrer, ostensiblement, partout.
Ce devrait être la mission de la police mais elle n'a, évidemment, pas les effectifs suffisants pour ce faire. La gendarmerie encore moins et le gouvernement ne veut pas mobiliser plus avant les réservistes métropolitains car cela coûterait trop cher et, surtout, serait impopulaire.
Alors, quelqu'un qui avait, sans doute, des réminiscences historiques, a ressorti la solution des Milices africaines qui eut, aussitôt, la faveur unanime du gouvernement sous la seule réserve d'en modifier le nom car le nom de « milice » avait pris, dans un proche passé, une connotation qui n'était guère désirable et, ainsi, naquirent les UNITES TERRITORIALES, les U.T.
LES U.T. COMMENT ?
Ainsi fut décidée la mobilisation, en Algérie, de toute la population masculine en état de porter les armes, jusqu'à 48 ans mais il ne devait être demandé à ces réservistes qu'un service partiel dans le temps, trois ou quatre jours par mois, quelquefois davantage, selon les circonstances. On n'avait pas à craindre l'impopularité d'une telle mesure puisqu'elle consistait à associer la population à la sécurité de ses propres foyers.
La métropole ignora tout de cette charge pesant sur les Français d'Algérie, impôt du sang, heureusement limité mais, aussi, impôt de temps et d'argent car, pour ceux de ces réservistes qui était à salaire horaire, cela représentait une charge importante mais c'était vrai, aussi, pour les commerçants et les professions libérales ; Quant aux réservistes à salaire mensuel, je ne pense pas qu'il y ait eu un seul patron pour retirer la paye des journées passées au service commun mais cela se traduisait par des heures supplémentaires ou des vacations les dimanches.
Pour s'en tenir à Alger, il y avait 25.000 U.T. fournissant un travail quotidien de 2.500 hommes soit l'équivalent de ce qu'auraient pu fournir trois régiments.
Le commandement prit l'heureuse initiative de grouper ces réservistes, toutes armes confondues, dans des compagnies dont les P.0 étaient à proximité de leurs résidences. Il en espérait un quadrillage plus efficace; Non seulement ce résultat fut acquis niais, par elle, de surcroît, les habitants d'un même quartier apprirent à mieux se connaître et à faire, dans la bonne humeur un service, parfois, lassant.
Comment pouvait-il en être autrement puisque le contrôleur d'hier devenait le contrôlé du lendemain. Au-delà de cette efficacité se réalisait une entente profonde qui n'avait plus qu'une seule volonté : éradiquer le terrorisme et un seul slogan dont la traduction sonore : ti,ti,ti,ta,ta résonnait partout.
Il y eut, aussi, une autre conséquence, imprévue mais très importante : chacun prenant son service apportait, avec lui, les préoccupations de sa famille, de son entourage, de ses clients et ainsi les P.C. devinrent autant de centres d'écoute pour mesurer le pouls de la population. à l'inverse, rentrant chez lui, il apportait les consignes de l'Armée et ainsi s'établit, entre l'Armée et la population, une entente profonde, une véritable symbiose qui était l'antidote essentiel contre le terrorisme.
Le 13 mai 1958, dans l'atmosphère politiquement surchauffée de l'Algérie, une manifestation d'une ampleur jusqu'alors inconnue va bouleverser toutes les données et se transformer, le 16, cri d’une gigantesque manifestation de fraternité. Tous, mains jointes, dans un élan de patriotisme et une charge émotionnelle sans précédent, sentir s'évanouir la peur et crurent que plus rien ne pourrait dissoudre cette fraternité retrouvée dans une Algérie définitivement française. Et, en conséquence de cela, on créa, dans la Casbah d'Alger, un 20ème bataillon d'U.T. en y incorporant des musulmans qui, jusqu'alors, avaient été tenus en dehors de cette mobilisation..../...
Franchissant un nouveau stade dans l'étroitesse des relations Armée-population, le commandement décida de faire participer les U.T. à diverses prises d'armes.
C'était marquer la considération dans laquelle il tenait les U.T. Le succès de cette mesure fut considérable.../...
En 1959, on confia aux U.T. un drapeau tout neuf. Mais déjà le doute et l'angoisse étreignaient les cœurs et nombreux étaient ceux qui se demandaient si ce drapeau resterait, longtemps planté sur la terre algérienne..../... Nous sentions tous que la digue que nous nous efforcions de construire allait être, rapidement, battue par les vagues de l'abandon qui, de métropole, se gonflaient.
MICHEL SAPIN-LIGNERES
N.D.L.R. LES U.T. DEVAIENT ÊTRE DISSOUTES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AU DEBUT DU MOIS DE FEVRIER 1960, APRES LES BARRICADES ET, AINSI, FUT REDUIT A NEANT L'IMMENSE TRAVAIL DE PACIFICATION ACCOMPLIS PAR TOUS CES PATRIOTES AUXQUELS VERITAS REND UN VIBRANT HOMMAGE.
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône et la Province du Constantinois méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il a continué jusqu'à son dernier souffle. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous, des pages qui pourraient être complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir. Jean Claude est décédé, et comme promis j'ai continué son oeuvre à mon rythme.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Guelma, Philippeville, etc. a été fait pour d'autres communes de la région de Bône et de Constantine.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et du Constantinois
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
|
|
| LA BELLE MERE !
Envoyé Par Pierre
|
La belle-mère arrive à la maison et trouve son gendre furieux en train de faire ses bagages.
- Mais qu'est-ce qui arrive ?
- Qu'est-ce qui arrive ? Je vais vous le dire !
"J'ai envoyé un mail à ma femme en disant que je rentrais de voyage aujourd'hui.
J'arrive chez moi et devinez ce que je trouve ?
"Votre fille, oui votre fille, ma femme quoi, à poil avec un mec dans notre lit conjugal !
C'est fini, je la quitte !
- "Du calme" dit la belle-mère ! "Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire"
- "Ma fille ne ferait jamais une chose pareille ! Attends, je vais vérifier ce qui s'est passé".
Quelques instants plus tard, la belle-mère est de retour avec un grand sourire
- "Je te l'avais dit qu'il devait y avoir une explication simple :
" Elle n'a pas reçu ton mail !"
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d'informer est grandement menacée, et c'est pourquoi je suis obligé de suivre l'exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d'information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d'expression, tel qu'il est reconnu par la Résolution 59 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d'expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|

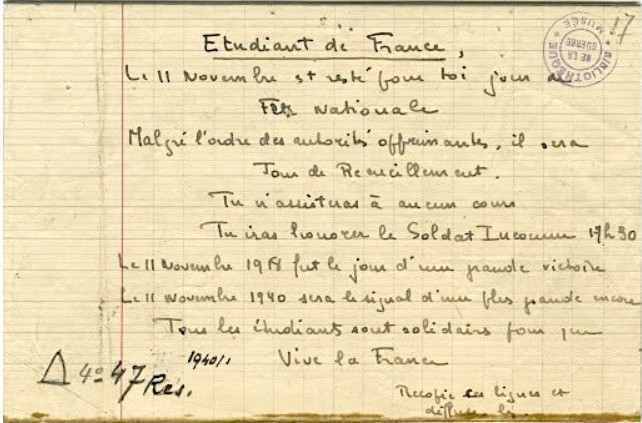

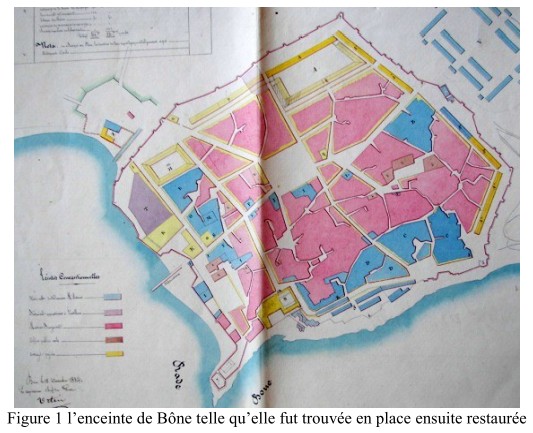
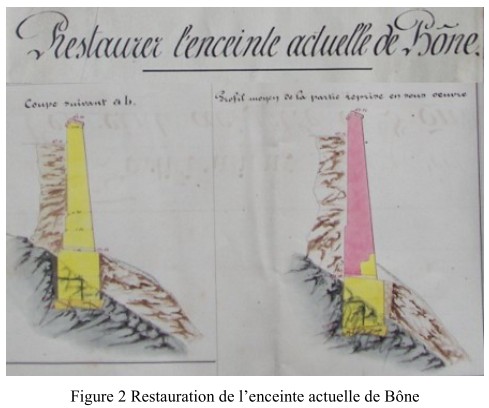
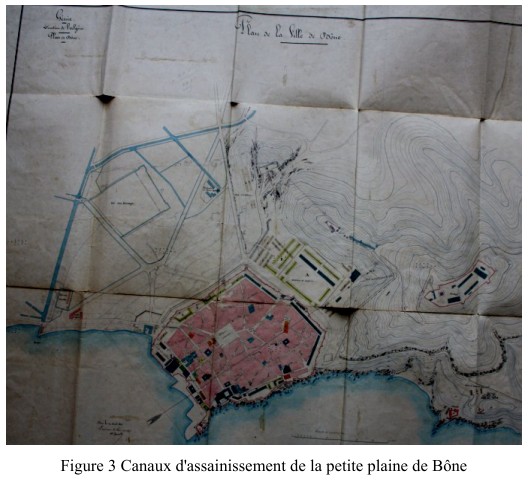
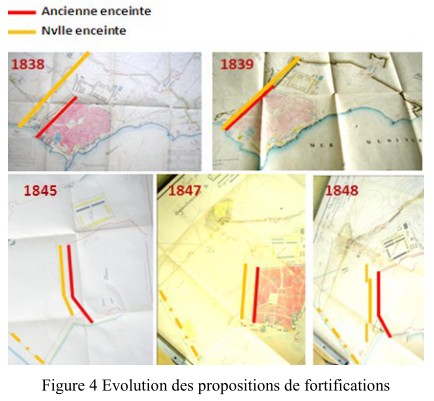

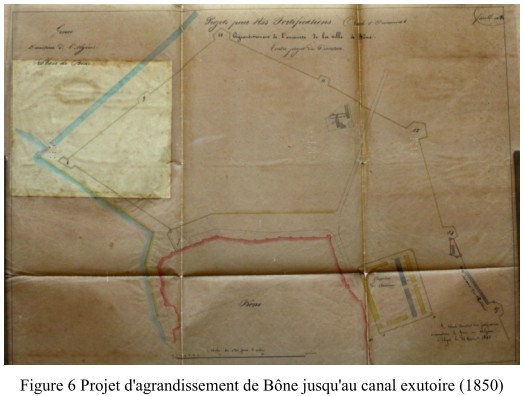
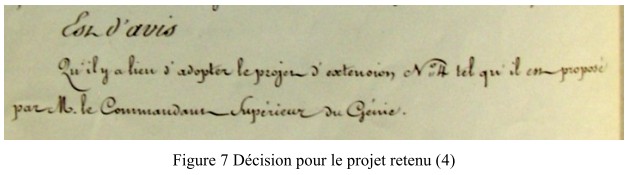
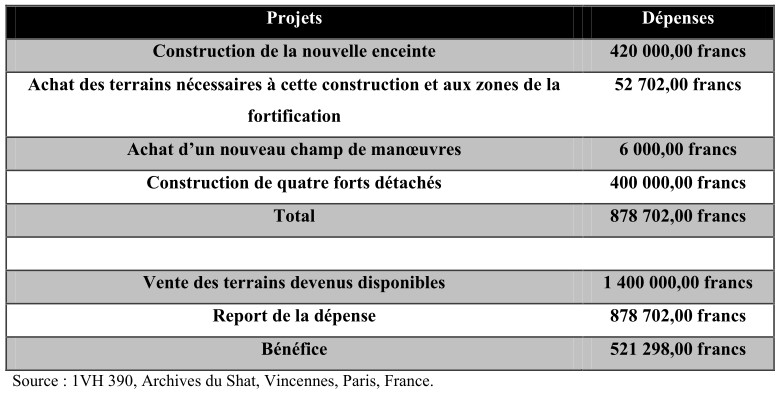
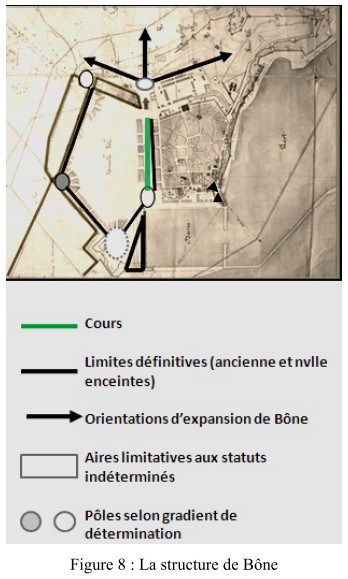
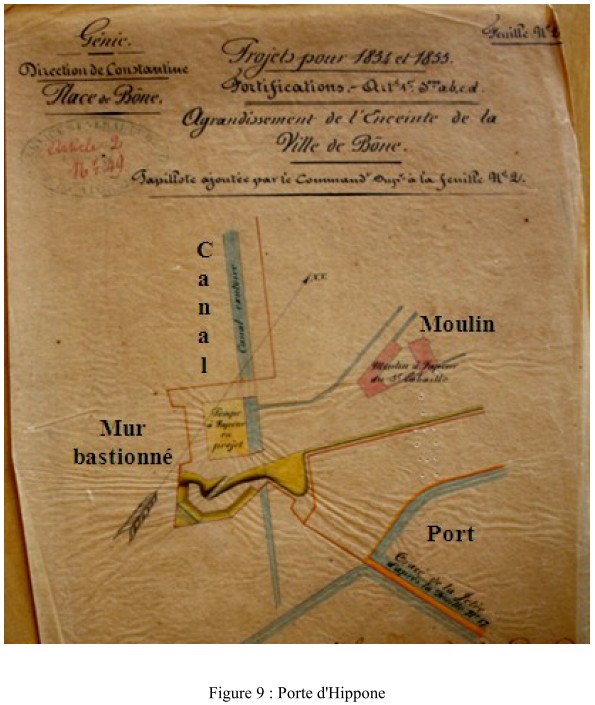


 N’oubliez pas le 4 Décembre, pour la Sainte-Barbe, chacun doit semer du blé (ou des lentilles) sur du coton imbibé d'eau dans une coupelle et Saint Nicolas le 6 décembre pour les bonbons et les chocolats.
N’oubliez pas le 4 Décembre, pour la Sainte-Barbe, chacun doit semer du blé (ou des lentilles) sur du coton imbibé d'eau dans une coupelle et Saint Nicolas le 6 décembre pour les bonbons et les chocolats.


 Pourquoi lui refuser, malgré l'atrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la cérémonie ? Elle n'aurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait après tant de souffrances imméritées.
Pourquoi lui refuser, malgré l'atrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la cérémonie ? Elle n'aurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait après tant de souffrances imméritées.
 Cette photo représente la petite Frédérique DUBITON le jour de sa communion. (Parue dans l'hebdomadaire « CARREFOUR » du 16 Mai 1962.). Pour preuve de la désinformation qui sévissait alors en Métropole et du lynchage médiatique que subissait perpétuellement l'OAS, certains journaux -toute honte bue- à l'instar de « La Marseillaise du Languedoc », journal communiste et de « L'Indépendant » de Perpignan, avaient publié cette photo accompagnée de la légende suivante : « Chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués ou blessés par les criminels de I'OAS en Algérie... Personne n'est à l'abri de leurs mauvais coups. Pitoyable témoignage. Cette petite communiante sortant d'une église d'Oran « du être amputée d'une jambe à la suite d'un plasticage de l'OAS (sic) »
Cette photo représente la petite Frédérique DUBITON le jour de sa communion. (Parue dans l'hebdomadaire « CARREFOUR » du 16 Mai 1962.). Pour preuve de la désinformation qui sévissait alors en Métropole et du lynchage médiatique que subissait perpétuellement l'OAS, certains journaux -toute honte bue- à l'instar de « La Marseillaise du Languedoc », journal communiste et de « L'Indépendant » de Perpignan, avaient publié cette photo accompagnée de la légende suivante : « Chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués ou blessés par les criminels de I'OAS en Algérie... Personne n'est à l'abri de leurs mauvais coups. Pitoyable témoignage. Cette petite communiante sortant d'une église d'Oran « du être amputée d'une jambe à la suite d'un plasticage de l'OAS (sic) »

 Combien d'Algérois agissent comme ces simples touristes sans se douter qu'au-delà du Séminaire et de l'Eglise située à moitié chemin vers Vieux-Kouba, se trouve une maison des Filles de la Charité, qui est sans contredit une des plus anciennes de la vaste agglomération koubaine.
Combien d'Algérois agissent comme ces simples touristes sans se douter qu'au-delà du Séminaire et de l'Eglise située à moitié chemin vers Vieux-Kouba, se trouve une maison des Filles de la Charité, qui est sans contredit une des plus anciennes de la vaste agglomération koubaine.
 Il sait en effet que les Sœurs y accueillent des enfants, êtres faibles et délicats, en qui il faut infuser un sang vif, une robuste santé, une vie forte et énergique. Et voilà pourquoi il veut bien, en août, émousser l'acuité de ses traits, et en décembre, atténuer par une douce chaleur les rigueurs de l'hiver. On comprend que les enfants qui vont, là-haut, commencer leur éducation, prennent assez vite goût aux études. Dans un cadre si beau, dans un site si salubre, dans un milieu excellent où les Sœurs de Saint Vincent font régner tant de gaîté, de joie et de vie familiale, il est impossible que les cœurs ne s'ouvrent bientôt à la bonté, les esprits à la science et les âmes à la beauté, à l'ordre et à l'harmonie.
Il sait en effet que les Sœurs y accueillent des enfants, êtres faibles et délicats, en qui il faut infuser un sang vif, une robuste santé, une vie forte et énergique. Et voilà pourquoi il veut bien, en août, émousser l'acuité de ses traits, et en décembre, atténuer par une douce chaleur les rigueurs de l'hiver. On comprend que les enfants qui vont, là-haut, commencer leur éducation, prennent assez vite goût aux études. Dans un cadre si beau, dans un site si salubre, dans un milieu excellent où les Sœurs de Saint Vincent font régner tant de gaîté, de joie et de vie familiale, il est impossible que les cœurs ne s'ouvrent bientôt à la bonté, les esprits à la science et les âmes à la beauté, à l'ordre et à l'harmonie.







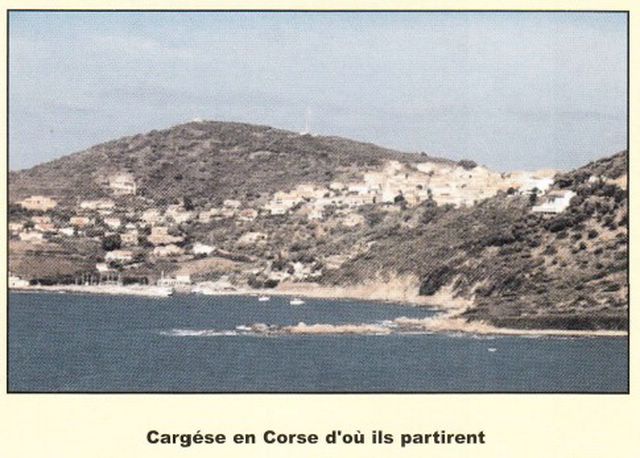
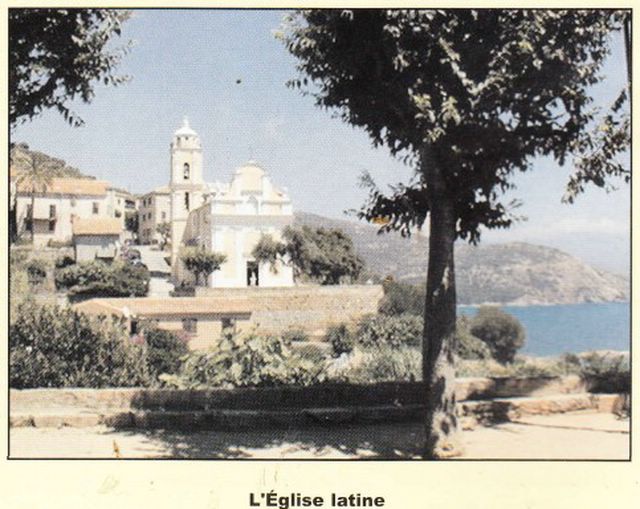
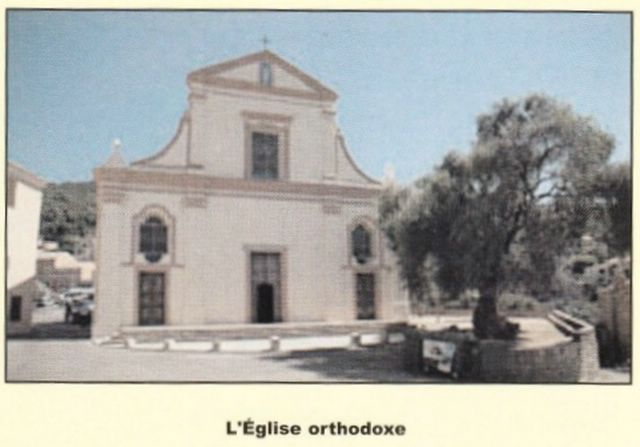
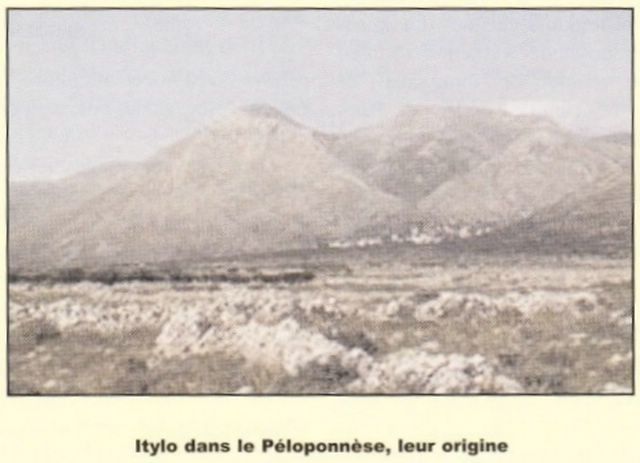
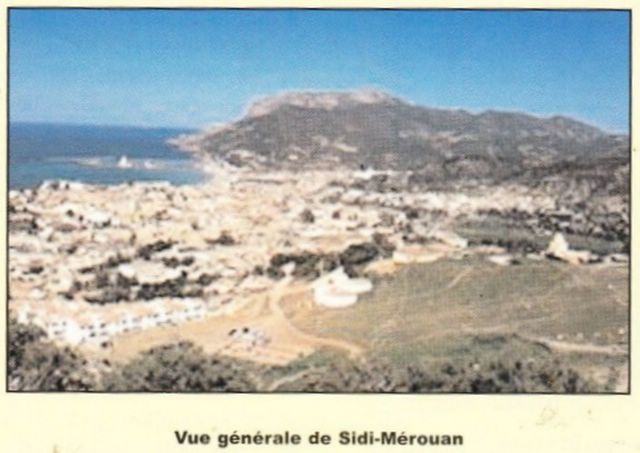
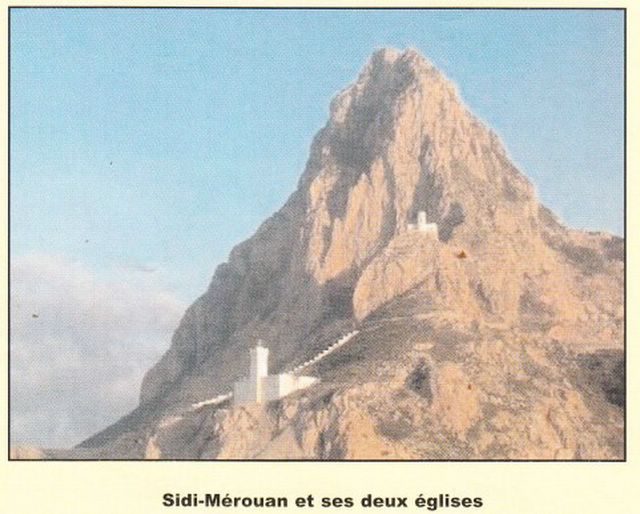

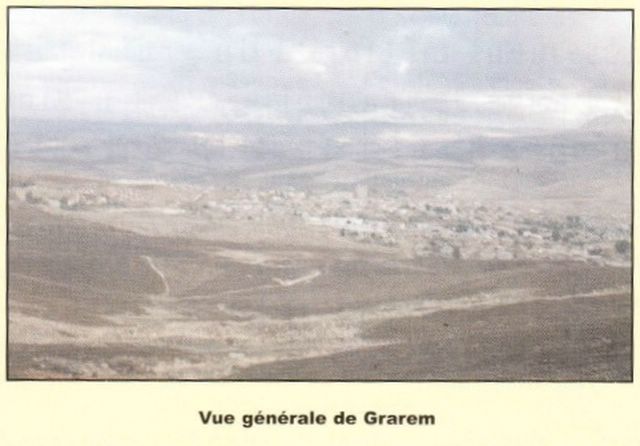
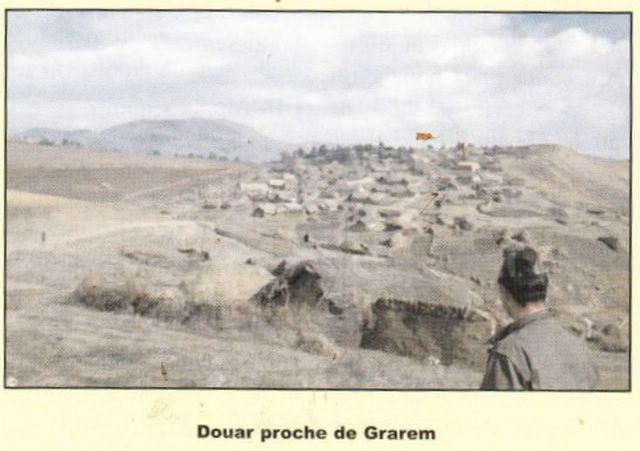


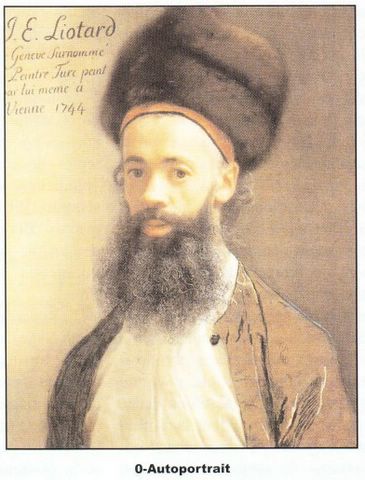
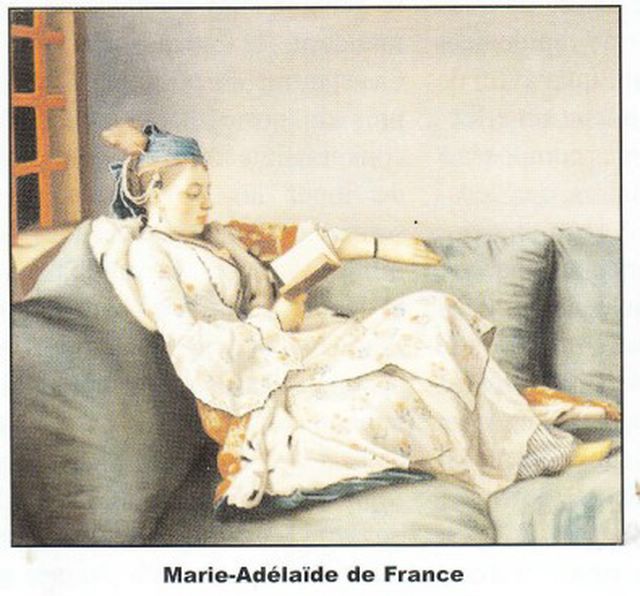

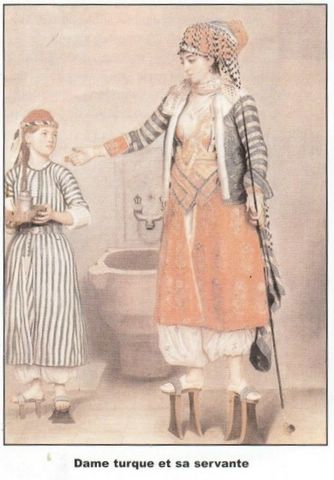

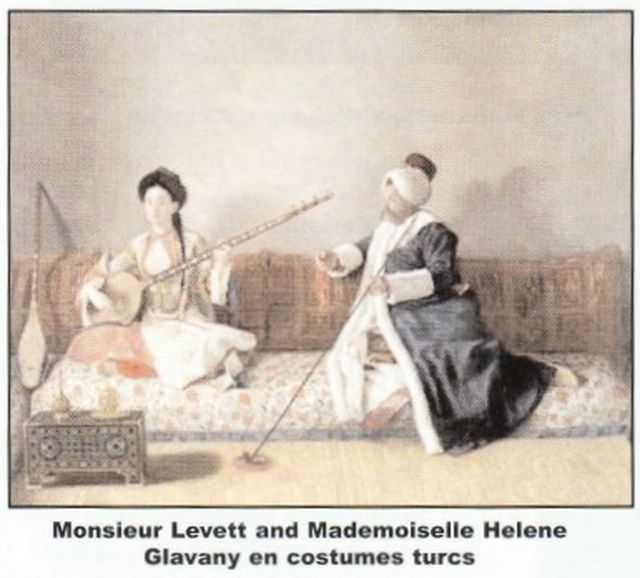






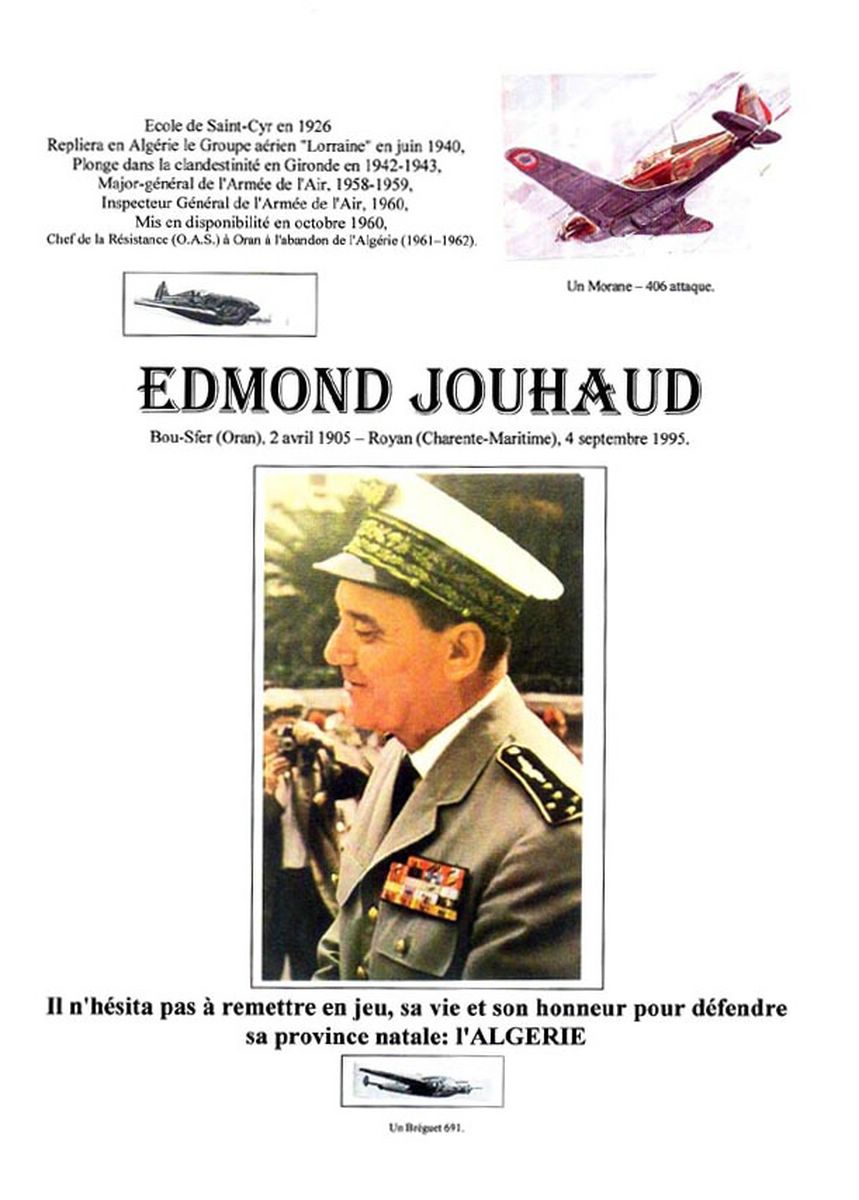






 Alec Penstone est impressionnant. Il est tout courbé, a le visage parcheminé et les mains noueuses. Mais tout centenaire qu’il est, celui qui se battit jadis dans la Royal Navy a belle allure, avec son béret blanc, son placard de décorations sur la poitrine et le coquelicot - chez nous, c’est le bleuet - qu’il arbore fièrement en souvenir de ses copains tombés à ses côtés.
Alec Penstone est impressionnant. Il est tout courbé, a le visage parcheminé et les mains noueuses. Mais tout centenaire qu’il est, celui qui se battit jadis dans la Royal Navy a belle allure, avec son béret blanc, son placard de décorations sur la poitrine et le coquelicot - chez nous, c’est le bleuet - qu’il arbore fièrement en souvenir de ses copains tombés à ses côtés.