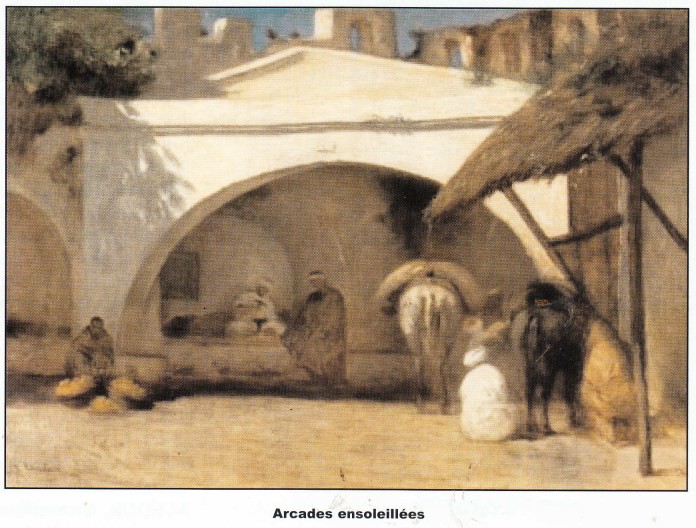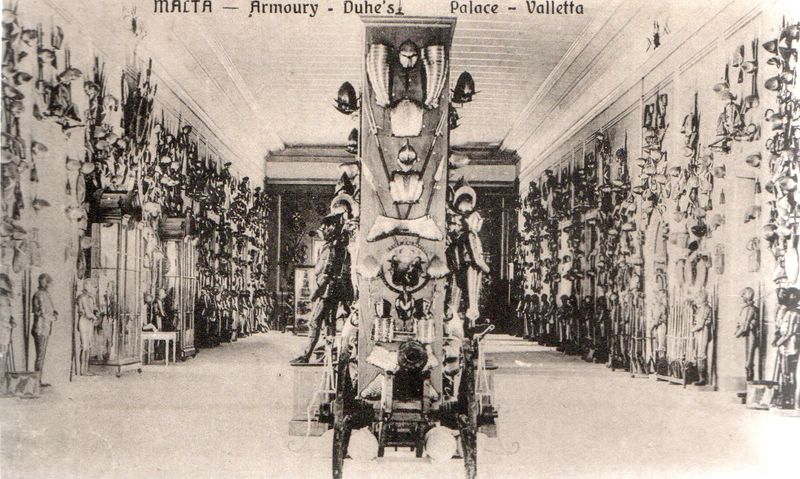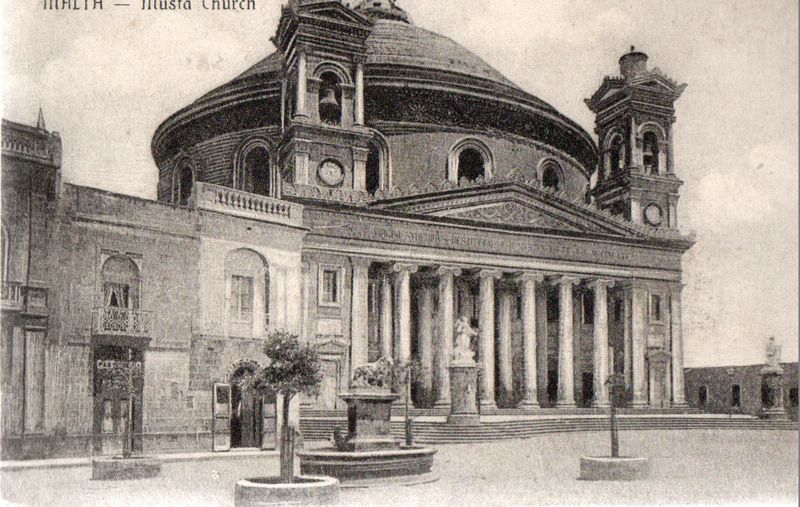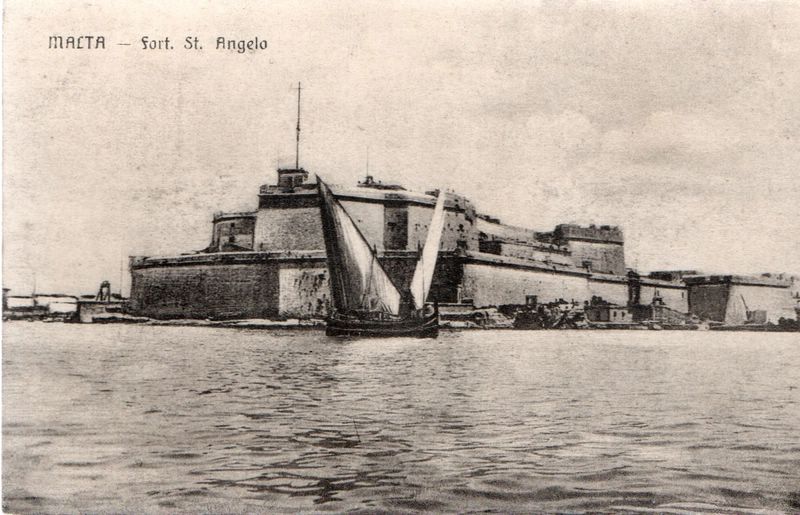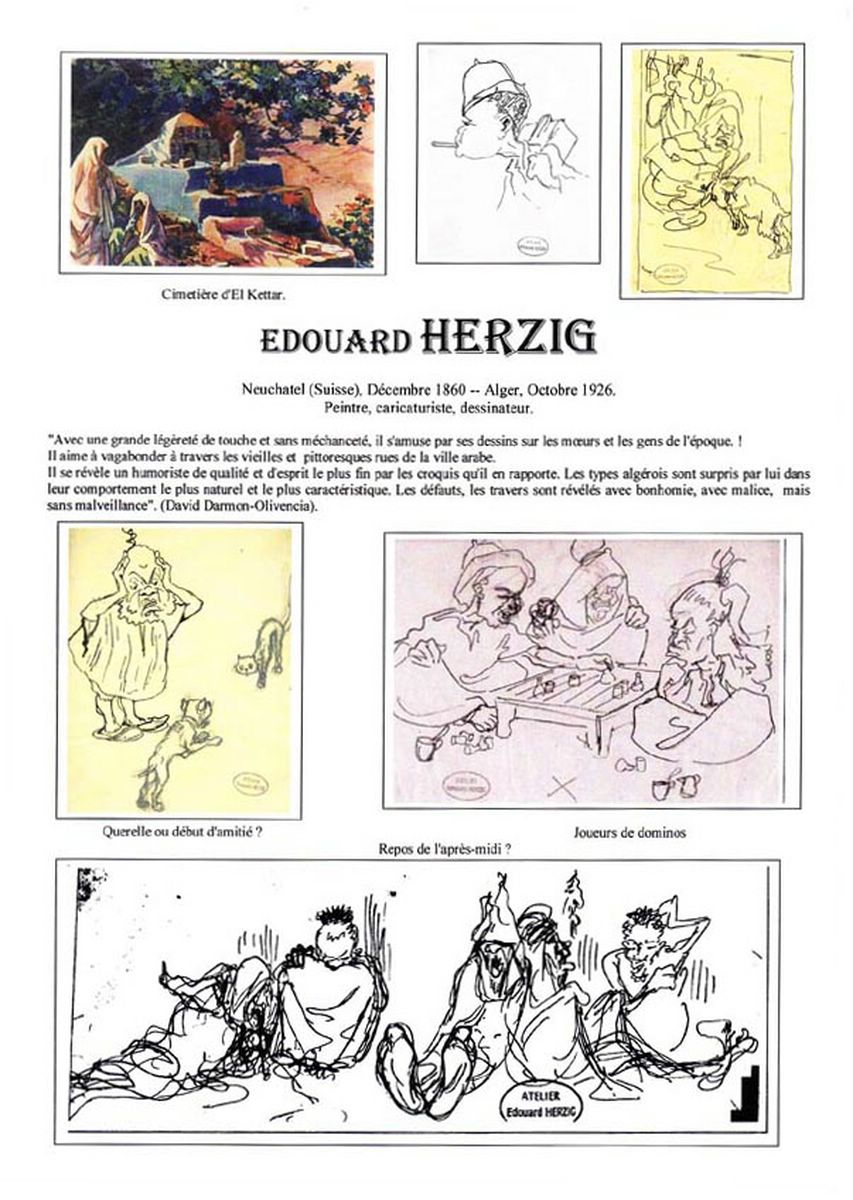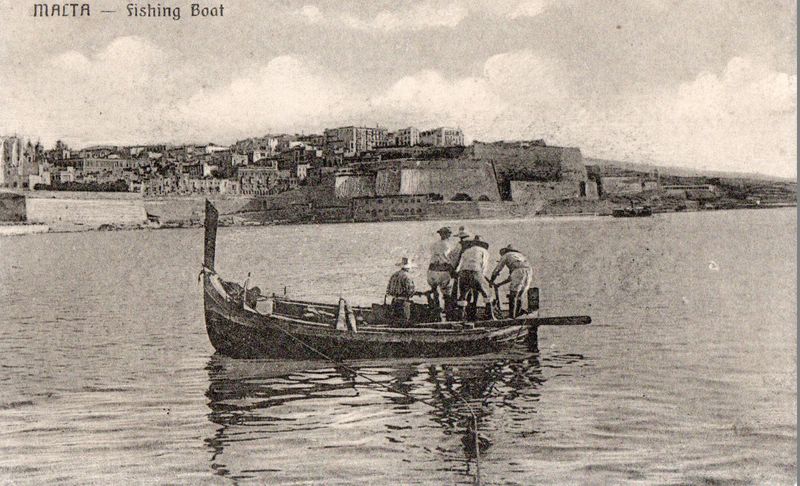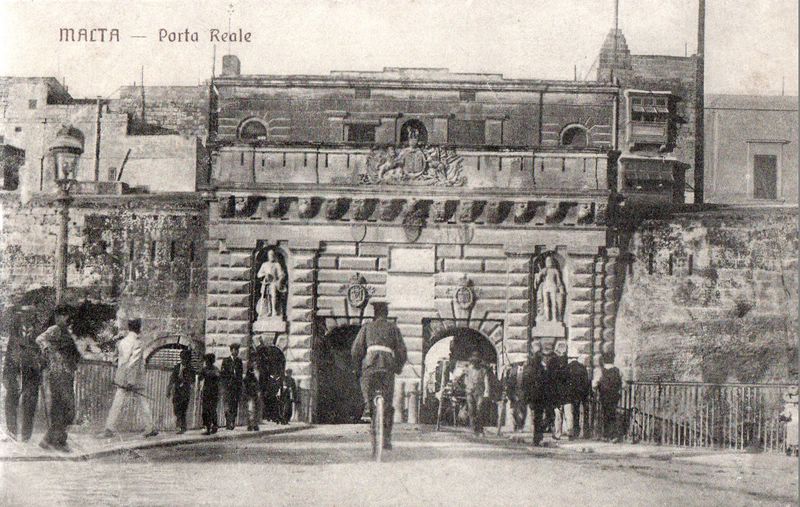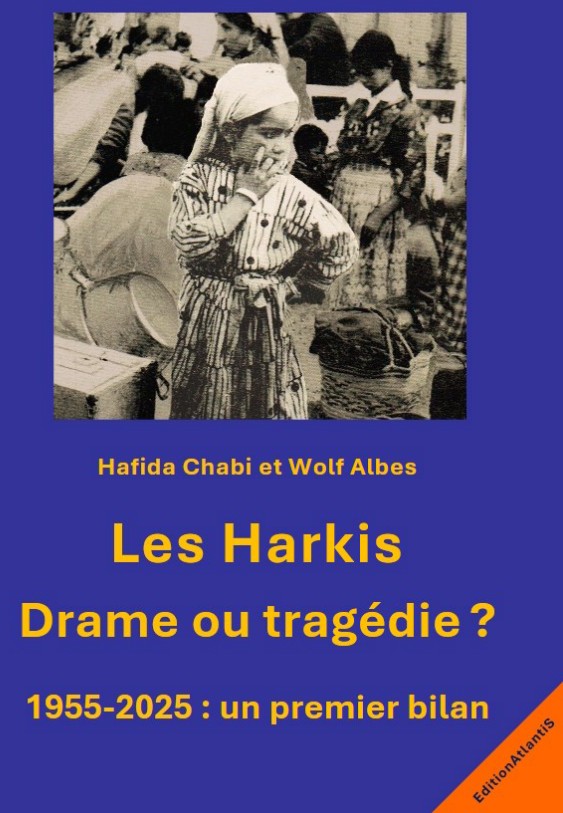|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Avertissement :
Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.
Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.
Merci.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
255, 256, 257,
258, 259, 260,
261, 262, 263,
264,
| |
LE SOUVENIR…
Chers Amies, Chers Amis,
 Comme chaque année, la fête de la Toussaint est accompagnée des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans le manteau qu’on vient juste de ressortir, les jours qui raccourcissent, le gris du ciel traversé par des averses. Le froid qui s’installe doucement. Comme chaque année, la fête de la Toussaint est accompagnée des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans le manteau qu’on vient juste de ressortir, les jours qui raccourcissent, le gris du ciel traversé par des averses. Le froid qui s’installe doucement.
Fêtons donc la Toussaint comme un rayon de soleil qui traverse ce ciel gris de novembre en osant être simplement heureux.
Le lendemain de cette solennité, pour la fête de morts, l’Humanité entière unit sa voix afin de prier pour les âmes de nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde. C’est l’occasion pour nous de nous souvenir de nos défunts et de faire un tour au cimetière pour allumer un cierge ou déposer une gerbe de fleurs pour leur exprimer notre amour et notre proximité.
Nous exilés, nous pouvons allumer un cierge ou une bougie à la maison pour les nôtres restés au pays.
Cette date du 1er novembre (1954), est pour nous un triste jour car c’était le commencement de la fin qui a abouti à notre exil en 1962.
C’était le début d’une guerre civile meurtrière qui a durée presque huit ans. Une guerre qui a laissé des traces indélébiles qui ne se sont pas cicatrisées.
Cette guerre s’est réveillée en France depuis quelques années et si le peuple français n’en prend pas conscience, il subira ce que nous avons subi à cause des « politiques » inconscients, irresponsables et qui se foutent de leur peuple. Seule la gamelle les intéresse.
Ce monde politique nous offre un lamentable spectacle et grâce à son chef de l’état, le pays est la risée de toute la planète.
N’oubliez pas le 11 novembre : Armistice 14-18 où nos grands-parents se sont fait casser la gueule pour défendre un pays qui nous a bafoué. Ces « gueules cassées » se sont dévoués pour défendre un idéal français !!!
" Bône " lecture et bon mois de novembre
A tchao, Diobône,
Jean Pierre Bartolini
Ce bouquet de roses de Guelma est offert par M. Yves Jan.
| |
SAVONS-NOUS ENCORE RIRE
C. Bender
Echo de l'ORANIE N°249, MARS/AVRIL 1997
|
|
Le rire est le propre de I'homme" disait Bergson et c'est vrai que les animaux ne rient pas, ils manifestent leur joie ou leur satisfaction, d'une autre manière, seul l'être humain traduit sa gaieté par un mouvement des lèvres, de la bouche, accompagné de sons rapidement égrenés. L'élargissement de I'ouverture de notre bouche, avec des expirations saccadées plus ou moins bruyantes: il y a tout un vocabulaire souvent argotique pour I'exprimer :
"On se marre, on se bidonne, on se fend la pipe, on se poile et comme disent maintenant les jeunes, on s'éclate"
Il paraît, disait les revues médicales, que le rire est non seulement bon pour le moral, mais aussi un véritable médicament, capable d'améliorer la santé : il active la respiration, il contribue à une meilleure oxygénation de I'organisme et surtout du cerveau, il agit aussi sur la circulation du sang, bref, c'est un remède à la portée de tous, et qui ne coûte rien à la Sécurité Sociale !
Mais savons-nous encore rire? L'époque ne s'y prête guère et d'ailleurs tous les auteurs vous diront qu'il est plus difficile de créer une pièce comique qu'une œuvre dramatique. Le même argument peut, selon la manière, faire rire ou faire pleurer. Avec le même matériau linguistique, Molière fait rire sur l’infortune d'Octave dans "les fourberies de Scapin", tandis que Racine apporte le désespoir d'Hippolyte dans Phèdre. On peut rire du malheur des autres, ou on peut en pleurer. Ce n'est pas une affaire de matière, mais de manière, de contexte et de perspective.
Dans son enquête sur "le comique", Jean Emeiina aborde tous les domaines où le rire peut s'exercer : théâtre bien sûr, littérature moderne ou classique, caricature, cinéma, bande dessinée, littérature orale des chansonniers, et même la vie quotidienne est une colossale réserve d'instants comiques.
Mais quand j'écris "comique" je ne pense pas trivialité, et malheureusement de nos jours, la vulgarité règne chez ceux qui ont choisi de nous faire rire.
Quelle dégénérescence dans le genre dit "comique" ; chez ces "histrions" aucune pudeur, aucun tact, le sens de la justice les gêne, s'il n'émane pas de leur vision doctrinaire de I'existence "tout peut être dit".
Quant à la vertu, rien de tel pour fourbir les armes de l’ironie et du cynisme s'ils la découvrent chez quelqu'un ! Laxisme et indécence pour ne pas dire grossièreté sont la base de "leur art".
Comment ne pas les comparer à ce délicieux artiste qu'était Fernand Raynaud !
Déjà avant qu'il ne joue ses sketches, on avait envie de rire tant ses mimiques étaient éloquentes... Qui ne sa souvient de I'histoire du plombier et du perroquet "qui c'est ?" "C’est le plombier!" Du 22 à Asnières, du "défilé du régiment" ? "Du questionnaire du sergent" ou de ses fréquentes allusions à son beau-frère "l'inspecteur des platanes" et de la chorale de l'église paroissiale. Jamais un mot grossier, un ton à peine ironique et une sobriété de geste, dévoilant un sens aigu de l'observation.
J'ai retrouvé un peu de ce genre comique chez Robert Lamoureux, dont les inflexions de voix, traduisaient de manière évidente les situations les plus cocasses, personne n'a oublié le sketch sur le canard "huit jour après, le canard était toujours vivant!" Ni ses textes de chansons "Papa, maman, la bonne et moi".
Comme je regrette ces artistes et quels délicieux moments nous avons passé en leur compagnie. Je sais bien que Robert Lamoureux est toujours vivant, mais à son âge, il se contente de faire quelques mises en scène.
Il est heureusement un comique qui échappe actuellement à toutes critiques : Raymond Devos - L'absurde par I'observation minutieuse du réel est son domaine.
Traduire nos faiblesses, nos erreurs sans appauvrir ceux qui l'écoutent est une règle de conduite dont il ne se départ pas. Il mise toujours sur la finesse du spectateur; I'art de la nuance, il le suppose chez I'autre.
Son amour des mots est si intense qu'il le croit perceptible à tous, et le conduit à présent à publier des livres, comme si la scène ne suffisait plus à contenir le flot d'extravagance qui bouillonne en lui.
"Lorsque j'aurai fini de jouer à l'homme de lettres, je remettrai mon nez de clown" dit-il dans "Un jour sans moi" qui paraît chez Plon, un livre dans lequel il égrène les perles de son agilité imaginative. C'est un enchantement, une fête à nulle autre pareille, du rire et du plaisir à jet continu! Chapitre faisant, on fait connaissance avec "l'épouvantail qui n'a qu'une crainte, celle d'effrayer les oiseaux" les chaises qui ont quatre pieds, mais sont incapables d'en mettre un devant I'autre, et les tables qui leur ressemblent, mais qui, elles, peuvent tourner "l'hôtel borgne, car le patron I'est et ne dort que d'un oeil "le pékinois, chasseur d'ombres, qui tombe en arrêt devant la sienne, attendant qu'elle fasse le premier pas "la feuille qui se fait fleur, pour sauver I'honneur du rosier souffrant".
C'est un mélange de poésie, de folie, de tendresse et de drôlerie.
Devos, "cet orfèvre de I'absurde" qui règne sur le comique verbal depuis tant d'années, n'a aucun diplôme universitaire et pourtant ses oeuvres sont traduites en espagnol, en allemand, en anglais, ses sketches sont des bijoux du surréalisme. ciselés à la pointe de la virtuosité poétique.
Dans une récente interview, il avoue "mes jeux de mots, je ne les cherche pas, ils viennent tout seuls. Si je commence à essayer de construire une phrase, je ne fais rien de bon. Mes idées sont du domaine de I'incontrôlable, et puis, au-delà du vocabulaire, il y a la présence physique, la façon dont vous racontez I'histoire ; le public est complètement avec moi, et moi je suis dans I'imaginaire, comme un naïf stupéfait, parfois bouleversa par ce qu'il découvre".
L'absurdité du monde, il ne va pas la chercher, comme Kafka. dans les situations sociales ou matrimoniales, il la trouve dans les mots et les mots, c'est peut-être le domaine dans lequel elle se manifeste le plus fréquemment.
Homme de sonorités, il aiguise ses oreilles et sa fantaisie en jouant d'une douzaine d'instruments de musique, et ne peut s'empêcher, face à n'importe quel interlocuteur de l'entraîner sur les sables mouvants de son délire.
Cet homme, en état de grâce, ne vieillira jamais, car devant son public qui rit. Il est récompensé et ne peut sombrer dans l'angoisse, même s'il a le trac en entrant sur scène, il oublie son anxiété, la crainte de ne pouvoir retrouver son texte. car ses histoires inventées, il a l’impression de les avoir vécues. Ce Saltimbanque a du génie, et à mon sens. est un des plus grands comiques de notre époque.
Chez les Pieds-Noirs, on a toujours aimé rire. Notre nature, notre instinct, notre culture méditerranéenne nous poussaient vers la joie et malgré les épreuves subies depuis la guerre d'Algérie. Le terrible exode, et I'adaptation difficile sur une terre hostile. nous avons presque retrouvé le goût de ce qui amuse, si bien que nos réunions n'engendrent pas la mélancolie. Il y a d'abord "l'accent" qui déjà sert de fond à nos parlotes : nuancé d'ironie et pétillant d'esprit, l'accent du pays est plein de soleil, de chaleur et de ciel, et nous fait, nous reconnaître partout où nous allons. C'est avec cet accent indéfinissable qu'il faut lire à haute voix les textes de Gilbert Espinal, dont l'écho de l'Oranie vous donne un extrait chaque mois : les démêlés d'Angustias, de Consuelo, de Pepico Bolbacet ou de la grand-mère et de sa fille la Golondrina, font nos délices.
Dans le patio, où sous ces personnages nous séduisent par leur vivacité. et leur truculence, c'est la vie quotidienne (avec ses problèmes de cohabitation sujets de tant de discussions), qui fait la trame de ces sketches tellement naturels qu'on s'y croirait, et même si je les connais par cœur, je ris en les relisant, comme si la musique des mots, le pittoresque des expressions de là-bas cet inimitable don de la comédie, me replongeaient dans I'atmosphère Oh ! Combien regrettée des livres de notre jeunesse : la parodie du Cid, les joyeux pêcheurs oranais, les aventures de Margaillon, les fables en Sabir etc... Et quel don dans le choix des noms : madame Sacamuela, monsieur Tragamonos, Bigoté, Amparo, Martyrio.... cela ne s'invente pas, c'est la vie même qui est là devant nous.
Vous allez me dire que vraiment l'époque où nous vivons ne prête guère à rire, tant de chômeurs, de revendications sociales, de grèves à répétition, sans parler des tueries d'Algérie ou du Zaïre, mais justement pour oublier un peu ces tragédies, et sortir de la morosité ambiante, laissons nous emporter par la verve de Gilbert Espinal dans ses "chroniques anachroniques" et écoutons Raymond Devos dans une fête de I'imaginaire, à nulle autre pareille.
En ce jour de la Chandeleur
2 février 1997
C. Bender
|
|
DIS PAPA… EXPLIQUE-MOI L’OAS…
ACEP-ENSEMBLE N°305
|
|
Pour répondre à de nombreux lecteurs, nés dans et après les années 50, qui me posent ces questions, suite à mon article sur le décès de Jean-Jacques Susini :
- Qui a créé l’OAS ?
- De quels bords politiques étaient-ils ?
- Comment a-t-elle fonctionné ?
- Qu'en pensaient les Pieds Noirs ?
- Pourquoi était-elle numériquement faible ?
- Pourquoi a-t-elle duré si peu de temps ?
- A-t-elle subi des dissensions politiques ?
Je pense être mieux placé que quiconque pour éclairer leurs esprits car je me trouvais justement à Madrid, au domicile de Pierre Lagaillarde, Résidence La Torre, Plaza d'Espana à l'époque de Pâques 1961, afin de représenter M. Georges Bidault lors de la création officiel de I'OAS et que, par la suite, j'ai créé le « Bulletin de liaison du CNR-OAS », à Paris, toujours sous les ordres de Georges Bidault qui, quelques mois plus tard, prenait la responsabilité de l'OAS en lieu et place du général Salan, arrêté par les autorités françaises.
L’OAS s'est organisée après l'échec du « putsch » des généraux.
Les quatre plus prestigieux généraux de I'armée française avaient pris la décision de se révolter contre le chef de I'Etat français qui s'était parjuré et les avait trahis.
Cette trahison mettait en danger la vie de leurs soldats qui allaient tomber pour une politique d'abandon de l'Algérie, alors que la guerre était gagnée sur le terrain.
Le général Challe, chef d'état-major de toutes les armées, refusait de dresser une partie de l'armée contre l'autre et ne souhaitait pas que les Unités Territoriales (200.000 hommes Pieds Noirs), qui avaient été dissoutes un an plus tôt, soient réarmées. Il jetait donc l'éponge et se rendait aux autorités.
Dès lors certains officiers et leurs régiments prenaient la décision de se dresser contre I'Etat français et sa politique incompréhensible et désastreuse.
En février 1961, les généraux Jouhaud, Gardy, les colonels Godard, Gardes et le docteur Jean-Claude Pérez, lançaient l'opération OAS et les premiers messages s'affichaient sur les murs d'Alger.
Un mois plus tard, l'organisation se constituait officiellement à Madrid, sous le commandement du général Salan, de Pierre Lagaillarde, de Jean Jacques Susini, du capitaine Ferrandi et de quelques autres patriotes qui refusaient I'abandon de l'Algérie française.
Il est totalement faux d'adhérer aux informations véhiculées par le gouvernement de l'époque et une certaine presse au service exclusif des communistes et des gauchistes qui alarmaient les citoyens en proclamant que I'OAS était une organisation de fascistes d'extrême droite.
Il suffit de rappeler que son chef, le général Salan, était plutôt étiqueté à gauche, au point même qu'un attentat avait été organisé afin de l'éliminer physiquement, justement par la droite française, et notamment Michel Debré qui pensait qu'il avait été placé à ce poste de gouverneur militaire de I'Algérie dans l'objectif d'un rapprochement avec le FLN, et ce fut le commandant Rodier qui fut tué.
Quant aux autres officiers ils n'avaient aucune autre idéologie que de servir la Patrie et défendre la présence française.
L’OAS Algérie était confiée au général Paul Gardy et l'OAS Métropole au capitaine Pierre Sergent.
L’action était confiée aux commandos « Delta », sous les ordres de Jean-Claude Pérez et du lieutenant Degueldre. Or 80% des membres de ces commandos, et notamment le plus actif, celui de «Jésus de Bab-el-Oued » étaient des sympathisants de la gauche socialiste et communiste qui dominait ce quartier.
Il n'y avait au sein de I'OAS aucune agressivité contre l'ensemble des musulmans.
Les ennemis à exécuter étaient les terroristes du FLN et les traîtres français qui étaient leurs complices, les « porteurs de valises » qui finançaient et fournissaient armes et explosifs et aidaient à organiser des attentats et à assassiner aussi bien en Algérie qu'en métropole.
90% de la population approuvait I'action de IOAS, sans participer aux opérations armées ni aux exécutions nécessaires, mais, effectivement, trop peu nombreux furent ceux qui participèrent activement à la défense de leur pays.
La France avait connu une situation identique lors de la dernière guerre 39/45 où il y eut bien peu de résistants contre, l'occupant nazi et beaucoup plus dès la libération
Si I'action de l'OAS n'a duré que 16 mois (février 61 à juillet 62) c'est qu'il n'y avait plus rien à espérer après le départ de la presque totalité des européens d'Algérie qui n'avait eu le choix qu'entre la valise ou le cercueil, promis par le FLN et I'ALN qui ne voulaient en aucun cas qu'il ne reste un seul non musulman sur la terre algérienne.
Il n'y a eu aucune dissension d'ordre politique au sein de l'OAS, seulement une divergence de tactique entre I'un des dirigeants, Jean-Jacques Susini (qui vient de nous quitter) et qui, manipulé par le maire très libéral d'Alger, Jacques Chevalier (qui se convertira à la religion musulmane), et oeuvrait sous les ordres de la CIA et de Washington, souhaité une entente de dernière heure avec certains dirigeants du FLN (Farès et Mostefaï) et la quasi-totalité des autres dirigeants qui considéraient que « c'était foutu », qu'il fallait dégager, alors que I'armée française se mettait, sur ordre du chef, de l'État français, au service des nouveaux dirigeants du pays en pratiquant un « cessez le feu » unilatéral.
Ce qui a permis les massacres du 26 mars des attentats et à assassiner aussi bien en 62, rue d'Isly à Alger et du 5 juillet 62 à Oran.
Jamais I'OAS n'a conseillé le départ des européens d'Algérie, bien au contraire, preuve en est les nombreux plasticages des entreprises et des commerces de ceux qui abandonnaient le pays pour se mettre à I'abri en métropole.
Je terminerai par ce dernier hommage, bien involontaire, rendu par De Gaulle à I'OAS :
« Les gens de l’OAS me haïssent parce qu'ils sont aveuglés par leur amour de la France »
|
|
| Histoires courtes d'un autre temps.
|
|
La Macaronade d'un dimanche de Pâques.
C'était à Bône en Algérie autour des années 1930.
La famille habitait dans cette coquette ville, où, depuis de nombreuses années déjà, Vincenzo Pepe alias l’Africain mon grand-père, exerçait le beau métier de marin-pêcheur à bord de son bateau baptisé Sainte Candide, en hommage à la patronne de Ventotène son île natale... Avec leurs 4 enfants, ils étaient installés depuis toujours dans un modeste appartement de la maison Sens, laquelle était située à quelques pas du grand port de commerce de la ville.
Devenus adultes, les enfants étaient depuis longtemps déjà, presque tous rentrés dans le monde du travail : Antoine l'aîné, chauffeur aux transports Xiberras - Louise ma mère, la deuxième de la fratrie et sa sœur cadette Philomène, toutes deux employées à la Tabacoop au tri des feuilles de tabac et restait Gaby le petit dernier qui était encore sur les bancs de l'école.
Maintenant que voici plantés décors et acteurs, écoutons à présent cette courte et succulente histoire, venue en droite ligne d'un passé qui ne m'a jamais paru aussi proche :
« En ce dimanche jour du Seigneur, Pétronille, ma grand-mère sicilienne, avait invité à déjeuner une famille de leurs amis, pour fêter dignement Pâques dans la plus pure des traditions.
Au menu et comme de coutume, si l’habituelle et incontournable Macaronade du dimanche était de circonstance, en cette belle et Sainte journée Pascale Pétronille se devait en plus, l’honorer d’un éclat et d’une opulence toute particulière. Aussi la Mamma qui ce jour-là s'était levée de grand matin, devait activement s'affairer auprès de ses fourneaux la matinée entière, au sein de la sombre petite cuisine toute encombrée de divers victuailles et autres ustensiles hétéroclites… Car en ce jour de Pâques et pour faire honneur à ses invités, il lui était absolument indispensable et surtout obligatoire, de réaliser une divine sauce tomate bien grasse et de haut goût, qui, à coup sûr, devrait faire la joie et satisfaire tous les convives rassemblés autour de la table.
Il faut dire qu'en matière de Macaronade, il n'était pas du tout souhaité ni décent de servir n'importe quoi et affecté de n'importe quel goût ! En Algérie il faut savoir que les gens de cette époque, étaient incontestablement en raison de leurs origines latines, de fins connaisseurs dans la cuisson des pâtes alimentaires et de tomates préparées à toutes les sauces. Autant dire que si le bricolage culinaire n'était jamais toléré voire manifestement sacrilège et il se trouvait encore moins admis dans la communauté Latine et à fortiori un dimanche de Pâques.
Ainsi à longueur d’année et comme le Seigneur notre Dieu, dont elle marquait régulièrement le jour du dimanche, la macaronade était sanctifiée avec tout le respect qui lui était dû et même dite au maigre elle se devait d'être, un chef-d’œuvre culinaire au sein de tous les foyers. C'est pourquoi Pétronille ce jour-là ne ménagea pas sa peine : dans l’âtre du vieux potager de sa petite cuisine obscure, elle avait allumé un bon feu de charbon de bois, dont les braises ardentes allaient tendrement faire mijoter la matinée durant, une merveille de sauce tomate pieusement couvée par l’antique cocotte de fonte noire - la complice préférée de Pétronille.
Midi devait vite être là… mais bien épaulée par ses deux filles, Pétronille fût largement à l'heure pour recevoir ses amis. Elle avait installé une belle table recouverte d’une nappe brodée, laquelle, portait fièrement la vaisselle des grands jours, alors que flottait outrageusement dans les lieux, un subtil et divin parfum de fête. Il ne restait plus alors qu'à accueillir les invités, qui, du reste, ne se firent pas attendre très longtemps… Après les congratulations d'usage et la blanche et traditionnelle Anisette, il était grand temps de passer aux choses un peu plus sérieuses, en clair, la Macaronade que Pétronille ramenait résolument sur la table, accompagnée fièrement par son cortège habituel - de Parmesan - de polpettes - de couennes farcies et d'opulentes saucisses. C’est ce beau et alléchant spectacle que devait plus tard m’évoquer Pétronille avec force détails.
Puisqu’une Macaronade ne supporte aucune attente, alors, le ballet des fourchettes commença sans perdre une seule minute. Antoine mon oncle, qui avait pris place prés de Pétronille, faisait plaisir à voir à chaque coup de fourchette, qu’il enfournait à la régalade avec une gourmandise non dissimulée. Cependant après avoir commencé à savourer béatement avec son habituel et très solide appétit, une assiette énorme débordant de spaghetti, soudain ! il arrêta tout net son repas, en posant discrètement et définitivement sa glorieuse fourchette sur la table, en prétextant à qui voulait l'entendre que pour l'heure il n'avait plus très faim ! ? Comme on peut s'en douter la mamma un moment surprise n'insista pas outre mesure, car, elle devait remarquer un peu de pâleur sur le visage de son fils et que son front paraissait brillant de sueur. Tout le monde pensa sur l‘instant que le jeune homme avait sans doute de la fièvre et sur ces sages et rassurantes paroles la Macaronade de Pétronille et son accompagnement carné furent vite engloutis - sauf, celle qui reposait dans l'assiette d'Antoine, que Pétronille devait ramener en cuisine.
Après les traditionnels Pastières et Gazadiels qui marquaient le dessert, Antoine, quelque peu frustré semble-t-il, s'était lentement levé de table pour s’en aller en catimini rejoindre sa mère qui furetait dans la cuisine. Pétronille qui à l’évidence restait toujours intriguée, par le comportement curieux et inhabituel de son fils, lui demanda alors et une nouvelle fois, pourquoi, en ce dimanche de Pâques, il n'avait pas fait honneur à sa superbe et délicieuse Macaronade ?…
C’est très discrètement et à l'abri de tous les regards, que le jeune homme se saisit doucement de son assiette encore pleine et là délicatement du bout de la fourchette, il entreprit d'explorer consciencieusement le plat de spaghetti, sous le nez de la mamma quelque peu interloquée. C’est alors que dans le secret des entrailles du tas de spaghetti entremêlés, qu’une forme noire et diffuse maculée de sauce tomate commença insensiblement à se profiler. Pétronille les yeux écarquillés fixait intensément le fond de l'assiette, en se disant que c'était là une feuille de laurier barbouillée de sauce tomate. Mais Antoine qui avec quelques hauts le cœur, poursuivait de plus belle ses investigations, devait ramener tout à coup sur le bord de l'assiette, un magnifique et sombre cafard de bonne et belle taille, qui, manifestement, était accidentellement tombé dans la Macaronade au moment du service.
L'affaire devenait alors claire comme de l’eau de roche : pendant le repas, le jeune homme devait hériter par hasard de l'infortuné insecte, qu'il s'empressa de camoufler sous les pâtes pour éviter de l’exposer à la vue des convives et leur faire savoir que le chef-d’œuvre culinaire de la maîtresse de maison, était surtout parfumé au cancrelat ! …
Le cafard étant comme on le sait une créature viscéralement exécrée en Algérie, quelle aurait été alors la réaction de tous les convives ? Pardonnez-moi du peu ! Mais par charité chrétienne, j'aime mieux ne pas y penser. Cependant on peut tout de même dire, que si Antoine a eu l'intelligence de maîtriser une situation des plus délicate, l'explication donnée en cuisine à sa mère aurait bien mérité d'attendre le départ des invités ! Car prise soudain de violentes nausées à la vue du cafard, Pétronille devait s’empresser de bondir vers les WC qui se trouvaient à l'extérieur, pour régurgiter bruyamment et de bon cœur la totalité de son repas Pascal…
Mon grand-père ignorant la situation réelle, a dû lui dire en toute innocence et sur un ton doctoral : « qu'elle avait une fois encore avalé trop vite sa macaronade ! »
Je crois que le secret du cancrelat Pascal fût bien gardé et que cet incident culinaire servi d'exemple dans notre famille où, à la façon de mon oncle Antoine on prit l'habitude de se taire en pareille circonstance.
Voilà une petite histoire familiale bien ancienne, que j'ai eu très envie de nous raconter en ce temps de Pâques, pour faire revivre dans les mémoires tous ces spectres du passé afin de ne jamais les oublier.
Joyeuses Fêtes à tous et à toutes, en vous recommandant surtout de ne pas oublier les traditionnels Pastières et Gazadiels ( que je vous interdis formellement, mais respectueusement - d’appeler Mounas ! )
Jean-Claude PUGLISI
- de La Calle Bastion de France.
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Giens en presqu’île - HYERES ( Var )
N.B :
Anecdote authentique racontée autrefois, par ma grand-mère Pétronille Pepe née Celano.
Pour ceux qui l’ignorent ou qui l’aurait oublié :
Le Gazadiel est une couronne de pâte au levain, sucrée et décorée de petits anis multicolores.
La Pastière est un gâteau de vermicelles et raisins secs, nappé de caramel liquide ( voir les recettes dans mon ouvrage :" la Cuisine du Bastion " éditée par l'Amicale des Callois et amis de La Calle.)
NB : ce sont des gâteaux d’origine napolitaine.
|
|
|
|
LE MUTILE du N°43, 6 janvier 1918
|
HOMMAGE AU XIVème CORPS
Par H. OUIN du 52ème d'Infanterie
A ceux là qui critiquent et qui par maints détours
Nous, outragent, nous blâment, quand on s'bat chaque jour
Je leur ai répondu et le répète encore,
Fier de mon régiment, Gloire au XIVème Corps !
Nous avons repoussé les Boches, pas à pas,
Sans souci du danger, sans crainte du fracas.
Nous avons vu nos chefs s'élancer en avant,
Nous montrant le chemin des terriers allemands
Et bien souvent là-bas dans les plaines Picardes
Monter à l'assaut, méprisant la camarde ;
Pendant les longues heures de l'horrible bataille
Tenir jusqu'au bout sous la pluie de mitraille.
Certains on voulu dire qu'on était des froussards,
Des hommes sans courage, des gamins, des flanchards ;
Taisez-vous donc, ô calomniateurs !
Vous qui voulez crâner pour cacher vos frayeurs,
Pourquoi ne pas venir à Verdun, dans la Somme,
Pour mieux vous rendre compte si nous sommes des hommes ?
Assez de médisance, taisez vos faux rapports ;
Rendez ce qui est dû à notre glorieux corps,
Nous sommes des soldats et non pas des pantins,
Les Allemands ont su ce qu'étaient les Alpins.
Cessez donc je vous prie vos fâcheux bavardages,
Mensonges enchevêtrés de bien sots commérages
Et quand le ventre à table ou lisant vos journaux
Vous entendez passer nos troupes en vos hameaux,
Vous devez les saluer ces soldats héroïques
Qui luttent pour vous tous, et pour la République,
Qui souffrent sans se plaindre, des hivers la rigueur
Et qui de cent combats sont revenus vainqueurs.
Mais pour vous rendre un jour l'Alsace et la Lorraine
Beaucoup de ces braves dorment au loin dans vos plaines,
Chapeau bas devant eux, combattants pour l'honneur
Qui meurent pour la France et pour nos trois couleurs.
H. OUIN
PENICHES
En longue théorie, aux berges du canal
Les péniches sans vie, immobiles sommeillent...
Espérant chaque jour, dans le vent matinal
Gonfler la voile et s'envoler là-bas, vermeilles
Aux rayons d'un soleil nouveau, sur leurs plats bords
Les péniches tirant la chaîne en vains efforts.
Comme ces bateaux plats voudraient partir, briser
A tout jamais leur chaîne aux anneaux despotiques
Oh le nom détesté par le sang fut creusé !
Pauvres bateaux. Venus de France ou de Belgique
Vous êtes là, criant votre peine aux cordages,
Aux arbres, par les vents du chemin de halage.
Et l’on peut voir encor sur les pontons de bois
Des bonshommes bien vieux aux casquettes marines
Marchant de long en large et, tout comme autrefois
Mâchonner dans leurs dents tout bas, en sourdine
Un appel au cheval qui s'arrête et s'endort
Sur la corde pour de l'herbe et des boutons d'or.
Pauvre vieux ! Ton bateau c'est ta maison, ton bien
Le seul que maintenant tu possèdes et gardes
Avec un soin jaloux, car ton bateau, le tien,
Où la péniche grise à la coque lézarde,
A vu naître ton fils et ce bambin qui cause
Au chien du bord en chien pour lui dire sa prose.
F. CLUSION.
(Verdun, Août 1917)
|
|
Algérie catholique N° 8, aout 1937
Bibliothéque Gallica
|
Etablissement Saint-Vincent de Paul
Chemin d'Hydra, EL-BIAR
A peu près à mi-route entre El-Biar et la Colonne Voirol, du côté opposé à la mer, s'amorce le Chemin d'Hydra qui descend en pente douce jusqu'au vallon qualifié du même nom, évocateur d'ombre et de fraîcheur.
C'est dans ce site champêtre, à la pointe d'un éperon se laissant dominer à l'Est par l'Ancienne Ecole des Frères Saint-Joseph, et au Midi par le coteau boisé de Cham-Sin, que s'élève l'Etablissement Saint-Vincent de Paul.
Une construction simple, formant un ensemble régulier dont les deux ailes semblent protéger la chapelle bâtie au centre.
 Deux étages largement aérés par leurs 33 fenêtres de façade. Deux étages largement aérés par leurs 33 fenêtres de façade.
Une accueillante galerie courant d'un bout à l'autre du corps principal au rez-de-chaussée et versant à flots la lumière par ses dix grandes baies vitrées.
Trois hectares plantés d'Eucalyptus, de pins, d'orangers, de vigne ou patiemment disposés en terrasses pour la culture des légumes et des fleurs.
Un air vivifiant et pur, une vue admirable, du silence, de l'ombre, tels sont, en raccourci les principaux avantages qu'offrent à leurs hôtes le Pensionnat et la Maison de Repos Saint- Vincent.
1° Le Pensionnat
Le Pensionnat peut recevoir cinquante fillettes internes de 5 à 13 ans, et accueille aussi les externes ou demi-pensionnaires du voisinage. Préparation au certificat d'études primaires, à la première communion et aux examens de religion de l'Archevêché.
Gymnastique en plein air, solfège, piano, travaux féminins.
 Une attention toute spéciale est accordée aux enfants dont la santé délicate réclame le grand air et des soins plus assidus mais aucune malade n'est reçue au Pensionnat ; un certificat médical est demandé au moment de l'inscription. Une attention toute spéciale est accordée aux enfants dont la santé délicate réclame le grand air et des soins plus assidus mais aucune malade n'est reçue au Pensionnat ; un certificat médical est demandé au moment de l'inscription.
Le certificat de baptême doit être également fourni.
Le pensionnat est ouvert toute l'année et reçoit aussi des fillettes pour la durée des vacances.
Une colonie de vacance d'Alger y passe le mois d'août.
2° La Maison de Repos
La Maison de Repos occupe à Saint-Vincent l'aile gauche du premier et tout le second étage de l'Etablissement, en tout, quarante places (réparties en chambres à un ou deux lits) réservées aux dames et jeunes filles convalescentes ou simplement désireuses de repos.
Une terrasse et une tribune de plein-pied permettent aux dames pensionnaires du 1er étage d'aller sans fatigue jusqu'à la chapelle. Un aumônier est attaché à la Maison Saint-Vincent.
Le Docteur de l'Etablissement habite à proximité, mais chaque personne peut faire appeler le médecin de son choix.
Les soins simples (piqûres, ventouses, etc... ) peuvent être donnés dans la maison par une Sœur, Infirmière diplômée.
Les malades contagieuses ou atteintes de crises nerveuses ou cardiaques ne sont pas admises. Celles qui désirent suivre un régime doivent s'entendre auparavant avec la Directrice de la Maison de Repos.
L'Etablissement Saint-Vincent est ouvert toute l'année et chauffé en hiver, par le chauffage central.
Plusieurs fois par an la Maison Saint-Vincent ouvre ses portes à des groupements de jeunes filles, soit pour une journée de récollection, soit pour plusieurs jours de retraite fermée.
Pour les communications avec Alger, il y a deux itinéraires :
1 ° Par la Colonne Voirol : Tramways T.A. jusqu'à la Grande Poste
2° Par El-Biar : Tramways ou Autobus C.F.R.A. jusqu'à la Place du Gouvernement. Autobus T.A. jusqu'à la Grande Poste.
Stations de Taxis à la Colonne et à El-Biar (distance : 1 km 500 environ)
Pour tous renseignements s'adresser à Sœur Supérieure, Fille de la Charité, Etablissement Saint-Vincent de Paul, Chemin d'Hydra, à El-Biar.
Les journaux nous ont appris la nomination au siège primatial de Lyon de Mgr Gerlier, évêque de Tarbes et de Lourdes, en remplacement du Cardinal Maurin, récemment décédé.
 Tout le monde en France connaît Mgr Gerlier. Fils d'un haut fonctionnaire des P.T.T., il naquit à Versailles en 1880. Elève du Collège de Saint-Lô, puis du Lycée de Bordeaux, il fit son droit dans cette dernière ville, y passa sa licence et son doctorat, et enfin s'inscrivit au barreau de Paris. Tout le monde en France connaît Mgr Gerlier. Fils d'un haut fonctionnaire des P.T.T., il naquit à Versailles en 1880. Elève du Collège de Saint-Lô, puis du Lycée de Bordeaux, il fit son droit dans cette dernière ville, y passa sa licence et son doctorat, et enfin s'inscrivit au barreau de Paris.
Avocat distingué, il fut de 1911 à 1913 secrétaire de la Conférence dans la capitale, en même temps qu'il se lançait avec toute l'ardeur de sa jeunesse et de son beau talent dans le mouvement catholique.
En 1907 il succédait à Lerolle comme président de l'Association Catholique de la Jeunesse française, et par sa seule présence lui donnait un éclat particulier.
A 33 ans, appelé par une vocation impérieuse, il entrait au Grand Séminaire d'Issy. Il ne devait pas y rester longtemps, car en 1914 la Patrie allait l'appeler pour défendre «le foyer paternel».
Incorporé comme Adjudant au 104e d'Infanterie, il combattait dans la Meuse, puis sur la Marne, et y obtenait la belle citation suivante : Fait prisonnier, l'adjudant Gerlier passa sa captivité à Cologne, en Hanovre et enfin en Suisse. Démobilisé en 1919, il entrait au Grand Séminaire, était ordonné prêtre en 1921 et nommé sous-directeur des œuvres du Diocèse de Paris.
Il se lança avec une autorité accrue dans l'action sociale où il fit merveille, et enfin en 1929, à l'âge de 49 ans, et au bout de huit ans de prêtrise seulement, il était promu évêque de Tarbes.
Mgr Gerlier est un grand animateur. Connaissant le monde pour y avoir vécu, connaissant son temps pour l'avoir étudié et y avoir combattu, le nouvel Archevêque de Lyon sait que le grand remède aux maux dont nous souffrons est dans la rénovation de la mentalité chrétienne... Rénovation dans les cœurs, dans la famille, dans l'usine, dans la cité.
Il prêche la Paix, la Justice, la Charité, et ce qui est mieux encore il les prêche par l'exemple.
Doué d'une gaîté primesautière non exempte d'une aimable et indulgente ironie, sachant parler aux âmes et aux foules, ayant l'audience de tous ceux qui l'approchent, français et étrangers, Mgr Gerlier est bien l'évêque qu'il faut à notre génération. Un magnifique rayonnement émane de sa personne comme de ses paroles. Arrivé au sommet des hommes ecclésiastiques, il est resté le « jeune catholique» d'avant la guerre qui emballait ses camarades et faisait réfléchir ses adversaires.
Nous félicitons le diocèse de Lyon d'avoir à sa tête un tel prélat qui fait honneur à l'Eglise et à la Patrie, et qui dans tous les postes qu'on lui a confiés, a servi avec éclat la Cité de Dieu et celle des hommes.
Nous lui présentons nos vœux et nos hommages.
Paul RIMBAULT.
******************
Pensionnat de la Sainte Famille
- Institution de Jeunes Filles
96, Avenue Georges-Clémenceau, EL-BIAR
Fondé en 1868, par les Religieuses de Saint-Joseph des Vans (Ardèche), dans un site agréable, à proximité d'Alger, le Pensionnat de la Sainte Famille répond admirablement aux conditions qu'exigent la santé et l'éducation des jeunes filles.
Les locaux en sont bien aérés et conformes à toutes les exigences de l'hygiène moderne.
Les cours grandes et bien ombragées, un vaste enclos avec plate-forme gazonnée, petite mer et plage artificielles donnent aux élèves : internes, demi-pensionnaires et externes, toute sorte d'agréments pour les récréations.
L'institution se préoccupe avant tout de la formation morale de l'enfant par des cours d'instruction religieuse journaliers.
Mais en s'efforçant de former des chrétiennes convaincues, des jeunes filles solidement vertueuses, elle ne néglige rien pour leur donner une bonne instruction conforme aux programmes officiels qui leur permet d'obtenir le certificat d'études primaires et le brevet élémentaire.
La culture physique n'est pas négligée : des cours de gymnastique et des promenades assurent le développement normal des enfants dont la santé est l'objet d'une continuelle sollicitude.
Les moyens les plus propres à exciter l'émulation des élèves sont mis en usage : notes hebdomadaires, compositions, inscription mensuelle au tableau d'honneur, etc... Un carnet hebdomadaire, un relevé des compositions trimestrielles tient les parents au courant du travail et des progrès de leurs enfants.
Les relations avec Alger sont faciles : Autobus et tramways C.F.R.A. (place du Gouvernement).
Autobus T.A. (Grande Poste avec correspondance jusqu'à l'Hôpital du Dey).
|
|
Bonjour, N° N°144, 13 octobre 1934
journal satyrique bônois.
|
|
Le Maire de Bône
et la dame aux yeux bleus
Décidément, le Maire de Bône n'a pas de chance. Il lui est impossible de se promener dans « sa ville » sans qu'il lui arrive une histoire ou qu'il en crée.
Hier, sur la Place Caraman, il passait, dans la matinée, suivi par trois ou quatre de ses séides. Il s'arrêta devant une jeune femme qu'il sait n'être pas de ses amis et la toisa avec l'insolence qu'on lui connaît. Il avait des raisons secrètes qu'il ne nous plait pas de dire mais que nous connaissons. Nous, nous empressons d'ajouter, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, que ce sont des raisons politiques.
Notre jeune bônoise qui n'a pas froid aux yeux qu'elle a superbes, d'ailleurs nullement intimidée, apostropha le Maire en ces termes lapidaires et concrets : «Qu'est-ce que vous avez à me toiser, espèce d'abruti ?»
Le propos est textuel, il nous a été rapporté par quatre témoins. Il est vif. Mais il a comme excuse l'insolence du Maire. Il s'ensuivit une courte altercation dans laquelle M. P… n'eut pas le dernier mot.
Il y eut des menaces de part et d'autre. On accuse la jeune femme d'avoir parlé d'une paire de soufflets qu'elle était toute disposée à appliquer sur la figure hautement municipale. Elle le nie d'ailleurs.
Dans la journée, à sa grande surprise, la jeune femme eut une conversation au cours de laquelle elle fut avisée que le Maire avait proféré, à son endroit, la menace suivante : «Si elle me touche, je l'abats comme un chien ! »
Qu'on nous fasse la grâce de croire que nous n'exagérons rien. Nous ignorons si le Maire a prononcé la phrase mais nous affirmons qu'elle a été dite à notre jeune bônoise par quelqu'un de haut placé. Elle a d'ailleurs, répondu, en éclatant de rire : «Comment cette terreur qui s'appelle P…, a peur d'une femme »
On dira que nous ne perdons aucune occasion d'attaquer et de critiquer les actes du Maire. C'est exact, mais nous avons le droit de critiquer ce qui est éminemment critiquable et nous ne nous en faisons point faute.
Nous avons le droit, aussi, en fouillant dans nos souvenirs, d'affirmer que les Maires de Bône qui furent les prédécesseurs de ce maire n'ont jamais créé de scandales sur la voie publique, qu'ils n'ont jamais ni insulté ni «rossé» un Commissaire qu'ils ne toisaient pas les femmes et que les femmes n'invectivaient pas contre eux. Les Maires de Bône étaient respectés par tout le monde parce que, justement, ils se respectaient eux-mêmes.
Pierre Marodon
| |
ALGER ETUDIANT
N° 27. — 5 Avril 1924. Source Gallica
|
| EN RELISANT L’HISTOIRE DE LA BIBLE
LA VERITABLE HISTOIRE DE LAZARE
Lorsque Jésus apprit la maladie de Lazare, il en fut très affecté.
Il quitta aussitôt les bords du Jourdain et se rendit à Béthanie, accompagné de tous ses disciples.
En route, un triste pressentiment l'envahit ; il comprit que son ami avait cessé de vivre et conçut aussitôt l'idée de le ressusciter !
A Béthanie, la première personne qu'il rencontra fut le maître de cérémonies de l'endroit. Ce Gentil (1) — car c'en était un — lui fit part, sans ambages, de la triste nouvelle :
« Nous portâmes Lazare en terre il y a quatre jours, dit-il d'un air très détaché ; depuis, des gens de tout pays viennent consoler Marthe et Marie de la perte de leur frère. J'en viens, moi aussi ; je suis allé prendre quelques arrhes, car la situation du défunt est plutôt douteuse. »
Jésus congédia cet homme de peu de foi, puis se tournant vers ses apôtres il leur annonça sa résolution.
Tout d'abord, on ne le crut, pas : l'œil de Thomas, cet œil fixe, se fit scrutateur et douteux.
Cependant, Judas Iscariote, l'un des douze, célèbre par son astuce et sa mauvaise foi, s'approcha du Seigneur et lui dit : « Maître qu'allez-vous faire !
Je connais votre puissance et l'intérêt que vous portez à la famille Lazare. Votre droite ne saurait certes mieux s'exercer qu'en rendant la vie au plus fidèle de vos serviteurs.
— Ce serait tout de même « trapu », coupa Pierre qui était militaire de profession et savait trouver des mots adéquats. »
Mais Judas continuait :
« Vous savez, Seigneur, que les naturels du pays vous en veulent et qu'ils brûlent de vous traîner devant les tribunaux.
En vous produisant devant cette foule hostile vous risquez
— on me l'a juré
— les horreurs de la lapidation.
— Aurais-tu peur ?
— Non, maître, mais à quoi bon ressusciter Lazare. Il est là depuis quatre jours, quatre jours encore et il sera oublié.
Voyez, la petite madame Lazare se console déjà avec un riche marchand de tissus... Les héritiers, tous pauvres, vont se trouver bien du peu que leur a laissé Lazare. Vous qui protégez les pauvres» laisserez-vous passer l'occasion d'améliorer le sort de quelques-uns uns.
Et puis songez à tous les ennuis que cela va lui attirer. Son acte de décès est dûment signé. Sa situation sera difficile à régulariser. Il lui faudra aller voir Hérode lui-même, qui ne lui pardonnera pas de plaisanter avec les Ecritures.
Et quoi ! Le reverrons-nous bûcher et peiner pour gagner son pain quotidien ? Il luttera dans cette vallée de larmes. Il paiera le tribut à César... il redeviendra mobilisable.
En le prenant jeune, insistait le fallacieux Judas vous lui avez évité les mille et un ennuis de la vieillesse. Demain, par vous, il traînera sur ses béquilles une vie inutile et impuissante. Ayez pitié de lui, Maître, puisque l'Homéogreffe n'est pas encore inventée...
— Ah ! Grand Iscariotier ! Interrompit Philippe, qui faisait des mots.
— Seigneur, ajouta Judas, allez-vous l'arracher aux délices des cieux.
Et Jésus de lui répondre :
— Es-tu si pressé d'aller l'y rejoindre ?»
Judas se tut. Suivis d'une foule imposante, ils avaient franchi les quelques stades qui les séparaient du sépulcre.
Le Maître voulut qu'on ôtât la pierre. La dalle était fort lourde, mais avec quelques jurons bien placés, les fossoyeurs vinrent à bout.
Le défunt apparut alors : ses pieds et ses mains étaient enveloppés de bandelettes, son visage était couvert d'un voile.
Et le tout exhalait une mauvaise odeur.
« Lazare, lève-toi ! ordonna le Seigneur»
Soudain, Lazare se redressa, tout d'une, pièce. Brisant ses bandelettes, chaînes de la mort, il dévoila, son visage amaigri. Les rayons flamboyants du soleil de Palestine l'aveuglèrent un instant. Mais il rouvrit bientôt les yeux.
Alors, sans même dire merci, surgissant brusquement de la grotte, il se précipita vers Judas épouvanté, le saisit à la gorge et le soulevant du sol, s'écria : «Ah ! Te voila fripouille ! Rends-moi les cent deniers que je t’ai prêtés ! ..»
Mais ceci se passait dans des temps très anciens.
Slang. E.
(1) — On entend par « Gentils» dans la Bible, quelques personnages de second plan qui étaient toujours là quand il ne fallait pas
|
|
LA MADELON
ACEP-ENSEMBLE N° 301
|
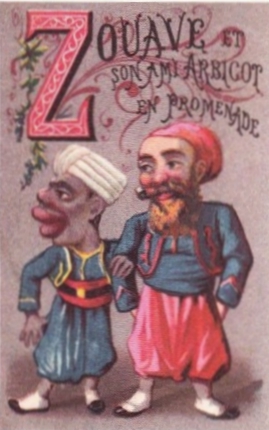 CHAMP (Val d'Oise) raconte comment il fut inspiré pour composer les couplets de « Quand Madelon ». Il avait contracté un engagement volontaire en 1889 au 3éme Régiment de Zouaves à BATNA (Algérie). CHAMP (Val d'Oise) raconte comment il fut inspiré pour composer les couplets de « Quand Madelon ». Il avait contracté un engagement volontaire en 1889 au 3éme Régiment de Zouaves à BATNA (Algérie).
Chaque soir, avec les camarades, il allait au café. La servante était jolie, avenante, cordiale à souhait. Elle riait avec tous. Sa bonne humeur réconfortait tous les exilés de métropole. C'est en pensant à elle qu'il écrivit (en 1913) « Quand Madelon ».
Cette jolie servante avait pour nom Madeleine MARTIN et était la fille des propriétaires du café.
Cet établissement était situé au « Camp », premier quartier de BATNA (capitale de l'Aurès en Algérie), construit à l’intérieur des remparts qui délimitaient le camp militaire à I'origine de la ville.
Le 2 août 1914,les Français courent aux frontières et emportent, avec la fleur au fusil, des chansons aux lèvres. Malgré l'insuccès de « Quand Madelon » le 23 avril, à l'Eldorado, elle fait partie du répertoire que les gars de Paname se plaisent à lancer le soir, au cantonnement de repos.
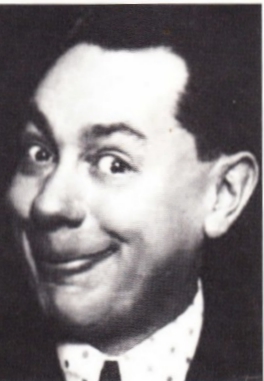 Mais c'est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui, mobilisé au 140ème Régiment d'Infanterie à GRENOBLE, va imposer la chanson aux poilus, sur une musique de Camille ROBERT. Mais c'est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui, mobilisé au 140ème Régiment d'Infanterie à GRENOBLE, va imposer la chanson aux poilus, sur une musique de Camille ROBERT.
Sur la recommandation du Général GALLIENI, il se charge d'une mission dont le Théâtre aux Armées sera plus tard le développement : distraire les combattants.
Il parcourt les villages où Ies troupes de l’armée des Vosges et d'Alsace viennent se détendre.
Il chante où il peut, dans les granges, parfois en plein air. Et les auditoires reprennent en cœur Madelon... Madelon ; Ce chant prend place à côté de I'hymne national.
Les fanfares françaises et anglaises se saluent au son de « Quand Madelon ». Du front où elle a reçu la consécration de ceux qui se battent, la chanson gagnera I'arrière.
A la vérité, dans les villages proches du front où régnait la faune des mercantis, rares étaient les « Madelons » dignes de figurer dans la légende. Mais le poète n'écrivait-il pas « qu'importe le vase, pourvu qu'on ait l’ivresse » ?
Avec « La Madelon », les héritiers du 7ème Régiment de Chasseurs d'Afrique sont restés en pays de connaissance.
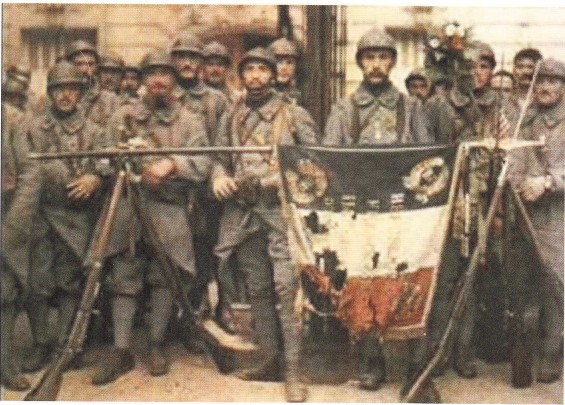
I
Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas à deux pas de la forêt,
Une maison, aux murs tout couverts de lierre,
« Aux Tourlourous », c'est le nom du cabaret.
La servante est jeune et gentille,
Légère comme un papillon.
Comme son vin, son œil pétille,
Nous l'appelons la Madelon.
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour
II
Quand Madelon vient nous servir à boire,
Sous la tonnelle, on frôle son jupon.
Et chacun lui raconte une histoire,
Une histoire à sa façon.
La Madelon pour nous n'est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton,
Elle rit c'est tout l'mal qu'elle sait faire.
Madelon, Madelon, Madelon !
IlI
Nous avons tous au pays une payse
Qui nous attend et que l'on épousera.
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise,
Ce qu'on fera quand la classe rentrera.
En comptant les jours, on soupire,
Et quand le temps nous semble long,
Tout ce qu'on ne peut pas lui dire,
IV
On va le dire à Madelon.
On l'embrasse dans les coins.
Elle dit : « Veux-tu finir... ,
On s'figure que c'est l'autre, çà nous fait bien plaisir.
V
Un caporal en képi de fantaisie
S'en vint trouver Madelon un bon matin.
Et fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie,
Et qu'il venait pour lui demander sa main.
La Madelon, pas bête en somme,
Lui répondit en souriant :
« Pourquoi prendrais-je qu'un seul homme
Quand j'aime tout un régiment ? »
Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main,
J'en ai bien trop besoin pour leur servir du vin.

|
|
Morts pour la France !
Poème: Victor Hugo (1802–85)
Envoyé Par plusieurs correspondants
|
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ;
Et, comme ferait une mère,
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau !
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !
À ceux qu'enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !
C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue,
Que le haut Panthéon élève dans la nue,
Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours,
La reine de nos Tyrs et de nos Babylones,
Cette couronne de colonnes
Que le soleil levant redore tous les jours !
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !
À ceux qu'enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !
Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,
En vain l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ;
Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle,
La gloire, aube toujours nouvelle,
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !
A ceux qu'enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !
Hymne, Les Chants du crépuscule (1835
|
|
|
PHOTOS BÔNE
Envois divers
|
|
Délly-Ibrahim, premier village d’Algérie
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°181 Janvier 2010
|
C'est dans I'espace vallonneux que forme le Sahel algérois que ce petit village a été édifié par des émigrés alsaciens.
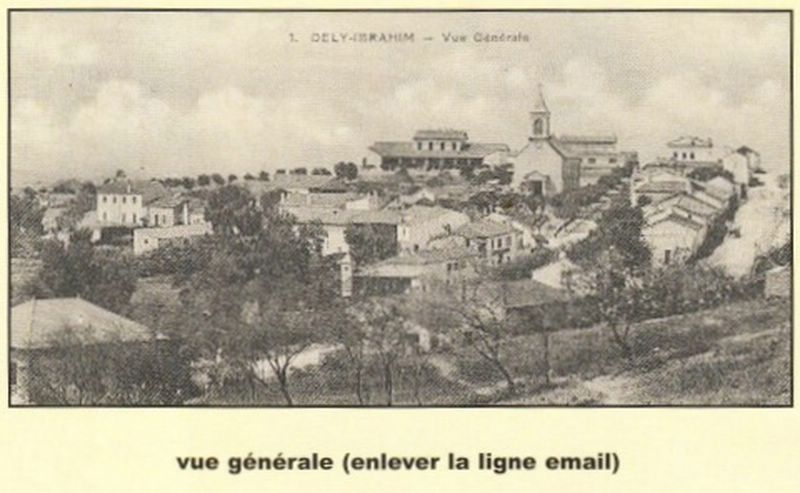 Pour en situer l'époque, certains écrits indiquent que son église a été consacrée le 21 mars 1841 par le premier évêque d'Algérie : Monseigneur DUPUCH. Pour en situer l'époque, certains écrits indiquent que son église a été consacrée le 21 mars 1841 par le premier évêque d'Algérie : Monseigneur DUPUCH.
Au départ d'ALGER, distant d'une dizaine de kilomètres, il est accessible en empruntant les tournants ROVIGO, en longeant la Prison civile " BARBEROUSSE " et la caserne d'Orléans ou alors la rue Michelet et le boulevard Galiéni, ces deux itinéraires rejoignant EL BIAR, point de passage obligé.
Non loin de là, CHATEAUNEUF, carrefour des routes de BOUZAREAH, CHERAGAS et SAINT-FERDINAND, MAHELMA, cette dernière conduit, par le "Retour de la chasse " à BEN AKNOUN (et son lycée, vivier de bien beaux esprits). Un parcours ombragé mène ensuite au hameau des " DEUX BASSINS ".
S'amorce alors une côte sinueuse qui rencontre I'embranchement d'EL-ACHOUR avec en contre-haut, dissimulée dans d'épaisses frondaisons, la ferme BOYER.
Enfin, au sortir d'un virage, la route, bordée d'eucalyptus, laisse entrevoir un cimetière militaire anglais (marque de la seconde guerre mondiale), avant de s'engager dans I'agglomération de DELLY-IBRAHIM où les maisons étagées à flanc de coteaux entourent l'église.
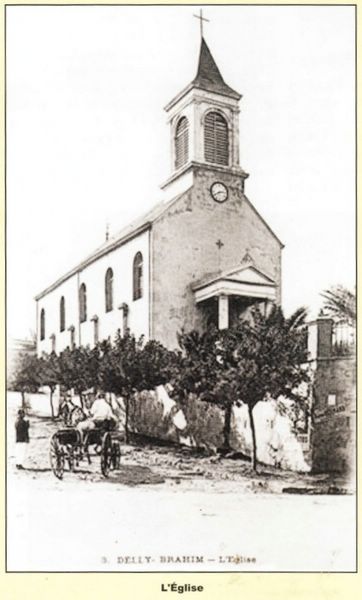 Dans la partie inférieure du village, bordant de part et d'autre l'axe conduisant vers OULED FAYET, s'alignent entre autres demeures, I'unique boulangerie du pays (SEMPERE),I'auberge du "BON CANARD" (AUBIS), réputée pour une certaine gastronomie, le monument aux morts. le Café de France (PICOT), la Mairie, l'épicerie HUGOU, véritable caverne d'Ali-Baba. Dans la partie inférieure du village, bordant de part et d'autre l'axe conduisant vers OULED FAYET, s'alignent entre autres demeures, I'unique boulangerie du pays (SEMPERE),I'auberge du "BON CANARD" (AUBIS), réputée pour une certaine gastronomie, le monument aux morts. le Café de France (PICOT), la Mairie, l'épicerie HUGOU, véritable caverne d'Ali-Baba.
À la sortie du village, vers la colline du " Grand Vent ", juché sur un sommet voisin surplombant EL-ACHOUR, le cimetière caractérisé par ses stèles dont les inscriptions indiquent les dates les plus anciennes de la présence française.
Revenant sur la partie supérieure du village, la poste et ses dépendances occupent une position dominante. La route, vers CHERAGAS, sur son tracé, le long de la crête balayée par les vents, offre un vaste point de vue sur l'étendue des cultures, blondes et ondoyantes au moment des moissons.
Dans le lointain, masqué par aucun relief en cet endroit, le "PETIT STAOUËLI '', le domaine viticole BORGEAUD, et au-delà se dessine par temps clair la plage de SIDI-FERRUCH avec, pour les témoins de l'époque, I'inoubliable vision de I'armada Anglo-Américaine débarquant le 8 novembre 1942.
En poursuivant vers CHERAGAS, le " Bois des Cars " devient visible. C'est un bel endroit agréablement odorant dont les essences principales sont: le pin d'Alep, le cèdre et le cyprès.
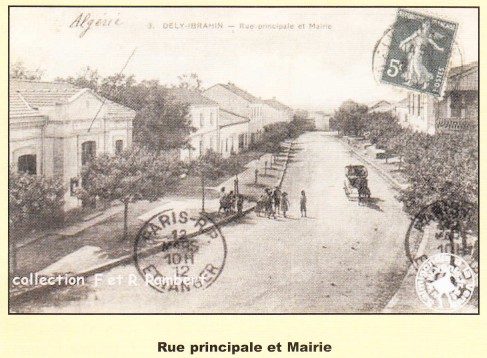 Les chemins qui le sillonnent se raccordent à une clairière centrale au milieu de laquelle a été érigé, en 1912, un monument à la mémoire des combattants du corps expéditionnaire de l'Armée d'Afrique de 1830. Cet ouvrage est surmonté du buste du lieutenant général " DUC des CARS " qui s'illustra dans diverses activités glorieuses. Les chemins qui le sillonnent se raccordent à une clairière centrale au milieu de laquelle a été érigé, en 1912, un monument à la mémoire des combattants du corps expéditionnaire de l'Armée d'Afrique de 1830. Cet ouvrage est surmonté du buste du lieutenant général " DUC des CARS " qui s'illustra dans diverses activités glorieuses.
Face à cet édifice, la guinguette du père MARI et, à proximité, le boulodrome, haut lieu de divertissement sportif ou villageois et autres Algérois se mesurent avec passion dans d'âpres concours de " longue ", toujours clôturés par de copieux arrosages à la guinguette d'à côté.
Aux abords du bois, dans la partie opposée à la route de CHERAGAS, la tribu de la ZOUAOUA (ou ZOUAVA) est un groupement de familles autochtones qui, selon des dires, aurait été créé par les autorités pour y accueillir les anciens " enrôlés " dans les régiments de zouaves. Jouxtant toujours le bois, la ferme KASTLE, dont le maître des lieux, un solide cultivateur attaché à sa terre, est un authentique descendant des pionniers alsaciens.
Dans le voisinage du village, sur une hauteur, existe un orphelinat de confession protestante avec, attenant, un temple d'allure simple, sans faste ni éclat. Vivant très discrètement, dans un milieu aux pratiques très austères, les pensionnaires n'ont de contact avec l'extérieur que sur les bancs de l'école.
Dans le prolongement de cet établissement, surplombant le village, se dresse la colonne BOUTIN, du nom d'un colonel du génie qui, sous les apparences d'un paisible pêcheur, avait sondé les fonds marins autour d'ALGER pour conclure que le meilleur endroit pour un débarquement militaire se trouvait à SIDI-FERRUCH.
À la vérité, les descriptions de ce paysage, à I'exception de I'aspect géographique, ne correspondent pas, hélas, à la réalité d'aujourd'hui.
> Autour des années 1938-1954, il était agréable de vivre dans cet îlot champêtre. L'air y était salubre et souvent recommandé par le corps médical.
Chacun y avait sa place dans des activités diverses.
Les cultivateurs, les plus nombreux, exploitaient leurs terres dans les domaines céréaliers, viticoles, maraîchers et dans la production laitière. D'autres exerçaient leur métier à la ville.
Les plus âgés, retirés de la vie active. coulaient des jours tranquilles au rythme du carillon de l'église qui égrenait ses notes (accordées à trois tons) tous les quarts d'heure.
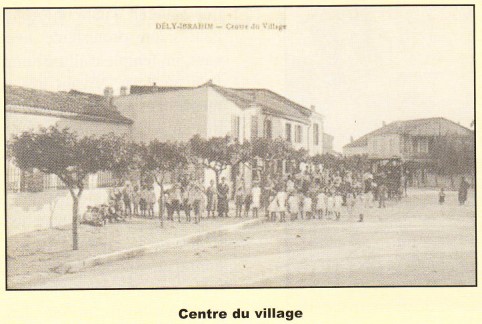 Pour toute force de police, un garde-champêtre, en képi à épis de blé, assurait une surveillance relative, assisté, en cas de besoin, par la brigade de gendarmerie de CHERAGAS. Dans cette fonction, les CAZERTE et ROUX, entre autres, s'y sont, tour à tour, distingués. Pour toute force de police, un garde-champêtre, en képi à épis de blé, assurait une surveillance relative, assisté, en cas de besoin, par la brigade de gendarmerie de CHERAGAS. Dans cette fonction, les CAZERTE et ROUX, entre autres, s'y sont, tour à tour, distingués.
Rémy CORBI, le cantonnier, entretenait assidûment la voirie avec, également la tâche ingrate de creuser les fosses au cimetière.
De cette population émergeait une personnalité marquante : l'abbé CERALTA, curé de la paroisse, successeur du bon père DAIGNIERE.
Homme d'une grande force physique, à la barbe drue et à la voix retentissante, il était très influent dans le cadre de son ministère.
D'une rare érudition dont il faisait profiter son entourage, il n'hésitait pas à " tomber " la soutane pour prodiguer à la jeunesse ses conseils sportifs.
Cette jeunesse s'épanouissait dans une saine ambiance à l'abri des tentations nocives qui existent de nos jours.
Les jeunes filles, aux habitudes plutôt casanières, se montraient dans l'éclat de leur fraîcheur lors des sorties dominicales et autres événements festifs aussi bien qu'aux offices religieux et à la chorale de l'église. Les jeunes garçons, plus enclins au vagabondage, se répandaient dans le village et les environs, dans leurs jeux enfantins. Les espiègleries n'étaient pas exclues et certains villageois en faisaient souvent les frais. Plus tard, en grandissant, ils allaient exprimer leurs ardeurs juvéniles, hors du village, vers d'autres centres d'intérêts.
Tout ce monde fréquentait l'école communale, limitée en deux ou trois classes, à I'enseignement primaire.
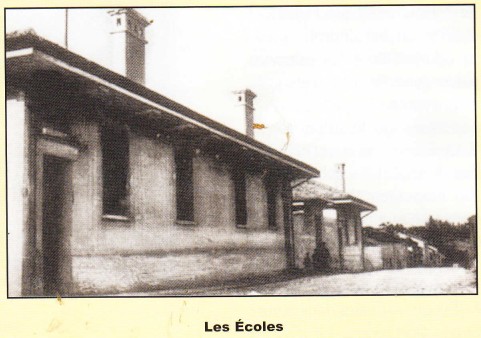 Suzanne SCHILTZ, la directrice, tenait son cours de fin de cycle élémentaire avec une autorité sans faille. Aucun désordre n'était toléré. Suzanne SCHILTZ, la directrice, tenait son cours de fin de cycle élémentaire avec une autorité sans faille. Aucun désordre n'était toléré.
La morale et I'instruction civique enseignées, complétées par l'éducation parentale, produisaient des effets bénéfiques. Les quelques cancres, toujours en fin de classement (il en fallait bien) étaient " vigoureusement cadrés ". Honteux aveu, I'un d'entre eux n'était autre que le narrateur de ce fait.
Les cours inférieurs étaient assurés par l’instituteur BUSTON, personnage au comportement curieux et d'une sévérité excessive. Son attitude lui valait d'être irrespectueusement raillé par les jeunes, en dehors de la classe bien sûr.
Comme dans tous les petits villages aux mœurs rurales, l'organisation de la vie sociale était soumise aux obligations rigoureuses du travail de la terre et de l'élevage au détriment des loisirs. L'ennui planait souvent sur le village. Les distractions étaient comptées.
Le jeu de boules était roi, les rencontres au bistro pour un verre (ou plusieurs), ou pour une partie de cartes, étaient fréquentes. Les courses cyclistes où brillaient les champions ZAAF et KEBAILI, ainsi que les locaux ODILON et Louis MAILLOT, créaient de I'animation.
Le cross-country avait aussi ses adeptes. Certains ont même eu la fierté, lors d'une course internationale sur I'hippodrome du CAROUBIER (ALGER), de figurer au côté... au départ... du légendaire Emil ZATOPEK.
Le Bois des Cars, par I'attrait qu'il suscitait, créait également du mouvement.
Tous les week-ends et jours fériés de beau temps, il foisonnait d'amateurs de " grand air " et la guinguette du père MARI ne désemplissait pas d'une clientèle citadine.
Plus discrètement, en semaine, la clientèle était toute autre : des "dames" exerçant dans les maisons spécialisées algéroises venaient de loin en loin y prendre quelque repos réparateur.
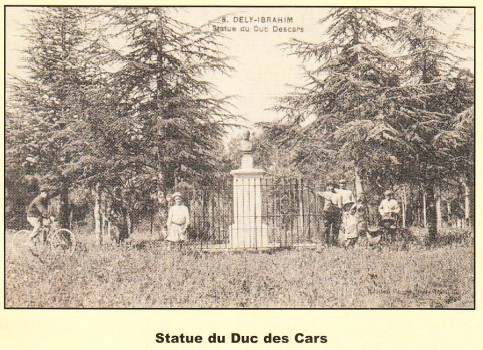 La fête du village, annuelle, donnait lieu à un bal sur la place centrale ombragée de palmiers. Un orchestre entraînait tout le bon peuple aux rythmes des tangos langoureux et des rumbas lascives, tandis que les " mamas ", assises en bord de piste, surveillaient d'un regard attendri, mais non moins attentif, les évolutions de leur progéniture... féminine. La fête du village, annuelle, donnait lieu à un bal sur la place centrale ombragée de palmiers. Un orchestre entraînait tout le bon peuple aux rythmes des tangos langoureux et des rumbas lascives, tandis que les " mamas ", assises en bord de piste, surveillaient d'un regard attendri, mais non moins attentif, les évolutions de leur progéniture... féminine.
1939. Evoquant l'épisode de la guerre, les images surviennent : le recensement et la réquisition des chevaux au profit de I'année. La mobilisation et le départ des hommes valides pour l’inconnu.
Puis 1942. La présence des troupes américaines. Les alertes aériennes (elles étaient annoncées, non par une sirène, mais à I'initiative du receveur des Postes M. TEULE, par un vieil avertisseur de voiture émettant un bruit de crécelle, actionné par manivelle).
Lors d'un bombardement, un projectile a atteint une maison d'habitation au cœur de I'agglomération. La providence a bien voulu épargner les occupants.
Dans ce cours des choses, certaines jeunes filles en ont tiré avantage, en trouvant " chaussure à leur pied " parmi les jeunes soldats en garnison passagère.
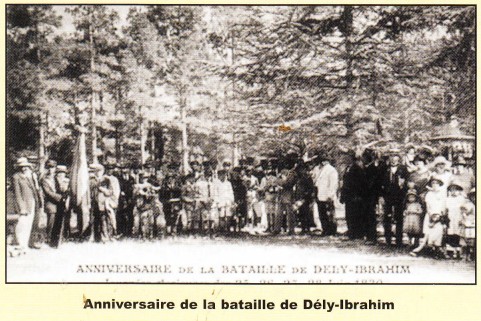 La guerre terminée, les combattants sont rentrés avec pour certains, de graves blessures (comme Raymond BEKER). La guerre terminée, les combattants sont rentrés avec pour certains, de graves blessures (comme Raymond BEKER).
Après que les noms des : Jacques GUTHE, Georges ROLAND et l'un des fils PONS, aient été ajoutés sur la colonne du monument aux morts, le village a retrouvé, pour un temps, son visage et ses habitudes d'antan.
Pour un temps, en effet, jusqu'au jour où le vent de la révolte et sa folie meurtrière a soufflé.
Alors, de la si paisible communauté villageoise a surgi une jeune fille, sans mal-être apparent, mais secrètement nourrie du ferment de la haine. Dans les moments les plus tragiques de la rébellion, elle a basculé dans le terrorisme le plus cruel.
Les carnages provoqués par les bombes déposées dans ALGER, notamment au MILK BAR et au bar OTOMATIC (foyer des étudiants), en sont le sanglant témoignage.
Progressivement, témoins et victimes de cette tragédie barbare s'en sont allés vers des horizons nouveaux, parfois incertains, laissant à d'autres le soin d'exercer leur emprise.
Ainsi la voix du " muezzin " s'est substituée à la cloche pour l'appel des fidèles à la prière et le drapeau à la mairie a changé de couleur et de signification aussi.
Il reste que, tout là-haut, isolé sur une colline, le petit cimetière conserve jalousement la trace des artisans d'un passé florissant.
Voilà une petite histoire racontée au travers des souvenirs de quelqu'un qui a vécu dans ce lieu une heureuse jeunesse.
Puisse ce récit raviver la mémoire de ceux qui ont suivi ce même itinéraire.
Jean-Pierre BUSSO
Extrait de la revue
"Aux Échos d'Alger"
N° 84, mars 2004
|
|
MINISTERE de l’ALGERIE 1957
Envoyé Par M. C. Fretat, pages de 57 à 82
|
PACIFICATION - REFORMES
ACTION PSYCHOLOGIQUE
Directive de M. Lacoste.
Le rôle de I'Armée dans l'action psychologique :
Action sur les soldats.
Action des soldats.
Les officiers itinérants d'action psychologique:
La conquête pacifique de la population.
L'officier itinérant.
LE ROLE DE L'ARMÉE DANS
L'ACTION PSYCHOLOGIQUE
(Directive adressée à l'Armée en mai 1956
Je voudrais ici donner un contenu pratique et concret aux principes généraux que j'ai exposés dans la Directive Générale destinée aux officiers et sous-officiers stationnés en Algérie...
L'action militaire n'est rien sans une action sur les opinions…
L’ACTION SUR LES SOLDATS
II faut que tous les militaires soient conscients de l'action que le gouvernement entend mener en Algérie et, pour cela, il importe, dès maintenant, de définir le rôle de l'Armée, de faire comprendre le sens de l'entreprise de pacification. J'insiste sur la nécessité de faire connaître aux soldats toute l'étendue et tout le sens de leur mission.
En résumé, l'action psychologique sur l'armée doit:
1° Faire comprendre à chaque soldat qu'it doit fournir, outre l'action purement militaire, une action psychologique qui n’est pas moins importante et qui s'exerce par des contacts humains ;
2° Donner à chaque soldat les moyens d'accomplir cette action en lui fournissant les consignes, les éléments de discussion, etc…
ACTION DES SOLDATS
Le premier précepte être humain :
En conséquence, il convient absolument d'être vigilant à l'égard des provocations des rebelles qui, par leurs actions terroristes, visent à déclencher des réflexes de représailles qu'ils montent ensuite en épingle. Ils espèrent ainsi faire croire que la France pratique une guerre d'extermination ; ils espèrent dresser contre nous l'opinion internationale et les grandes puissances dont ils recherchent l'appui diplomatique.
L’importance des moindres attitudes.
Conscients de cette mission, nos soldats doivent éviter toutes les maladresses gratuites à l'égard des populations musulmanes. Ces fautes ne feraient que développer la haine dans les cœurs des populations paisibles qui n'auraient jamais songé à se retourner contre nous. Il faut penser, en outre, que chacune de nos erreurs est exploitée par la propagande de l'adversaire qui les utilise pour émouvoir les populations aussi bien que les nations étrangères.
Les blessures d'amour-propre que peuvent provoquer une marque de mépris, une brutalité inutile, l'emploi de termes offensants ou l'irrespect à l'égard des coutumes locales, éveillent le ressentiment et ont une importance considérable du fait que le soldat est un représentant de la France. Le respect au contraire attire le respect. Les soldats ne doivent jamais oublier qu'aujourd'hui et ici plus que jamais, chacun de leurs actes engage la France.
Il est nécessaire aussi que les soldats aient à cœur de sauvegarder par leur tenue et leur dignité, le prestige que l'année française conserve auprès des populations musulmanes.
L'Action psychologique proprement dite.
Une fois définies ces consignes, je voudrais préciser le rôle positif qui incombe à I'Armée. Tout en détenant la force, l'Armée représente, en fait, un des éléments de contact les plus pratiques entre le gouvernement et la population.
Je ne saurais trop encourager l'organisation de cours de langue arabe, à l'intention des officiers et des soldats, partout ou cela est possible.
L'Armée doit faire comprendre aux populations musulmanes I'entreprise de pacification du gouvernement, leur montrer qu'elle n'est pas là pour leur faire la guerre, mais pour les protéger. ElIe doit aussi travailler à rétablir le contact et à combattre l'isolement dans lequel tendent à s'enfermer les deux communautés. Cette préoccupation doit conduire les militaires à saisir toutes les occasions de la vie courante pour rendre des services aux populations : par exemple, transport d'un malade, secours médicaux, aide dans les travaux...
L'Armée doit jouer le rôle de trait d'union, en agissant à la fois sur les populations musulmanes et sur les populations françaises, pour rompre cette sorte de complicité dans I'ignorance réciproque et, si l'on n'intervient pas au plus vite dans la haine...
Je voudrais dire en conclusion combien je suis convaincu que, en témoignant leur volonté sincère de paix et l'amitié, les soldats français renforceront considérablement l'effet des réformes généreuses que j'ai entreprises.
Robert LACOSTE.
LES OFFICIERS ITINÉRANTS D’ACTION
PSYCHOLOGIQUE EN ALGERIE
Le 2 janvier 1957, M. Lacoste envoyait aux I.G.A.M.E. (Inspecteurs Généraux de l'Administration en Mission Extraordinaire), en leur demandant de le transmettre à leurs subordonnés, le télégramme suivant :
« Afin de vivifier L'action psychologique sur la population musulmane rurale, entreprise par I'Armée conformément aux directives du ministre résidant en Algérie, le secrétaire d'Etat aux Forces armées « terre » a mis à la disposition de l'état-major de la Xème Région militaire des officiers itinérants d'action psychologique.
« Ces officiers, qui reçoivent leurs directives de la Direction générale des Affaires politiques, doivent faire appliquer par les commandants d'unités implantées, avec le concours des autorités civiles dont relèvent les populations contactées, une méthode qui a déjà fait ses preuves.
« Il est demandé aux préfets, sous-préfets, administrateurs et officiers S.A.S. de faciliter dans toute la mesure de leurs moyens la mission de ces officiers. »
Quelle est cette méthode ? Quels résultats a-t-elle permis d'obtenir ? Comment a-t-elle été répandue en Algérie ?
La conquête pacifique de la population...
Dans la guerre en surface que nous, civils et militaires, devons gagner en Algérie, la population est, en fait I'objectif à conquérir. En effet, les unités qui cherchent les rebelles sur les pistes et les crêtes, se livrent à un travail ingrat, trop souvent sans résultat. Pourtant l'ennemi est là. Il se cache au milieu de la population, il subsiste grâce à elle, elle est pour lui un support moral, matériel et tactique.
Cette population est donc un élément nouveau du problème que I'Armée doit résoudre en Algérie. Elle est un objectif qu'il faut conquérir sans le détruire. Le rebelle agit sur elle par la terreur. Nous devons lutter contre cette action en créant, en développant et en entretenant la force collective de la masse.
Nous avons eu une manifestation de cette force à l'occasion des vendanges, le rebelle avait interdit d'aller travailler dans les vignes, les vendanges ont été faites et la récolte de cette année a atteint un chiffre record. Entre mourir de faim et mourir en travaillant, les fellahs ont choisi. Devant ce mouvement collectif, le rebelle n'a pas réagi, n'a commis aucune exaction. II a été battu par la masse, il en sera toujours ainsi lorsqu'elle agira sans hésitation et en bloc. L'ennemi n'a pas de prise sur elle, alors qu'il peut agir sur des groupes ou des individus isolés.
Par l'éducation..
Pour créer cette force collective, il faut éduquer la population. Les pouvoirs civils ne disposent pas du personnel suffisant. Le gouvernement a installé en Algérie une armée de 400 000 hommes qui partage avec les officiers de S.A.S. la charge de cette éducation.
Les S.A.S. actuellement installés ne sont pas assez nombreuses pour remplir seules cette tâche. Dans certains départements, I'officier chef de S.A.S. administre 5000 habitants, dans d'autres plus de 50000. Toutefois, le plan d'installation des S.A.S. prévoit de ne pas dépasser 20 000 habitants.
Ces chiffres font apparaître clairement la nécessité de conjuguer les efforts de l'Armée et de l'administration.
Si les hommes doivent être des juges de propagande, les cadres doivent être des éducateurs.
Chaque commandant de compagnie doit organiser une fois par semaine au minimum une réunion publique d'orientation à base d'information, d'éducation et de distraction.
Cette réunion doit durer une heure. Dans un pays de palabres, il faut palabrer longtemps. L'officier dans le bled ne peut pas consacrer à la préparation de ses réunions des heures de recherche et de réflexion.
En outre, il ne faut pas laisser libre cours à I'imagination de chacun, si I'on ne veut pas aller, en Algérie, à un travail décousu et désordonné.
Aussi, des fiches sont-elles envoyées par la Direction générale des Affaires politiques du Gouvernement Général et par le Bureau psychologique de la Xème Région, à toutes les unités implantées. Ces fiches sont le développement des raisons pour lesquelles nous avons bonne conscience en Algérie. Elles sont valables de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il faut les utiliser en les adaptant au particularisme des habitants et eu tenant compte des événements.
Ceux qui les repousseraient en raison de ce particularisme devraient les remplacer par un instrument de travail qui permettraient de parler des même sujets, pendant le même temps. Ce serait pour eux un travail supplémentaire qu'ils ne pourraient pas faire.
En réalité, cette adaptation ne se traduit que par quelques nuances. En effet, cette méthode d'éducation des masses a été tirée des techniques éprouvées qui sont valables aussi bien pour les Blancs que pour les Noirs et les Jaunes. D'ailleurs dans toutes les écoles d'Algérie, les instituteurs dispensent-ils le même enseignement !
Il ne faut donc pas exagérer, dans l'application de cette méthode, l'importance des différences entre Ies habitants.
L'amélioration de ses conditions d'existence.
La population se laissera convaincre si nous lui prouvons que nous lui voulons du bien, si nous l'aidons à améliorer ses conditions de vie, si nous arrivons à obtenir que les réunions éducatives se déroulent dans une ambiance détendue.
A cet effet, les fiches comprennent en dehors des thèmes de propagande, une partie éducative traitant de l'hygiène et des devoirs civiques et une partie récréative. Il faut que les Musulmans se plient aux règles de I'hygiène. Le précepte latin - mens sana in corpore sano - est aussi valable en Algérie qu'ailleurs. Certains prétendent que le Nord-Africain a toujours été crasseux, I'est et le restera. C'est une vieille légende qu'il faut démolir. L'hygiène individuelle progresse, mais l'hygiène familiale est médiocre et celle du village est inexistante. Grâce à l'Armée et aux S.A.S., I'hygiène du bled doit s'améliorer.
Les parties récréatives sont indispensables. Les officiers peuvent penser que l'âge des boys-scouts est passé. Il ne faut pas raisonner par rapport à nous, mais par rapport au milieu ou nous voulons exercer notre action. Les réunions ne seront réussies que si nous provoquons une détente.
L’Officier itinérant...
Il ne s'agit pas de faire un discours académique devant la population, mais de liredes phrases simples et de les faire répéter par l'interprète. Celui-ci est nécessaire même pour les officiers parlant l'arabe. Il faut parler à une famille, à un village, il est le premier pas vers le ralliement.
La réunion d'une heure doit être préparée avec lui une heure avant. II faut lui expliquer le texte pour qu'il le traduise sans hésitation et avec I'intonation voulue. Il peut facilement tricher sur une phrase, il lui est difficile de le faire une heure durant. Les réactions de l’auditoire nous permettent de le juger. Il sait que toute irrégularité l'expose à une sanction et qu'il peut être contrôlé par un autre interprète.
L'interprète est le facteur de base de la pacification. Il faut d'abord le rechercher, assurer sa protection et son existence. Il n'est pas question d'exiger des diplômes. Il faut se contenter de connaissances élémentaires. Il faudra parfois vaincre des réticences par la réquisition, puis obtenir une adhésion totale par une mise en confiance que nous sommes capables de réaliser.
Un éducateur qui doit convaincre.
Pour expliquer cette méthode à tous les bataillons implantés en Algérie, vingt-cinq officiers instructeurs, appelés officiers itinérants, ont été choisi. Ils n'ont pas suivi de stage de formation en France. Ils en ont subi un d'un genre tout particulier d'où ils sont sortis convaincus de la nécessité de ce nouveau mode de combat.
Plusieurs sont d'anciens prisonniers du Viet Minh. Ils ont vu une armée prendre en main la population pour s'en assurer rapidement le concours. En outre, des hommes qui se sont accrochés à la vie avec une énergie farouche sont capables de faire preuve de la patience et de l'entêtement dans l'effort que nécessitent le conformisme et même le désir de ne pas comprendre de certains.
Ces officiers sont répartis à raison de un pour huit bataillons. Leur nombre est nettement insuffisant. Il va falloir le doubler. Ils ont déjà été rejoints par quelques anciens des Affaires indigènes. Leur mission est de convaincre, instruire et aider. Ils ont commencé par faire des démonstrations, puis ils ont aidé les commandants de compagnie à organiser leurs réunions eux-mêmes et enfin ils repassent pour veiller à la régularité du travail.
Les O.I. passent, les S.A.S. et les cadres des unités implantées doivent, grâce à la documentation et à la méthode, continuer tout seuls.
Cette action doit obligatoirement être menée dans le cadre d’une campagne d'affiches et de slogans qui a d'heureux effets, non seulement sur la population, mais également sur nos propres troupes.
Cette méthode est simple et a été accueillie partout avec scepticisme, tant par les civils que par les militaires. Partout, une seule démonstration a suffi pour convaincre.
Ne jamais relâcher son effort.
Dans un village de Kabylie tenu par une compagnie du IIéme Choc, la population est venue à la réunion sans réticence, mais toutes les bouches étaient cousues. Ce village possède une école depuis trente ans. Tout le monde y parle le français. Mais l'officier itinérant n'obtint aucune réponse, même à des questions fort simples comme celles relatives à la reconstruction de l'école. Cependant aucune hostilité ne se lisait sur les visages. On sentait qu'il y avait une présence qui empêchait les habitants de parler.
L'officier itinérant ne s'est pas découragé et a conduit sa réunion jusqu'au bout. Le lendemain, le capitaine du IIéme Choc recevait une lettre anonyme donnant le souterrain du village. Une petite opération a été aussitôt montée et nous avons trouvé de I'habillement, des munitions et de I'armement. Un enfant nous a indiqué le commissaire politique qui, à trois kilomètres, s'éloignait à dos de mulet. Le IIème Choc fit appel aux hélicoptères et deux Bell l'ont pris en chasse, encadré sur une piste et fait prisonnier. Le capitaine de cette compagnie avait été sceptique, il fut complètement convaincu.
Dans un autre village de Kabylie, le lendemain d'une démonstration très facile, devant une population très sympathisante qui ne trous a pas ménagé ses applaudissements, un vieux musulman est venu voir le lieutenant de la S.A.S. et lui a dit : « Vous nous avez parlé hier, c'est la première fois, vous nous avez fait plaisir, voici la liste de la cellule politique du village. »
Dans un autre endroit, le chef de chantier avait été égorgé le matin même de notre réunion. L'officier itinérant a retourné la population en lui faisant condamner les crimes des fellaghas. Le lendemain le commissaire politique était trouvé, à son tour, égorgé devant sa porte.
La population est une sorte d'accumulateur, de réservoir d'énergie qu'il ne faut jamais laisser tomber à plat. Il faut le recharger sans cesse.
Dans plusieurs villages enfin, les habitants se sont ralliés dans l'enthousiasme dès la première séance, demandant des armes pour assurer leur propre défense. Nous avons fait naître dans bien des endroits, cette force collective.
Il faut que la population tout entière en prenne conscience et traduise dans les faits sa volonté de se débarrasser, en union avec les forces de l'ordre, de l'organisation rebelle, les bandes et I'infrastructure politico-administrative.
Faut-il des spécialistes ou peut-on demander à I'officier de mener ce combat ?
Et avoir foi en sa mission
Pour faire démarrer la méthode dans la vallée de Soummam, au sud d'Akbou, I'officier itinérant a été dirigé, par le chef de bataillon commandant le chantier, sur un lieutenant du type baroudeur. A 12 heures, le chef du village, convoqué, s'est présenté, a reçu l'ordre de réunir la population pour 13 h. 30 et de venir à 12 h. 45 préparer la réunion. L'officier itinérant a dicté au lieutenant la séance classique : nouvelles, histoires de Djeha et thème de propagande. Le maire comprenait parfaitement et ne semblait pas embarrassé par les nuances à rendre.
A 12 h. 30, les hommes qui n'étaient pas aux olives, et les enfants, étaient présents. Une centaine de personnes en tout. Les enfants de l'école coranique ont souhaité la bienvenue par un chant qui a provoqué les applaudissements de tous, Musulmans, soldats et visiteurs. Le lieutenant baroudeur a expliqué patiemment son texte. Voyant sa population réagir favorablement, s'intéresser à ce qu'il disait, il a réussi avec un papier de trois quarts d'heure, à faire une séance d'une heure et demie. Lorsque ses explications tombaient dans le vide, il s'en apercevait, les reprenait, les simplifiait. Les femmes, qui n'étaient pas convoquées, tendaient l'oreille en se pressant aux coins des rues. Le maire s'est révélé un excellent interprète. Pour que les enfants comprennent bien les histoires, il les faisait répéter phrase par phrase. Ce truc que l'O.I. ne connaissait pas, les amusait beaucoup.
Le chef de bataillon, convaincu par la réussite de son lieutenant baroudeur, décida de faire, trois jours après, une réunion dans un autre village en convoquant un officier par compagnie.
Il ne faut pas de formation spéciale pour réussir. L'officier est avant tout un instructeur. Il doit pouvoir éduquer aussi bien une recrue musulmane que la famille de celle-ci.
Dans ce nouveau combat, le français doit se méfier de lui-même. Les premiers résultats sont d'autant plus trompeurs qu'ils sont spectaculaires. Il faut, en milieu musulman, les entretenir avec vigilance.
Les ralliements sont en réalité des adhésions fragiles. Il nous faut donc renforcer la conviction des habitants. Ils sont français, ils le savent, il faut le leur faire affirmer régulièrement, avec nous, à I'occasion de nos réunions.
Une foi ardente peut préférer des manifestations intérieures, le recueillement, des prières silencieuses, I'isolement, mais les fois fragiles ou chancelantes sont étayées, encouragées, vivifiées par la force des manifestations collectives, chants et prières récités en chœur.
Enfin, il faut que les jeunes officiers sachent que dans une discussion, le musulman cherchera toujours à rouler le roumi.
« Pourquoi travailles-tu comme les communistes, disait un jour un chef kabyle à un jeune capitaine de chasseurs alpins, ces slogans sur les murs, ces réunions politiques, ce n'est pas français. » Et le capitaine s'est laissé convaincre.
Ce chef ne parlait pas au nom de la liberté de pensée, mais il flattait l'esprit français dans son intérêt.
Si les chefs kabyles sont nettement de notre niveau, nos réunions publiques nous ont prouvé que la masse est loin derrière.
Ces chefs, qu’ils soient députés, présidents de conseils municipaux, ou d'autres choses, se jouent de nos subtilités démocratiques. Ils ont gardé et garderont encore longtemps, leurs réflexes de grands féodaux.
Plus la masse sera éduquée, moins leur piédestal sera élevé, moins nous aurons besoin d'eux, plus il nous sera facile d'agir directement sur elle, de trouver de nouveaux chefs dont le passé n'handicapera pas l'avenir.
Les quelques rares notables algériens qui ont le sens de la chose publique, ne doivent pas se sentir visés par ce paragraphe. Il existe, en effet, des Musulmans qui comprennent que la vraie liberté est celle de l'individu et non celle d'une collectivité qui ne bâtirait son indépendance que dans des désordres sociaux ou I'individu perdrait ses droits.
Les officiers itinérants n'ont pas eu de résultats uniquement dans la population. Ils ont convaincu leurs camarades et leurs chefs. Un général disait à l'un d'eux, en juillet dernier : « Qu'est-ce que vous venez faire chez moi ? » Trois mois plus tard, ce même général déclarait : « Je ne discute plus, les résultats sont là, mais vos types ont la foi. »
Grâce à l’allant des O.I., les officiers au contact de la population, qu’ils soient commandant de compagnie ou chef de S.A.S., se sont mis au travail.
MESURES PRISES ET BILANS
Rétablissement de l'ordre :
Divisions et subdivisions militaires.
Délégations de pouvoirs.
Mesures d'ordre judiciaire.
Surveillance des frontières.
Réglementation de certaines importations et ventes.
Mesures particulières.
Dissolutions d'organisations diverses.
L'action en faveur des populations :
Programme d'urgence dans les zones de pacification.
L'assistance médicale dans le cadre de la pacification.
Bilan des travaux de l'Armée.
L'Armée de pacification.
Bilan de ses travaux.
Délégation de pouvoirs.
Dans un esprit de décentralisation, Ie ministre résidant a délégué aux autorités civiles (I.G.A.M.E.), préfets, inspecteur général des Territoires du Sud) une partie des pouvoirs qu'il détenait en vertu du décret du 17 mars 19506.
Suivant les déplacements des secteurs opérationnels de la rébellion, certains des pouvoirs ainsi délégués ont été temporairement confiés à l'autorité militaire dans les régions particulièrement menacées.
C’est ainsi que, dans le domaine du maintien de l'ordre, un arrêté préfectoral du 7 janvier 1957 a délégué à I'autorité militaire certains pouvoirs à l’intérieur du département d'Alger. Cette mesure, qui a soulevé les plus vives critiques, mais dont les résultats ont justifié l'efficacité, s'imposait à la suite des consignes de grève insurrectionnelle lancées par le F.L.N. avant la session de l'Assemblée de l'O.N.U. consacrée à I'examen de la question algérienne.
Mesures d’ordre judiciaire
En temps de crise, la justice ne doit pas seulement permettre de redresser les torts, mais avoir aussi une vertu exemplaire. Pour cela, il faut qu'elle soit rapide sans cesser d'être juste.
En premier lieu, les compétences des tribunaux militaires sont accrues (décret du 17 mars 1956). Ils connaissent de tous crimes contre la sureté de l'Etat, de la rébellion avec armes, des attroupements criminels, des associations de malfaiteurs, du recel de criminel, des entraves à la circulation routière et ferroviaire, des trafics d'armes, des meurtres, des coups et blessures qualifiés crimes, des séquestrations, viols, attentats à la pudeur, pillages, vols et recels qualifiés crimes et d'une manière générale de tous crimes et délits portant atteinte à la défense nationale.
Toutefois, cette compétence n'est que facultative ; l'autorité militaire peut laisser la justice suivre son cours devant les juridictions de droit commun,
En second lieu, comme en temps de guerre, les tribunaux militaires (dont le nombre a été quadruplé par le décret du 17 mars 1956) ne se composent que de militaires, mais le président de chaque juridiction est en réalité un magistrat mobilisé
En troisième lieu, la procédure suivie est celle du temps de guerre. En cas de crime ou délit flagrant (décret du 17 mars 1956), l'inculpé est présenté directement et sans délai minimum au tribunal militaire, sans instruction préalable, s'il est porteur d'arme ou d'habillement militaire ; s'il ne choisit pas de défenseur, le bâtonnier lui en assigne un d'office. Aucun recours contre les mesures préalables n'est possible avant la condamnation (décret du 12 mai 1956) qui ne peut faire l'objet que d'un pourvoi devant un tribunal militaire de cassation siégeant à Alger.
Surveillance des frontières.
Algérie - Tunisie. Dès le 14 mars 1957, un arrête amplifie les mesures de surveillance appliquées à la frontière algéro-tunisienne et restreint la circulation entre les deux territoires.
Surveillance générale.
Des arrêtés ont réglementé la surveillance maritime des côtes et renforcer les mesures de contrôle aux frontières.
Entrée en Algérie.
Par arrêté du 19 mars 1956, le ministre résidant en Algérie a réglementé l'entrée en Algérie des Français et des étrangers.
Dorénavant, toute personne se rendant en Algérie, quels que soient sa nationalité et le motif de son voyage, devra être munie à son entrée sur ce territoire d'une autorisation de voyage délivrée en Algérie par le Gouverneur général, les préfets et les sous-préfets, et valable pour des périodes variables. Des dérogations à cette mesure sont cependant prévues pour certaines catégories de personnes.
Sortie d'Algérie.
Un arrêté du 14 juin 1956, modifié par un arrêté du 13 juillet, réglemente de façon générale la sortie d'Algérie de tous les citoyens français du sexe masculin ayant plus de vingt ans et moins de quarante-huit ans, en la soumettant à une autorisation préalable qui peut être valable pendant un an, mais qui est délivrée seulement si l'autorité militaire atteste que le demandeur n'est pas requis, qu'il n'appartient pas aux éléments mobilisés d'une unité territoriale ou que son absence est compatible avec les nécessités de ces services.
Dans ce dernier cas, l'absence peut se trouver limitée à un mois maximum.
Par ailleurs, des circulaires administratives de juin 1956 et de mars 1957 ont invité les directeurs et chefs de services de I'Administration centrale ainsi que les préfets des départements algériens à limiter à quinze jours au maximum les congés de détente des fonctionnaires et agents de services publics directement associés à l'exercice des responsabilités gouvernementales.
De plus, dans le cadre de chaque service et de chaque circonscription territoriale, une seconde catégorie plus étendue de fonctionnaires et agents voit également son régime normal de congé fixé uniformément à trente jours.
Réglementation de certaines importation et ventes.
La vente, l'importation et l’achat des armes, munitions, explosifs, appareils radio-électriques, produits chimiques et pharmaceutiques ont été sévèrement réglementés.
Mesures particulières.
Il importait, ainsi que le ministre résidant l'a déclaré à maintes reprises, de mener la lutte contre les éléments subversifs de toutes tendances. Tandis que plusieurs mesures d'internement, d'éloignement ou de mise en résidence, étaient prononcées contre quelques ultras particulièrement agités, des dispositions analogues éloignaient temporairement d'Algérie des éléments « progressistes » dont l'action ne pouvait qu'ajouter à la confusion de la situation.
Dissolution d’organisations diverses.
Dans le même esprit, toutes les associations dont l’activité avait pour but, avoué ou non, d’entraver l’action de pacification, soit en créant un climat de nature à gêner cette action, soit en aidant plus ou moins directement la rébellion, ont été dissoutes.
Sont dans ce cas:
- l'Association « Union Française Nord-Africaine » (dissoute par décret du 16 mars 1956) ;
- le Conseil central algérien des Œuvres sociales du personnel de I'E.G.A. (dissous par arrêté du 16 octobre 1956) ;
- trois Sociétés de Secours créées au sein d'organismes miniers (dissoutes le 22 octobre 1956) ;
- l'Organisation de Résistance en Afrique française (O.R.A.F.) (dissoute le 11 décembre 1956) ;
- le Comité de la Renaissance française (C.R.F.) (dissous le 11décembre 1956).
Par ailleurs, le décret du 26 novembre 1956 a mis fin aux mandats de tous les représentants du personnel élus dans le cadre syndical de la C.G.T. et de I'U.G.S.A. et a pourvu provisoirement à leur remplacement.
L’ACTION EN FAVEUR DES POPULATIONS
PROGRAMME D'URGENCE
DANS LES ZONES DE PACIFICATIONS
Pour aider au renforcement de l'ordre une fois rétabli dans une région déterminée, il était indispensable d'édicter un certain nombre de mesures destinées à permettre d'entreprendre rapidement des réalisations locales dans les domaines administratif, économique et social.
But de ces mesures.
Apporter un remède immédiat aux destructions causées par la rébellion et améliorer les conditions de vie des populations. Pour donner à l’application de ce programme la plus grande souplesse, l'élaboration et la réalisation en sont remis aux autorités locales, agissant toutefois selon les directives des préfets ou des commandants civils et militaires et des sous-préfets.
Le cadre d'action a été fixé par l'arrêté n° 46 AP/CL/2 du 9 juillet 1956, qui a institué un programme de restauration immédiate, dit « programme d'urgence », dans les zones de pacification et prévu la mise en œuvre de ce programme, dont les principaux éléments sont :
- la nomination aux postes abandonnés par leurs titulaires, de candidats choisis parmi les populations ralliées et qui se sont distingués par leur loyalisme agissant, ou de tout autre candidat qualifié ;
- l'ouverture de chantiers de chômage, destinés à procurer un salaire aux travailleurs sans emploi et, simultanément, à exécuter certains travaux répondant aux vœux les plus instants des habitants ;
- la remise en état sommaire d'installations ou de bâtiments indispensables à la vie des habitants ;
- I'attribution de secours en nature et, éventuellement, quoique exceptionnellement, en espèces ;
- les préfets, commandants civils et militaires, et par délégation de ces hauts fonctionnaires, les sous-préfets et chefs de communes, reçoivent des pouvoirs spéciaux pour :
- engager, liquider et mandater des dépenses de salaires, de secours, de fournitures en travaux, de transports et, éventuellement, de prestations de services ;
- prononcer des nominations d'agents auxiliaires.
Enfin deux circulaires fixent les modalités d'application de ces arrêtés. Ce sont les circulaires n° 47/AP/CL/2 du 9 juillet et 1954/LP/ et CL/2 du 18 septembre 1956.
Mise en œuvre du programme d'urgence.
Sans entrer dans le détail des réalisations qui ont été obtenues ou qui sont en cours au titre de ce programme, on aura une idée assez précise de leur importance depuis la parution de la réglementation, c'est, à ce jour, une somme globale de trois milliards qui a été mise progressivement à la disposition des trois inspecteurs généraux de l'Administration en mission extraordinaire, pour être répartie entre les différents départements.
Cette somme se décompose comme suit :
- Région d'Alger (moins le département de Tizi-Ouzou) .. 845 millions de fr
- Département de Tizi-Ouzou 150»»
- Région de Constantine (moins le département de Bône) 1050 »
- Département de Bône 270 »
- Région d'Oran ensemble) 675 » »
Territoires du Sud « 10 »
On constatera d'abord que les plus gros volumes de crédits ont été attribués aux régions les plus peuplées et en particulier à la région de Constantine où Ie sous-emploi est Ie plus important. Enfin, on notera que les deux tiers de ces sommes ont été affectées à l'ouverture de chantiers pour l'aménagement de chemins destinés à desservir les douars ; viennent ensuite les aménagements de points d'eau pour l'alimentation des douars et mechtas et la restauration des bâtiments administratifs détruits par les rebelles, tels écoles, centres de santé, etc
Un Exemple : l’ouverture des chemins.
Par la collaboration de la direction des travaux publics du gouvernement Général et de l'autorité militaire (génie), a été élaboré un programme de construction des chemins nécessaires à la pacification et pouvant être utilement incorporés dans Ie réseau des voies secondaires.
Ces réalisations ont pour but d'assurer un meilleur contact avec les populations rurales et de mieux satisfaire leurs besoins.
Les premiers crédits ont été alloués au début de 1957, à savoir : 200 millions pour les chemins à incorporer aux réseaux départementaux et 225 millions pour les chemins à incorporer aux réseaux communaux.
Ces travaux sont exécutés par Ies services ordinaires avec Ie concours des unités du Génie.
L’ASSISTANCE MEDICALE
DANS LE CADRE DE LA PACIFICATION
Un des aspects les plus considérables de I'œuvre des forces de l'ordre est la participation qu'elles ont apportée à l'œuvre d'assistance médicale dans les campagnes.
Permanence de l'assistance médicale.
Cette action découlait, en effet, de la nature même de la mission de l'Armée en Algérie, I'un des tout premiers objectifs de la pacification devant être de contribuer à accélérer le développement des services médicaux publics sur l'ensemble du territoire. Mais les événements commandaient également que soit assurée la continuité de l'assistance médicale dans les régions où l'insécurité avait pu entraîner une certaine paralysie des services de la Santé publique, en utilisant l'implantation du quadrillage administratif et militaire.
Tel a été l'esprit des différentes circulaires qui ont déterminé les conditions de participation des médecins des corps de troupes en opération et des médecins des S.A.S. à l'extension de l'assistance médicale gratuite (A.M.G.).
La plus importante de ces circulaires, celle du 13 août 1956, adressée aux médecins de la Santé chefs de circonscription médicale et aux directeurs d'hôpitaux, prévoit que des prises de contacts entre les médecins précités et les médecins militaires doivent aboutir, dès l'installation de ces derniers, à une harmonisation des activités des uns et des autres par la délimitation de zones d'influence et à l'utilisation au mieux du service à remplir des équipements locaux tels que salles de consultation fixes ou mobiles, hôpitaux, dispensaires, ainsi que du personnel paramédical. Les médecins militaires sont, en outre, habilités à improviser eux-mêmes l'ouverture de consultations gratuites en cas d'absence totale de médecin civil, ou dans les circonscriptions ou les médecins civils ont dû suspendre les tournées de soins dans les centres et douars.
Coordination de l’action sanitaire.
Tandis que des contacts réguliers entre les responsables du service de santé militaire, des services de la santé publique et de l’action économique et administrative doivent permettre d’assurer la présence de médecins militaires dans les S.A.S., des recensements ont permis d'établir des ordres d'urgence pour les circonscriptions médicales les plus dépourvues de secours médical ainsi que pour les points d'implantation médicale les plus favorables à la distribution normale de l'assistance.
Enfin, différents modes d'approvisionnement en produits pharmaceutiques ont été fixés pour permettre un ravitaillement rapide des médecins de la santé, des médecins des S.A.S. et des formations militaires, chacun étant, en outre, tenu de fournir mensuellement des comptes rendus de ses activités, de ses besoins et de l'état sanitaire des populations qui lui sont confiées.
Grâce à ce remarquable effort d'adaptation, au 31 janvier 1957, les soins gratuits pouvaient être dispensés par 200 médecins civils fonctionnaires et 150 médecins militaires, le nombre de ces derniers étant passé peu de temps après à 350, et plus de 50 % de la population totale bénéficiait de I'A.M.G.
Enfin, la preuve la plus tangible du succès de cette action est l'adhésion massive que les populations musulmanes lui ont apportée et que nul ne peut nier.
L’ARMÉE DE PACIFICATION
Sa tâche.
Les forces de l’ordre stationnées en Algérie ont reçu la mission d'en assurer la pacification.
Il ne fait pas de doute qu'une armée forte de 400 000 hommes aurait depuis longtemps eu raison de quelque 30 000 rebelles, si l'opération entreprise était une véritable opération de guerre.
Mais c'est précisément parce qu'une forte proportion de musulmans nous est restée fidèle, malgré toutes les pressions subies, que l'action des forces de l'ordre a toujours été freinée par le souci de respecter leur vie, et de sauvegarder leurs biens.
Les rebelles ont au demeurant parfaitement compris l'intérêt qu'il y avait pour eux à s'identifier avec la masse de la population musulmane, afin de compromettre celle-ci à nos yeux. Si I'on rencontre de plus en plus rarement, sauf aux frontières, de fortes bandes armées, quelques fellagha bien armés peuvent facilement s'imposer à la population paisible de tout un douar par la loi de la terreur. Menaces contributions forcées, enlèvements, meurtres, mutilations, sont les procédés les plus couramment employés pour contraindre au silence, voire à la collaboration active ou passive, les gens les mieux intentionnés à notre égard. Et lorsque les forces de l'ordre se présentent devant ce douar, quelques coups de fusils, tirés par cette minorité de fanatiques, peuvent laisser croire que la population tout entière est passée à la rébellion.
Devant cette situation exceptionnelle, il appartenait à l'Etat-Major de l'armée de préciser, à tous les échelons d’exécution, l'attitude à observer à l’égard des populations musulmanes.
Une première instruction a été publiée dès le 1er juillet 1955, d'autres ont suivi à intervalles réguliers.
Œuvre de pacification et non pas « répression »
Rien que les plus hautes autorités, tant civile que militaire, qui ont la responsabilité de la conduite des opérations de pacification en Algérie, aient nettement exprimé leur volonté résolue de réduire au maximum les conséquences d'une action armée, bien que cette volonté ait été, à de rares exceptions près, parfaitement suivie à tous les échelons de l'exécution, une campagne, menée aussi bien à l'étranger que dans certaine presse française, tente de faire croire que notre armée pratique une politique de répression systématique en Algérie.
Quelle est la valeur de ces accusations ?
Le point peut être fait de la façon la plus précise, car le ministre résidant en Algérie ne s'est pas simplement contenté de prescrire dans ses différentes instructions les limites qu'il convenait d'imposer à l'action des forces de I'ordre. Il a, dans le même temps, créé un organisme de contrôle destiné à s'assurer qu'en toutes circonstances ses directives sont respectées. C'est à des commissions mixtes d'enquête, composées de hauts fonctionnaires et d'officiers supérieurs, que cette tâche a été confiée.
Chaque fois qu'une plainte est adressée soit au cabinet du ministre résidant, soit à l'Etat-Major du général commandant interarmes, ces commissions mixtes se rendent sur place pour mener leur enquête.
Munies de pouvoirs étendus, elles entendent tous témoins, aussi bien civils que militaires et c'est sur les conclusions qu'elles déposent, que l'autorité responsable est amenée à statuer.
Il est permis de dire, au vu des dossiers constitués par ces commissions, que, dans la plupart des cas, les accusations formulées sont sans fondement et que les exactions reprochées à nos troupes sont l'œuvre de nos adversaires.
On sait, en effet, que la rébellion est loin de constituer un front uni. Des rivalités, des luttes d'influence opposent dans bien des cas les rebelles entre eux. Le Front de la Libération Nationale s'oppose au Mouvement National Algérien et cette lutte impitoyable est jalonnée de nombreux cadavres dont on a trouvé expédient de faire endosser la responsabilité aux forces de l'ordre. D'autre part, à diverses reprises, des rebelles revêtus d'uniformes français ont commis des atrocités dans le but de provoquer l'indignation des populations musulmanes et de les dresser contre la France.
Reste que certains cas isolés révèlent une défaillance de la part des unités opérationnelles. Seuls ceux qui n'ont jamais participé activement à une opération de ce genre peuvent prétendre qu'ils est possible d'exiger de façon absolue, de la part de militaires engagés dans I'action, le sang-froid qui doit permettre d'éviter certains excès. Devant le spectacle trop fréquent de cadavres odieusement mutilés, éventrés, le nez coupé, cadavres de vieillards, de femmes ou d'enfants, l'exaspération saisit parfois nos soldats et les entraîne à des représailles qui, sans jamais atteindre l'horreur qui se dégage des actes de l'adversaire, n'en sont pas moins condamnables.
Auraient-elles I'excuse de la provocation, ces représailles, qui sont malgré tout l'exception, ont toujours été durement et sévèrement sanctionnées sur le plan judiciaire et sur le plan disciplinaire.
Le vrai visage de l’armée de pacification
Ainsi, l'armée française a parfaitement compris le sens de I'œuvre qui lui est confiée. Chargée de rétablir l’ordre, elle sait qu’en dehors du combat, elle ne doit jamais oublier que son action doit être affranchie de tout esprit de vengeance. Elle sait qu'elle est en Algérie pour protéger, donner confiance et reforger patiemment, là où elle est ébranlée, la solidarité franco-musulmane. En mettant à la disposition d'une population souvent malheureuse les moyens puissants dont elle dispose, en créant des routes, en détachant auprès des douars ses médecins, en reconstruisant et assurant le fonctionnement des écoles brûlées par les fanatiques, elle poursuit, fidèle à ses traditions, I'œuvre de civilisation capable de ramener sur cette terre d'Afrique la paix et le bonheur.
Le bilan de sa participation à l'œuvre de pacification se traduit dans les faits, depuis le 1er janvier 1957, par le bilan ci-après :
CHANTIERS (moyennes mensuelles) :
- Chantiers en activité 353
dont : ouverts par l'armée ... ..174
protégés par l'armée .... .. ..... 180
- Effectifs de protection 6 508
- Pistes nouvelles créées 176 k
- Pistes anciennes améliorées 647 k
ENSEIGNEMENT:
- Ecoles tenues par l'armée 212
- Instituteurs fournis par l'armée 355
- Nombre d'élèves 11 700
ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE :
- Médecins militaires pratiquant l'assistance médicale gratuite 372
- Consultations et soins gratuits prodigués (moyenne mensuelle) 165 000
N.B. : Compte non tenu des consultations données dans les Territoires du Sud et des soins prodigués par les infirmiers des unités.
AIDE À L'ADMINISTRATION :
- Commandements civils et militaires (créés fin mai 1957) :
Officiers 9
Sous-officiers 6
- Cadres détachés aux Affaires algériennes et sahariennes :
Officiers 702
Sous-officiers 518
- Officiers assumant, à la date du 1er juin 1957, les fonctions de Délégués Spéciaux :
Affaires algériennes 235
Corps de troupe 60
DIVERS (moyennes mensuelles) :
Cadres et hommes de troupe détachés aux :
- Travaux publics 52
- Télécommunications .. . . 8
- Police 136
-Recherches pétrolières et minières, Energie atomique, prospection électrique 42
88
Algérie 1957, ministre de l’Algérie
|
|
PARACHUTISME
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°181 - Janvier 2010
|
En tant que discipline sportive, le parachutisme en Oranie naquit officiellement en 1955 lorsqu'un ancien du 1er bataillon de choc, Roch Lombard, réussit à regrouper quelques combattants de la seconde guerre mondiale, ayant appartenu soit à son unité soit au 2ème Régiment de Parachutistes, dans le dessein de fonder la Première association spécialisée.
Le jeune club prit la dénomination : Para club d'Oranie et eut pour siège social une salle de I'Automobile club d'Oranie mise sportivement à sa disPosition.
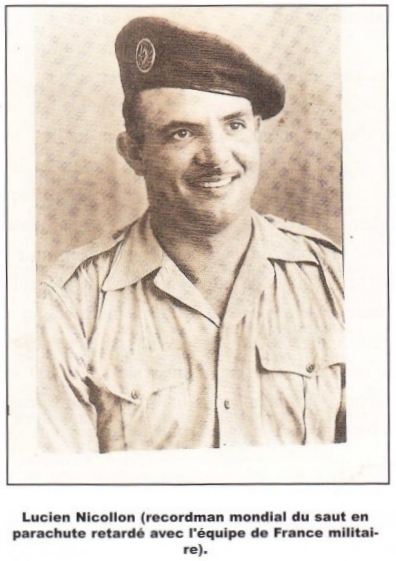 La présidence échut au colonel André Lajoix et la vice-présidence à Roch Lombard, cheville ouvrière de la nouvelle société et dont le local commercial, rue Ramier, était utilisé pour les réunions du bureau. Celui-ci comprenait entre autres membres Particulièrement actifs André Rigal, Christian Faure, Jean Sanchez et le judokas Magot, instituteur, Théodore Garcia. La présidence échut au colonel André Lajoix et la vice-présidence à Roch Lombard, cheville ouvrière de la nouvelle société et dont le local commercial, rue Ramier, était utilisé pour les réunions du bureau. Celui-ci comprenait entre autres membres Particulièrement actifs André Rigal, Christian Faure, Jean Sanchez et le judokas Magot, instituteur, Théodore Garcia.
Les premiers sauts furent effectués en 1956 entre La Sénia et Valmy à partir d'un biplan Dragon spécialement venu de Biscarosse avec le moniteur largueur Prick.
Lucien Nicollon (recordman mondial du saut en parachute retardé avec l'équipe de France militaire)
Cette branche sportive connut une expansion aussi accélérée qu'inattendue.
Quatre causes Primordiales semblent l'expliquer.
Le succès exemplaire d'un ancien athlète et basketteur du Gallia club oranais, I'adjudant Lucien Nicollon, alors en affectation à Pau, titulaire de l'équipe de France qui battit le record mondial par équipe détenu par l'U.R.S.S. de saut au Parachute avec ouverture retardée.
Les évènements du moment qui mettaient en valeur I'importance du rôle du parachutisme militaire et ses possibilités de moyen d'éventuel secours attirèrent I'attention du public.
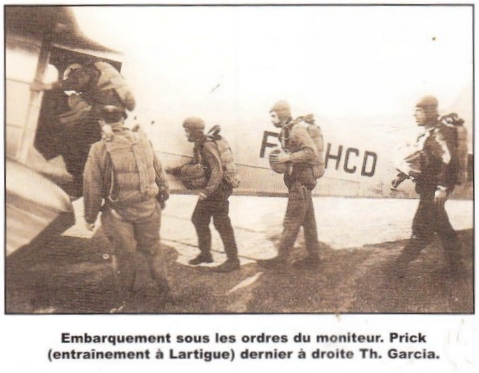 La tentation de s'enivrer de frisson par opposition à toute vie sédentaire confinée dans la bureaucratie. La tentation de s'enivrer de frisson par opposition à toute vie sédentaire confinée dans la bureaucratie.
L'activité déployée par le bureau du Para club d'Oranie dont I'effectif ne tarda pas à atteindre environ 430 sociétaires civils dont 30 jeunes filles et 400 militaires.
Les séances de parachutage seront régulièrement assurées sous la direction du pilote Walkowiak, les appareils prenant leur départ de la base aéro-navale de Lartigue.
Divers types d'avion furent utilisés en fonction des disponibilités et de l'aide momentanément accordée : Stamp, Tiger Math, Farchild, Morane 500, DC 3, Nord-Atlas, C 119, et le préféré des sociétaires le Dragon Haviland.
Parmi les sauteurs les plus en évidence citons Gris Norbeft, surnommé "le héros de la chute libre" et Rosy Cerdan.
Les efforts des membres du Para club d'Oranie trouvèrent leur légitime récompense en décembre 1956 lorsque ceux-ci battirent le record de France en nombre de sauts effectués en un mois. Chiffre dépassant 1300.
L'organisation d'un meeting (qui en raison de l'évolution de la situation politique devait être I'unique) le 11 novembre 1957 obtint un succès considérable grâce à la participation de Monique Duval, recordwomen d'Europe et future recordwomen du monde et d'Andernos Mosconi, recordman de hauteur sans inhalation de plus de 10 000 mètres.
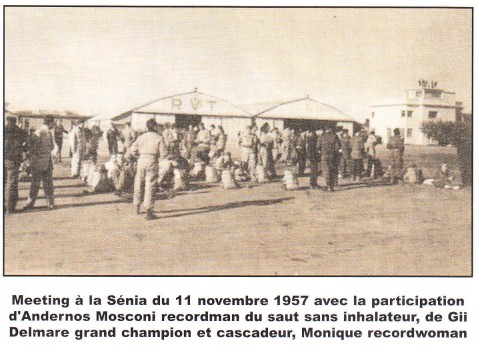 Le 9 décembre 1960, succédant à des interdictions partielles, une interdiction générale de survol du territoire algérien intervint. Le 9 décembre 1960, succédant à des interdictions partielles, une interdiction générale de survol du territoire algérien intervint.
Par ailleurs I'activité de quelques éléments et non des moindres du Para club d'Oranie ayant été jugée subversive par les autorités dans le cadre de la nouvelle politique gouvernementale, des mesures restrictives de liberté furent prises à I'encontre de ceux-ci.
L'initiative de Roch Lombard avait abouti en I'espace de quelques années à un résultat extraordinaire que seuls des évènements externes au monde sportif devaient réduire à néant.
P. O.
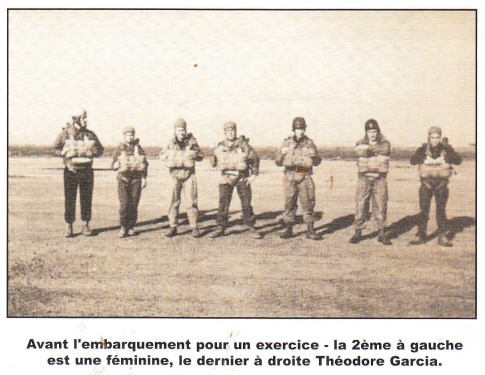
|
|
| BOUTONNAGE
De Jacques Grieu
| |
Autrefois le « bouton » n’était qu’objet discret
Qu’on trouvait en couture pour fermer un gilet,
Un manteau, une chemise ou bien un pantalon.
Certains petits malins en faisaient collection…
Chaque bouton s’attache, humble fruit d’une aiguille
Pour dans sa boutonnière bien caler sa coquille.
C’était, dans nos enfances un de nos premiers gestes,
Où chaque boutonnage était pour nous un test.
Si tous les pesticides ont tué nos bouton-d’or,
Les boutons des acnés, il en existe encore.
Quant aux boutons de fièvre et aux bouton-pressions,
On n’est sans doute pas près de voir leur suppression.
Ce qui change maintenant, dans notre monde moderne,
C’est que tout se commande en touchant des boutons.
Qu’on les pousse, qu’on les tourne, enfonce ou bien les tire,
C’est ce qui fait entendre, voir, agir, réagir.
A la moindre intention un bouton, il nous faut;
La souris du PC, elle-même, est bouton faux.
Quand on presse dessus, on dit que c’est « cliquer »,
Mais c’est comme un bouton sur lequel appuyer !
La vie presse-bouton, la guerre presse-bouton,
Loin de tout simplifier dans nos modes d’action,
Font qu’on contrôle moins tout ce que nous faisons;
Sans rien améliorer, c’est une complication…
Boutons et boutonnières, s’ils existent encore,
On les trouve bien lents, malhabiles et désuets.
Bien d’autres fermetures les ont donc remplacés :
La fermeture-éclair, le velcro, le cliquet…
La « Guerre des Boutons », vieux roman oublié,
Nous montrait bien la place de ces ronds irisés.
Nous devons espérer que malgré le progrès,
La nacre du bouton, gardera ses attraits.
Jacques Grieu
|
|
|
Charles Landelle «1812-1908),
orientaliste à succès
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°181 - Janvier 2010
|
Né d'une famille modeste, il épouse en 1857 Alice Letronne, fille du garde général Jean-Antoine Letronne qui sauva les Archives nationales en 1848.
De cette union, naîtront deux fils Georges et Paul, décédés tous du vivant de leur père.
 Peintre officiel Peintre officiel
La carrière de ce fils d'employé de la préfecture de Laval est le type même de celle du peintre officiel du XIXe siècle, de celui qui veut réussir.
En 1827, il suit son père à Paris. Il ne reviendra dans sa ville natale qu'à la fin de sa vie.
Au départ, un talent et un métier, très solide appris à l'école des Beaux-Arts de Paris (à partir de 1837).
Elève de Paul Delaroche et d'Ary Scheffer, Charles Landelle débuta au Salon de Paris en 1841 avec des tableaux religieux et des portraits qui furent immédiatement appréciés.
Et tout de suite, le souci constant de recevoir honneurs et récompenses. Ses portraits et ses grands tableaux religieux connaissent un succès immédiat. Dès l'âge de 20 ans, il expose son premier tableau, un auto-portrait.
Il est remarqué par Louis-Philippe au salon de 1841 et aussitôt médaillé et encensé par la critique.
Napoléon III, qui I'admire beaucoup, lui achète pour les, offrir à la ville de Laval, les deux toiles des " Béatitudes " (1852). À 34 ans, I'Empereur le décore de la légion d'honneur pour " Le repos de la Vierge " qu'il acquiert personnellement. C'est la consécration et la fortune. II est le portraitiste talentueux de la haute société (célèbre portrait de Musset). Les musées, les églises (Saint-Sulpice, Saint-Germain-l'Auxerrois), les bâtiments publics, les palais nationaux (l'Élysée) s'ornent de ses grandes compositions. En 1848, la Ville de Paris lui achète Sainte-Cécile toujours en place en l'église Saint-Nicolas-des-Champs.
En 1859, il réalise suite à une commande de I'empereur la décoration d'un salon du palais de l'Élysée, celui des aides de camps. Six dessus de portes représentant les quatre éléments (l'eau, le feu, l'air et la terre) et une allégorie de la paix et de la guerre. Il peignait beaucoup très vite, trop vite. Il a dû réaliser 2.000 à 3.000 tableaux avec les répliques, même tableaux refaits à des dimensions différentes (l'un d'eux sera refait 23 fois).
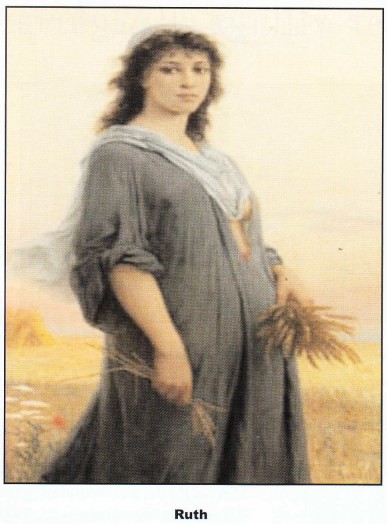 Le succès Le succès
Très rapidement, Landelle oscille entre une création témoignant d'un talent indéniable et d'une tendance à plaire, à se laisser aller à la facilité ou à suivre les modes, comme I'orientalisme.
Ses voyages en Afrique du Nord et au Moyen-Orient vers l'âge de 45 ans sont cependant I'occasion d'œuvres souvent très réussies.
Son premier voyage au Maroc date de 1866, mais le peintre exerce peu son art et préfère faire partie de la délégation officielle.
En 1875, il est en Égypte, et descend le Nil avec I'explorateur Mariette. Chaque année, il va en Orient ou en Algérie et rapporte des tableaux.
À la fin de sa vie, Charles Landelle encouragea la réalisation à Laval d'un musée de peinture qu'il inaugura en 1895, au faîte de sa gloire, aux côtés du président de la République : c'est l'actuel musée des Sciences.
Il meurt sans histoire, et sans descendance en 1908 à Paris. À sa mort, il possède des propriétés foncières, des villas, un hôtel à Paris. Le tout avec du beau mobilier, et des tapisseries.
J.M.L
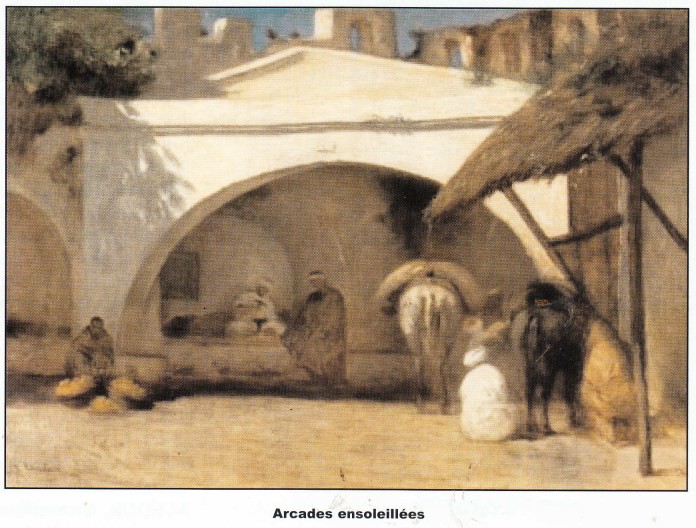
|
|
PHOTOS de MALTE
Envois de M. Marc Donato
|
Souvenirs pour les descendants de Maltais
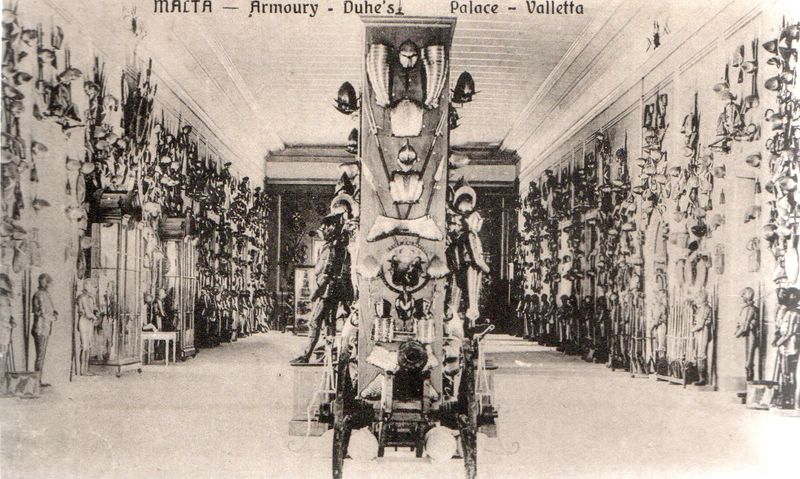
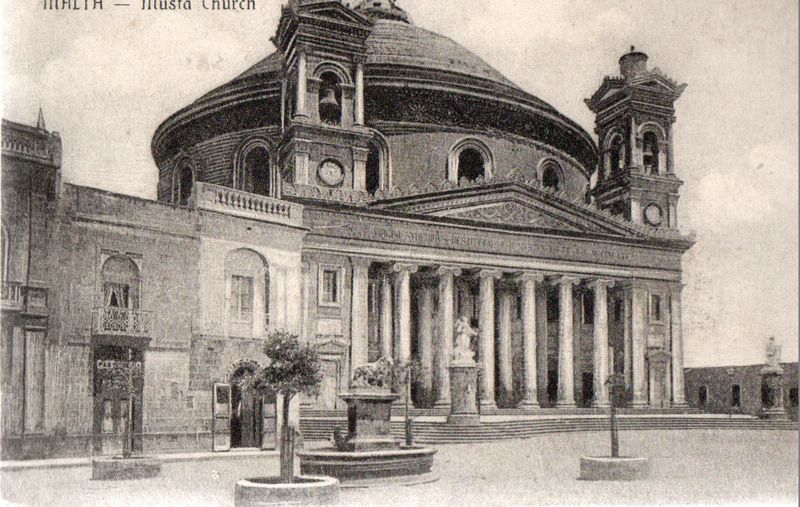
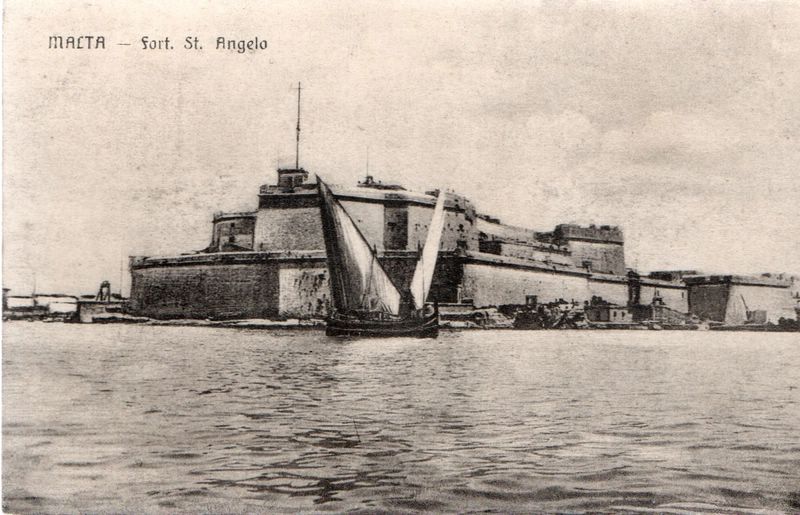

|
|
On me dit qu’aujourd’hui « je suis d’humeur de chien » ;
Et pourquoi pas de chat ? De loup ? Ou de lapin ?
Et quelle sorte de chien ? De molosse, de roquet ?
De ce type d’injure, il vaut mieux se moquer,
Sans prendre pour autant des airs de chien battu…
Et si les chiens aboient, passons, n’en parlons plus !
« Un chien vaut deux gendarmes », disait-on dans le temps,
Le temps où les gendarmes faisaient peur aux enfants…
C’est en chasseurs de drogue qu’aujourd’hui, la police,
Utilise des chiens sensibles au moindre indice.
Le « caractère de chien », alors n’est plus de mise
Et de « l’ami de l’homme », on commente les prises…
Et si, plus justement, l’homme était, à l’inverse,
« Meilleur ami du chien » ? Tout en bout de la laisse,
Le chien promène son maître et surveille ses pas.
Il sait le lui rappeler pour qu’il ne l’oublie pas ;
Même si certains jours, il fait si mauvais temps
« Qu’à mettre un chien dehors », ce n’est pas le moment.
Compagnon des humains, chien dévoué et fidèle,
Ton regard éclaire l’ombre et réchauffe notre ciel.
Sous l’éclat de la lune ou l’ardeur du soleil,
Tu veilles sans te lasser, cœur vaillant sans pareil.
Ton museau cherche l’âme pour consoler la peine
Et ton regard comprend sans qu’une voix le mène.
Que ce soit un terrier, un mâtin, un cabot,
Un clébard, un terrier, un basset, un corniaud,
Un bouledogue, un caniche, un beagle, un berger,
Un teckel, un carlin, tous nous sont attachés.
Chiens couchants, chiens courants, chiens d’arrêt, chiens de chasse
Se donnent « un mal de chien » pour bien tenir leur place.
Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage
Mais au dernier moment, n’en a plus le courage.
Notre chien croit en nous, on est un Dieu pour lui.
Si certains sont « athées », c’est que l’on a failli.
Tel maître éduque tel chien, le fait à son image :
Certains créent des molosses ; d’autres de grands mariages…
Jacques Grieu
|
| |
RÉORGANISATION EN ALGÉRIE.
Gallica : Revue d’orient, 1854-2 ; pages 319-319
|
DE LA JUSTICE MUSULMANE
Un décret impérial du 1er octobre vient de réorganiser la justice musulmane en Algérie.
Dans un rapport adressé à l'empereur, le maréchal ministre de la guerre expose ainsi les principes qui ont dirigé le gouvernement dès les premiers temps de la conquête :
« L'administration de la justice distributive, ce premier besoin des peuples, est liée, dans les pays musulmans, d'une manière plus étroite que chez les nations de l'occident, à la constitution de la société elle-même. Aujourd'hui encore, malgré les diverses phases traversées par les populations arabes depuis treize siècles, le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir civil puisent leur consécration dans un même livre, le Coran.
« Lorsqu'en 1830 la France prit possession de l'Algérie, elle se trouva en présence de ce livre, code religieux et civil à la fois des 3 millions de sujets que la conquête nous donnait. Dès le premier jour, sous l'inspiration d'un sentiment élevé de tolérance, elle comprit la nécessité de ne pas toucher à une législation cimentée si fortement dans les mœurs et les croyances, qu'on ne pouvait tenter de la modifier sans porter atteinte au dogme et aux pratiques les plus essentielles du culte.
« Les tribunaux musulmans furent donc maintenus avec la juridiction civile et criminelle qu'ils avaient avant la conquête.
« Mais on ne tarda pas à reconnaître les graves dangers qu'il y avait â laisser s'exercer en dehors de notre action la justice criminelle, qui est une des plus importantes prérogatives de la souveraineté. Un premier arrêté, du 16 août 1832, soumit les jugements correctionnels des kadis à l'appel devant la cour de justice, et les jugements criminels à l'appel devant le conseil d'administration. Après une expérience de plusieurs années, il fut démontré que nous ne pouvions nous contenter de surveiller et de réviser les actes de la justice musulmane au criminel; un progrès plus décisif fut accompli, et l'ordonnance du 28 février 1841 attribua aux tribunaux français la connaissance exclusive des crimes, délits et contraventions prévus par le Code pénal.
« La même ordonnance apporta une autre dérogation à l'état de choses antérieur ; elle soumit à l'appel (levant nos tribunaux les jugements en matière civile rendus par les kadis
Sur ce dernier objet, on dépassa le but.
« Il est facile de concevoir, en effet, qu'étrangers à la langue, aux mœurs, à la législation arabes, notre surveillance sur les magistrats indigènes était à peu près illusoire. Plusieurs fois ils avaient profité de cette situation, soit pour dresser des actes irréguliers, soit pour détourner des dépôts, soit pour rendre des jugements contraires à tout principe d'équité.
« On crut trouver un remède à ces abus en ouvrant aux parties, en matière civile, l'appel devant la cour. Mais le résultat ne répondit pas à ce qu'on attendait.
« Combien de fois, en effet, n'a-t-on pas vu, surtout dans les localités éloignées du chef-lieu de la cour d'appel, des hommes riches condamnés par le kadi et par le medjlès amener à une composition arbitraire la partie adverse plus pauvre, en la menaçant d'un pourvoi et en lui faisant entrevoir les dépenses qu'entraîneraient le volage, un séjour prolongé à Alger, et les nombreuses formalités de la juridiction française !
« On se trompa donc; car, ce qu'il importait d'obtenir, c'était, non pas la substitution de nos tribunaux aux tribunaux indigènes, mais la moralisation de ces derniers par le choix de magistrats probes et éclairés, et par une surveillance constante et efficace. »
Le ministre explique ensuite et que l'expérience a fait connaître et comment il a été amené à proposer un ensemble de mesures qui se trouvent réunies dans le décret que l'empereur vient de signer, et que M. le maréchal Vaillant résume ainsi
Le décret que je soumets à Votre Majesté se divise en trois livres qui traitent, l'un de la justice, l'autre du conseil de jurisprudence musulmane, le troisième, enfin, de l'administration judiciaire. Indépendamment de ces trois livres, un titre préliminaire résume les dispositions de principe qui forment les bases du système d'organisation de la justice musulmane, formulées dans le reste du projet. Il détermine Les limites de la compétence générale de la justice musulmane;
Les règles d'après lesquelles la justice doit être administrée
La division du territoire en circonscriptions judiciaires Musulmanes ;
L'autorité dont relève la justice indigène.
Le titre 1er du livre 1er constitue la justice musulmane à ses divers degrés.
Il dispose que le territoire de l'Algérie tout entier sera divisé, par arrêté du gouverneur général, en circonscriptions judiciaires formant le ressort d'autant de tribunaux de kadis ; un certain nombre de ces circonscriptions constituera le ressort du medjlès ou tribunal d'appel.
Le titre Il règle la composition des tribunaux des kadis, ainsi que celle des medjidiehs.
Les kadis des chefs-lieux de divisions et de subdivisions, de préfectures et de sous-préfectures, les membres des medjidiehs établis dans ces mêmes localités sont â la nomination du ministre de la guerre. Le gouverneur général pourvoit directement à la nomination des kadis et des membres des medjlès des autres résidences.
Le titre Il prévoit comment doivent s'opérer les remplacements provisoires en cas de décès, d'absence ou d'empêchement; il laisse, en cas d'urgence, au gouverneur général le droit de suspendre les kadis et les membres des medjlès qui ne sont pas à sa nomination.
L'un des titres les plus importants du projet est le titre III, qui fixe la compétence des tribunaux musulmans.
Il dispose que lés kadis jugent en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 fr., ou lorsque le litige ne porte pas sur une question d'État.
Dans le cas contraire, les parties peuvent attaquer le jugement des kadis devant le medjlès de la circonscription, qui prononce souverainement.
Au premier degré, le kadi ; au deuxième degré de juridiction, le medjlès ; plus d'appel des décisions du medjlès devant la cour ; séparation complète des deux justices.
Par décret du 21 septembre, il est créé, dans la plaine des Andalouses, arrondissement d'Oran, un centre de population qui prendra le nom de Bousier, et qui, indépendamment d'une population de familles européennes, comprendra deux annexes, savoir : un hameau de cinq familles européennes, au lieu dit les Figuiers, et un hameau arabe de trente-six feux.
Un territoire agricole de 3,960 hectares 6 ares 20 centiares est affecté à ce centre de population.
L'ensemble du commerce de l'Algérie en 1853 se résume ainsi :
Valeur des marchandises importées. 125,000,000 fr.
Valeur des marchandises exportées. 35,000,000
Total 160,001,000 fr.
Montant des droits acquittés.
Province d'Alger 2,054,380 fr.
Id. d'Oran 1,350,368
Id. de Constantine 1,428,017
Total. . . . 4,832,765 fr.
On ne lira pas sans intérêt les renseignements suivants qui précédent un décret portant concession de terres en Algérie. C'est un historique qui peut donner une idée de ce que peut produire un plan de colonisation bien suivi :
Un décret du 12 avril 1852 a octroyé à M. Bonfort, négociant à Oran, une concession de 1,480 hectares, entre Bredia et Temsalmet, sur la route d'Oran à Tlemcen. Cette concession a été, faite, à la charge par M. Bonfort:
1° de bâtir une bergerie modèle dans un délai de dix-huit mois, et d'y entretenir un troupeau d'au moins 1,000 brebis,
2° de mettre, pendant quatre ans, 15 béliers mérinos à la disposition de l'administration, pour les croisements qu'elle jugerait utile d'opérer avec les brebis des colons et des indigènes;
3° de donner, dans le même délai de quatre ans, à la totalité de l'immeuble un genre d'exploitation en rapport avec la qualité du sol et la nature de l'entreprise.
Très-peu de temps après sa mise en possession, M. Bonfort avait ensemencé 128 hectares en coton, tabac, blé, orge, pommes de terre, lin, cochenille et pavots. Il avait établi des constructions d'une valeur de 31,000 fr. Il possédait 1,050 brebis indigènes, 28 brebis mérinos, 14 béliers mérinos, etc. Il avait planté 7,000 arbres. Enfin, il avait très-.productivement dépensé une somme de plus de 80,000 fr.
Une nouvelle concession de 250 hectares situés sur le territoire de Bredia vient d'être faite de nouveau à M. Bonfort, aux conditions suivantes :
1° le paiement au domaine de l'Etat d'une rente annuelle et perpétuelle de 15 centimes par hectare
2° l'établissement d'une bergerie de 500 moutons, comme annexe de la bergerie de Temsalmet;
3° la création de prairies partout où la terre et l'eau le permettront, et la mise en bon état d'entretien et de production des prairies déjà existantes.
Un délai de cinq ans est accordé à M. Bonfort pour l'exécution de ces travaux.
|
|
MINISTRE de l’ALGERIE 1987
(Envoyé par M. C. Fretat) pages 84-104
|
|
LA COMMISSION PERMANENTE DE SAUVEGARDE DES DROITS
ET LIBERTES INDIVIDUELLES
Sa mission.
Sur la proposition du ministre résidant en Algérie, du ministre de la défense nationale et du secrétaire d'Etat aux Forces armées, le gouvernement a décidé, le 5 avril 1957, de créer, auprès du ministre résidant en Algérie, une commission permanente de sauvegarde des droits et libertés individuels. Cette commission sera consultée chaque fois qu'un fait pouvant apparaître comme un abus des forces de pacification ou de fonctionnaires d'autorité viendra à être connu des autorités responsables ; elle pourra également donner spontanément son avis sur des faits de cette nature, mais n'aura pas à connaître seulement de I'éventuelle réalité des abus signalés, mais aussi du caractère calomnieux ou sciemment exagéré de certaines informations. A cette fin, elle pourra entendre tous ceux qui ont porté ou qui porteront des accusations contre I'Armée ou l'Administration civile et les inviter à préciser leurs accusations et à en fournir la preuve.
La commission devra dans tous les cas être informée de la suite donnée à ses avis et des conclusions des enquêtes ou informations qui en résulteront.
Enfin, c'est le président du Conseil des ministres qui est chargé de fixer la composition de cette commission et d'en désigner les membres qui doivent être choisis parmi des personnalités connues pour leur autorité morale incontestable.
Sa raison d'être.
Cette création répond au souci de prévenir des excès qui pourraient être commis par des membres des forces de pacification ou par des représentants de l'Administration dans le cadre de I'action de maintien de l'ordre public. Si l'hypothèse de tels excès ne peut sans doute être totalement exclue à priori, les exemples qui en ont été donnés ne peuvent constituer que de rares exceptions. Au demeurant, la création de cette commission s'inscrit dans la logique des instructions dictées à I'Armée par le gouvernement et doit en faire assurer le respect.
C'est pourquoi le gouvernement a décidé de tout mettre en œuvre pour que la vérité puisse être rapidement établie sur les faits réels ou supposés et que soit décelé et châtié tout manquement individuel à la politique définie par le gouvernement en même temps qu'enrayée la campagne de dénigrement qui fait le plus grand tort à l'Armée et à la France.
RÉFORMES POTITIQUES
Un statut dépassé.
Préparation de l'avenir.
La réforme communale.
Les délégations spéciales.
Un Statut dépassé
Un siècle de présence française avait donné à I'Algérie un statut original, construit progressivement, transformé graduellement à mesure que la civilisation européenne pénétrait la population autochtone. La dernière étape, marquée par la loi de 1947, était en 1956 largement dépassée. D'autre part, en raison des circonstances particulières créées par la rébellion, l'état d'urgence avait été déclaré sur le territoire de l'Algérie pour une durée de six mois (loi du 3 avril 1955) et prorogé pour une période analogue le 7 aout 1955. Mais l'état d'urgence s'est trouvé de plein droit abrogé (loi du 5 avril 1955) par la dissolution de l'Assemblée Nationale (décembre 1955).
Préparation de l’avenir.
C'est pourquoi les circonstances politiques ont amené le gouvernement à doter l'Algérie d'un régime provisoire dont il est difficile de prévoir la durée et, en conséquence, à suspendre l'application de certains articles du statut de I'Algérie, incapable de répondre à la situation nouvelle, et à concentrer tous les pouvoirs dans les mains du gouvernement ou de ses représentants. Les mesures suivantes répondent à cet objectif :
a) La réorganisation des institutions administratives est retirée au Parlement et à l'Assemblée algérienne et confiée au gouvernement (loi du 16 mars 1956) ;
b) Les fonctions de Gouverneur général sont confiées à un membre du gouvernement (décret du 15 février 1956) ;
c) L'Assemblée algérienne est dissoute (décret du 12 avril 1956) et ses pouvoirs transférés au ministre résidant.
Le statut de 1947 étant ainsi pratiquement suspendu, il s'agissait de jeter les fondements des institutions politiques de demain. C'est à l'échelon le plus bas, c'est-à-dire à celui de la commune, qu'il convenait de préparer d'abord l'assise de ces institutions.
La réforme Communale.
Dès sa déclaration d'investiture, M. Guy Mollet, Président du Conseil, avait annoncé son intention d'entreprendre en Algérie une importante réforme communale destinée à :
- permettre à la population musulmane de participer effectivement et directement à la gestion de ses intérêts ;
- promouvoir Ies élites nouvelles de l'Algérie de demain ;
- reprendre, à propos des tâches communales, le dialogue parfois interrompu ;
Le décret du 28 juin 1956 prononçait la suppression de toutes les communes mixtes. Conformément aux instructions impératives du ministre résidant, l'application de cette réforme a été accélérée au maximum et, en sept mois à peine, 1071 communes nouvelles remplaçaient les 79 communes mixtes et les 158 centres municipaux.
D'autre part, 57 nouvelles unités étaient créées sur le territoire de communes « de plein exercice » trop étendues.
Il existe donc aujourd'hui, si l'on ajoute les 333 communes « de plein exercice », 1461 communes en Algérie qui jouissent, dans le cadre du droit commun français, d'une entière autonomie de gestion.
Les 333 conseils municipaux des communes de plein exercice avaient été élus sous l'empire de l'ordonnance du 7 mars 1944 qui prévoyait la division des électeurs en deux collèges : les trois cinquièmes de la représentation appartenant au premier collège, les deux cinquièmes restant, au deuxième collège.
Les délégations spéciales.
70 conseils municipaux de communes de plein exercice ont été dissous en vertu du décret du 11 décembre 1956. Ils ont été remplacés soit par des délégués spéciaux, soit par des délégations spéciales.
Innovation essentielle, ces dernières comprennent en nombre égal des Musulmans et des Européens.
D'autre part, dans les communes nouvelles créées par suite de la suppression des communes mixtes, 509 délégations spéciales, organes d'administration autonome, ont été installées. 330 d'entre elles sont présidées par un Musulman, 179 par un Européen. 80% de leurs membres sont des Musulmans.
Dans les communes où ces délégations n'ont pu être installées, 587 délégués spéciaux ont été désignés par les préfets. 150 d'entre eux ont été choisis parmi les habitants de ces communes et 97 sont Musulmans. Les autres, soit 437, ont été pris soit parmi des fonctionnaires civils, soit parmi des militaires, notamment des officiers S.A.S.
Au 1er juillet 1957, sur les 1130 nouvelles communes créées, 1096 étaient pourvues de délégations spéciales ou de délégués spéciaux et 34 restaient à pourvoir.
RÉFORMES ADMINISTRATIVES
Les S.A.S.:
Leurs objectifs.
Les S.A.U.
La réorganisation territoriale :
Huit départements nouveaux.
Installation des préfets.
Commissions administratives provisoires.
Nouveaux arrondissements.
Assemblées régionales provisoires.
La réforme de l'Administration centrale.
La réforme judiciaire :
Deux nouvelles cours d'appel,
Application de la réforme.
LES SECTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
La rébellion a trouvé un terrain d'élection dans les régions déshéritées qui étaient à la fois sous-équipées et sous-administrées.
C'est un fait d'évidence que les trois anciens départements d'Alger, de Constantine et d'Oran et les circonscriptions administratives qui les découpaient, étaient beaucoup trop étendus et trop peuplés pour qu'il fût possible aux pouvoirs publics d'intervenir en tous lieux avec l'efficacité souhaitable. Le gouvernement a donc été conduit à réorganiser profondément l'Administration en Algérie.
Leurs objectifs. Dès 1955, des Sections administratives spécialisées (S.A.S.) furent créées en vue de donner aux régions où la présence de la France n'avait jamais été une réalité profonde, un appareil administratif très souple, destiné à établir avant tout des contacts humains, et parfaitement adapté au particularisme des habitants des douars.
Installés au cœur même des territoires à pacifier, mêlés à la vie quotidienne des populations, les officiers des Affaires algériennes, qui les dirigent, pallient les insuffisances de I'Administration dans Ies domaines politique, économique et social. Dans I'accomplissement d'une mission aussi vaste, les plus larges initiatives leur sont laissées : ils administrent, ouvrent des chantiers, créent des routes et des pistes, assurent le ravitaillement et, par tous les moyens, viennent en aide à la population. Des médecins les assistent dans leur mission qui relève de l'apostolat et demande un dévouement proche de l'abnégation.
Au 1er janvier 1956, 180 S.A.S. étaient en place ou sur le point de l'être. Au 1er juillet 1957 fonctionnaient effectivement 451 S.A.S. ainsi réparties :
- 145 dans la région d'Alger ;
- 81 dans la région d'Oran ;
- 187 dans la région de Constantine ;
- 38 dans les Territoires du Sud.
135 S.A.S. supplémentaires sont sur le point d'être mises en place dans ces trois régions et les Territoires du Sud, ce qui en portera à 606 le nombre total.
Les S.A.U.
S'ajoutent aux S.A.S, les Sections administratives urbaines, ou S.A.U. qui jouent auprès des Musulmans des quartiers surpeuplés et des bidonvilles des grandes villes le même rôle que les S.A.S. dans les campagnes. On en comptait au 1er juin 1957, quatorze fonctionnant effectivement et six sur le point d'être implantées, d'autres créations étant en projet.
L'institution des S.A.S. et des S.A.U. rencontre d'énormes difficultés en ce qui concerne l'organisation matérielle, le recrutement et la formation des officiers ainsi que le recrutement de leurs auxiliaires : radio, interprètes, secrétaires comptables, moghaznis, etc... (La parution récente du statut de ces auxiliaires élimine une partie de ces difficultés).
LA RÉORGANISATION TERRITORIALE
Premier pas dans la voie d'une réorganisation des structures administratives de l'Algérie, puisque sa création a été décidée en 1955, le département de Bône a fini de recevoir ses divers éléments organiques en 1956 et a acquis son autonomie effective avec I'arrêté du 29 septembre 1956 qui a notamment fixé la date d'installation de son Conseil général. Ce dernier s'est, depuis, réuni normalement et a commencé à fonctionner dans la plénitude de ses attributions au cours de sa session d’octobre-novembre 1956 en votant le premier budget du département, celui de l'exercice 1957.
Huit départements nouveaux
Le décret du 28 juin 1956 a procédé à une profonde refonte des structures départementales de l'Algérie, plus conforme à ses divisions naturelles, en portant de 4 à 12 le nombre des départements.
Cette réforme devait permettre, d'une part, d'accroître la participation de la population à la gestion des intérêts locaux dont la centralisation, autour de quatre chefs-lieux de départements, ne correspondait plus aux nécessités de l'évolution en cours et, d'autre part, de faciliter I'exercice de la puissance publique par une large déconcentration.
Pour rendre plus effective cette déconcentration et pour mieux coordonner les divers facteurs d’action administrative et économique dans les nouveaux départements, il a paru nécessaire de confier aux préfets d'Alger, d'Oran et de Constantine les fonctions d'Inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire (I.G.A.M.E.).
Ces fonctions s'exercent dans le cadre régional des trois anciens départements d'Alger, d'Oran et de Constantine.
D'autre part, il était essentiel que cette réorganisation des unités départementales fût exécutée par paliers afin que la transition eut lieu sans heurt, mais aussi avec la plus grande diligence afin que ces nouvelles unités soient le plus rapidement possible en état de participer étroitement à l'action administrative et, en particulier, à l'application des diverses réformes en cours dont la principale, celle du régime communal, nécessitait déjà à elle seule, la réalisation immédiate d'une déconcentration effective.
Dans cet esprit, le 11 décembre 1956 est intervenu un décret qui a fixé les premières conditions d'application du décret du 28 juin. II a prévu la création de Commissions administratives provisoires à la tête des douze nouveaux départements. Ces Commissions doivent se substituer aux anciens Conseils généraux d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Bône, en attendant que puissent avoir lieu les élections qui permettront l'installation définitive des nouvelles Assemblées départementales régulièrement constituées. Elles reçoivent donc pour mission d'exercer pendant cette période transitoire la plénitude des attributions reconnues par la loi aux Conseils généraux en Algérie. Leur composition respective reste à fixer par des arrêtés du Gouverneur général qui en désignera également les membres sur la base d'une représentation paritaire des deux communautés ethniques.
De son côté, le décret du 31 janvier 1957 a organisé l'entrée en fonctionnement en tant que personnes morales de droit public des nouveaux départements, en fixant le cadre dans lequel les chefs de ces unités recevront par étapes la plénitude de leurs attributions, au titre de représentants de leur département, ainsi que les conditions transitoires de fonctionnement soit des nouveaux Conseils généraux, soit des commissions administratives prévues par le décret du 11 décembre 1946.
Les nouveaux arrondissements.
Malgré les créations d'arrondissements opérées entre aout 1955 et juin 1956 et qui en portaient le nombre à 37, il est encore apparu nécessaire de procéder à des créations nouvelles. En effet, les 37 arrondissements existants étaient beaucoup trop étendus et groupaient une population trop importante pour qu'une administration efficace pût s'exercer ; d'autant que la réforme communale exigeait du sous-préfet un rôle de conseiller et de guide.
Le décret du 20 mai 1957 a porté à 71 le nombre des arrondissements, soit 34 créations nouvelles.
Installation des Préfets
Animé par le souci d'assurer le plus rapidement possible aux nouveaux départements une vie nouvelle en les dotant d'organismes provisoires permettant aux populations d'exprimer leur personnalité, le ministre résidant s'est attaché à hâter la réalisation du premier stade du programme d'action concrétisé par ces deux textes.
Ainsi, sous I'autorité des trois inspecteurs généraux de l'Administration en mission extraordinaire, dès le 16 aout 1956 commençait l'installation des nouveaux préfets dans leurs fonctions de dépositaires de l'autorité de I'Etat, à la tête des départements nouvellement créés. Le premier en date était celui du département de Tizi-Ouzou ; puis, le 1er octobre, le préfet du département de Batna prenait à son tour possession de son poste. Enfin, étaient successivement mis en place : le 16 novembre 1956, le préfet du département de Tlemcen ; le 1er octobre, ceux de Tiaret et Médéa ; les 5 et 11 décembre, ceux d'Orléansville et de Sétif, et, le 1er janvier 1957, celui de Mostaganem.
Commissions administratives provisoires
Ce premier stade à peine achevé, des instructions du ministre ont invité les inspecteurs généraux et les préfets d’Algérie à préparer sans tarder l’organisation et la mise à jour de chaque commission administrative. Des circulaires des 17 janvier et 11 mars 1957, en particulier, prévoient dans le détail les conditions dans lesquelles des membres de ces commissions pourront être choisis en fonction de leur valeur, de leur compétence, de leur caractère représentatif.
Dans I'esprit du ministre, ces désignations ne doivent pas porter atteinte aux droits des conseillers généraux actuellement en exercice puisque ceux-ci sont, de droit, membres des Commissions. Mais hormis ces cas, elles devront essentiellement assurer une très large représentation des populations musulmanes et le principe de la représentation paritaire est lui-même assoupli pour permettre de tenir compte éventuellement des trop grandes disproportions qui peuvent exister dans certains départements entre les différents groupes ethniques. C'est ainsi qu’une majorité musulmane a été admise pour certaines d'entre elles.
Comme d'autre part le nombre des membres de ces organismes n'est pas fixé par une réglementation stricte, la composition n’en est pas nécessairement identique à celle des futurs Conseils généraux ; elle doit seulement ne pas prêter à la moindre critique et assurer à ces Commissions un fonctionnement normal.
Il ne peut plus faire de doute aujourd'hui que cette institution constitue une réalité vivante et qu'elle est en mesure de répondre à la double exigence qui en fait tout l'intérêt et la valeur : satisfaire à un souci d'ordre administratif et rétablir un contact et un courant d'estime réciproque entre les deux éléments de la population.
Les Assemblées régionales provisoires.
Le décret du 31 janvier 1957 déterminait les conditions d’application du décret du 28 juin 1956 relatif à la réorganisation territoriale de l’Algérie. Ce décret prévoyait notamment, en vue du vote des modificatifs des budgets départementaux pour l'année 1957, la réunion des assemblées départementales élues par les conseils généraux ou par les commissions administratives des nouveaux départements. Convoquées dans le cadre de leur région par les Inspecteurs généraux de I'administration en mission extraordinaire, préfets d'Alger, d'Oran et de Constantine, ces assemblées régionales provisoires, qui ont siégé au mois de mai 1957, préfigurent dans les faits les assemblées territoriales décentralisées et ont permis de dégager la personnalité de chaque territoire.
L'installation de ces trois assemblées a donné lieu à des cérémonies où s'est affirmé le désir de collaboration des différents groupes ethniques de la population.
Assemblée régionale provisoire d'Alger
Le 17 mai 1957, l'assemblée régionale provisoire d'Alger, formée des commissions départementales des quatre départements d'Alger, du Titteri, de Grande Kabylie et du Cheliff a élu son bureau:
Président : M. Hector BURKHARDT.
1" vice-président : M. MOULAI Mostefa Mohamed.
2" vice-président : M. Louis ARBES.
3" vice-président : M. Ben HAMDI Mohamed.
Secrétaires : M. Ange BISGAMBIGLIA et M. AZEM Ouali.
Avant d'entreprendre l'examen des travaux de la session, le nouveau président souligna le caractère technique de l'assemblée régionale et exprima l'espoir de voir ses travaux marqués par le climat nouveau d'une Algérie « rajeunie ».
« Derrière les chiffres du budget il y a des hommes, et notre préoccupation majeure doit être de faire de l'humain. Il nous faut du nouveau, certes, mais que l'on nous laisse régler entre nous les problèmes économiques et sociaux qui sont les nôtres et que nous n'avons pas peur de débattre. II n'y a ici que des Français, que des frères. »
Assemblée régionale provisoire de Constantine.
L'installation de l'assemblée régionale de l’est algérien qui a eu lieu à Constantine le 12 mai 1957, a revêtu un caractère particulièrement solennel. L'Inspecteur général préfet de Constantine, entouré des préfets des départements de Bône, Batna et Sétif, présidait cette séance inaugurale au cours de laquelle il fut procédé à l'élection du bureau de cette nouvelle assemblée.
Président : M. Abdelkader BARAKROK.
1er vice-président : M. LAVIE.
2ème vice-président : M. SAHLI.
3ème vice-président : M. MOREL.
Secrétaires : Mme LLEU et Mlle AMARA.
Dans un discours d'une remarquable sûreté de jugement, le président Barakrok brossa un tableau de la situation algérienne et des solutions qui permettront de l'engager dans les voies du renouveau et de l'espoir.
Extraits du discours du Président BARAKROK.
« Je voudrais que cette séance qui dépasse le cadre de ma modeste personne soit placée sous la présidence, sans doute irréelle, mais non moins tangible du renouveau et du bonheur des masses algériennes, sous la présidence aussi de la grande Démocratie française et de l'union des cœurs et des esprit. »
Il est aussi un hommage que le président Barakrok entend rendre, au début de son discours :
« Ici, comme ailleurs, dit-il, et chacun de vous en est bien pénétré, il se trouve des hommes qui ont toute notre confiance et qui luttent jour après jour pour parvenir au but qu'ils se sont assigné : une Algérie heureuse et fraternelle. Qu'il s'agisse à Paris du président Guy Mollet et de son équipe ministérielle, à Alger du ministre résidant Robert Lacoste dont chacun de nous connaît la farouche volonté de réussir dans la tâche combien délicate qui lui a été confiée, plus près de nous de M., I'Inspecteur général Papon et des préfets de la région de Constantine qui l'entourent, tous n'ont qu’un désir, bâtir sur les grandeurs du passé, dans un renouveau que nous souhaitons tous. »
Puis, saluant tout particulièrement la présence de Mlle Amara, la première Française-Musulmane qui siège dans une assemblée délibérante, le président Barakrok poursuit :
« Sa présence parmi nous est à mes yeux plus qu'une promesse, elle est un symbole de notre Algérie future, cette Algérie où un développement humain maximum est promis à tous citoyens et citoyennes dans le respect d'une égalité absolue de chance. »
C'est le problème de la femme musulmane que M. Barakrok entend évoquer car, dit-il, « Comme partout ailleurs, le problème de la femme participe naturellement de celui de l'homme mais il a un aspect qui lui est propre, la femme est un pôle de l'humanité dont l'autre est représenté par l'homme et si l'un disparaît, l'autre fatalement perd sa signification.
« Pour les partisans, je dirai peut-être mieux, les adeptes de l'évolution qui considèrent les choses non pas dans leur état actuel mais dans l'avenir, la femme musulmane pose le point d'interrogation de l'évolution de notre peuple.
« La femme musulmane dans la vie publique doit être présente car le ferment féminin nous est nécessaire, indispensable même, car la femme oriente toutes les dispositions évolutives d'un peuple qui, dans l'inconscient de l'homme, dépendent de son empire.
« Il est temps que ce problème figure à la place d'honneur des programmes futurs, il est temps que l'élite et les femmes musulmanes elles-mêmes nous désignent la manière de les préparer à leur mission. »
Mais le problème algérien implique encore d'autres solutions. M. Barakrok entend les exposer avec franchise :
« Nous ne devons jamais oublier, dit-il, que le problème algérien n'est pas une question de confession, mais de civilisation avant d'être autre chose. Que l'on soit chrétien, musulman, peu importe ! Ces deux formes de civilisation ont un dénominateur commun. Il faut qu'il en soit ainsi en Algérie, comme partout ailleurs, pour le bien de tous. Si nous voulons arriver à nous entendre, nous ne devons faire aucune différence entre ces deux tendances de la civilisation, leurs rapports devront être réglés par des principes qui tiennent compte avant tout de la loi morale. C'est donc à I'amitié et à la compréhension que nous ferons appel en toutes circonstances, car vous en êtes convaincus comme moi, elles sont génératrices de miracles. « La raison sans amour ne suffit pas. » En cela, notre attitude peut nous être utilement dictée par nos anciens. Saint-Exupéry n'a-t-il pas dit : « La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes ».
Eh bien ! nous devons obtenir de tous la collaboration des forces intellectuelles et morales, mais aussi I'adhésion des cœurs. Espoir et optimisme, désespoir et pessimisme, telle est la double conclusion à laquelle se livrent les penseurs, ou simplement les hommes tout court.
Quand ceux-ci ont à construire ensemble un avenir meilleur, il est hors de doute que cette double dualité leur serve de base, car l'optimisme n'a pas de frein quand il agit. Le réveil politique des populations musulmanes est un fait.»
En passant, le président Barakrok tient à exprimer un « hommage émerveillé et ému à la France à travers ses plus dignes représentants : les éducateurs du peuple ».
« La France, dit-il, a semé en Algérie une élite à lever. Elle a, comme toutes les élites du monde et de manière naturelle, ses exigences de dignité d'abord, d'emploi ensuite et de rôle à jouer. J'entends que tout cela se frange d'impatience et quand il s'agit surtout d'impatience de bon aloi, il faut savoir la constater et l'accepter ensuite.
Eh bien ! quel accueil est-il fait, ou de manière publique, ou de manière privée, à cette élite montante ? Cette interrogation nous mène insensiblement au problème des rapports humains qui se posent avec acuité et qu'un effort réciproque de sincérité et de bonne volonté doit d'abord résoudre avant toute chose. »
C'est ce problème humain qui apparaît à M. Barakrok comme le préalable, la condition fondamentale à toute tentative constructive.
« C'est que nous ne cesserons jamais de rester ces hommes qui, a-t-on dit, « sont condamnés à vivre ensemble », acceptent véritablement de vivre ensemble en hommes, non pas les uns à côté des autres, non pas et encore moins les uns au-dessus des autres, mais les uns avec les autres, dans la reconnaissance mutuelle de leur commune dignité d'homme, dans la participation réelle, sur un plan d'égalité effective, à la gestion de leurs intérêts communs. La France de 1789 a fait la révolution pour le plus grand bien de I'humanité. Nous attendons d'elle cette preuve rénovée d'un amour sacré de la liberté et de l'égalité, enfin une politique conforme à ses traditions et à ses principes. Elle peut se grandir encore en resserrant les liens qui ont lié tous les peuples à elle et les lieront davantage, j’en suis certain. Conforme à sa tradition dans les moments difficiles qu'elle a traversé, la France saura trouver pour l'Algérie les solutions qui étonneront le monde. II est impossible qu'il en soit autrement. Nous souvenant des enseignements prestigieux de l'école publique française, nous voulons retenir surtout ces formes impérissables qui doivent régler les relations des citoyens d'un même pays. »
L'heure du choix.
« En dehors des passions stériles et malgré la tourmente, nous apporterons, en hommes de bonne volonté, cette participation à l'édification de la cité commune, cette cité que nous voulons dans sa diversité, agréable à tous. Et comment peut-il en être autrement lorsque nous examinons avec sérénité le déchaînement des passions inhumaines, avec le cortège de souffrance, de malheurs et de misères, l'affreuse nuit dans laquelle des esprits rétrogrades tentent de plonger l'Algérie, alors que partout ailleurs tout l'appelle à des lendemains ensoleillés.
Dans cette lutte contre la nuit, dans cette lutte pour la vie contre la mort, notre choix est fait parce que nous sommes des hommes ennoblis par l'enseignement de nos ancêtres et éclairés par une spiritualité faite à la mesure de l'homme qui reconnaît en son semblable la créature de Dieu en tous points son égal avec les mêmes droits et aussi les mêmes devoirs. »
La construction de l'édifice.
Là est la pierre angulaire de l'édifice, déclara M. Barakrok, « cet édifice harmonieux de l'Algérie nouvelle qui s'édifie sous nos yeux, celle que nous n'avons cessé d'appeler de tous nos vœux, une Algérie démocratique, sociale, ouverte à un avenir de progrès. Dans le domaine économique, des promesses sont certaines et ouvrent sur des horizons que nous pressentons chaque jour davantage.
« Dans le domaine social, des réformes apportées complètent et amplifient celles déjà acquises et placent l'Algérie à l'avant-garde de plus d'un pays jeune et lui permettent de supporter à son avantage la comparaison avec plusieurs contrées de tous les continents et cela malgré le panneau de l'indépendance qu'elles arborent sur leur fronton récemment blanchi. »
L'heure de la vérité.
Et après avoir rappelé la position du gouvernement de la République, subordonnée, en fin de compte, à une libre discussion des différents éléments de la population, des représentants librement désignés, le président Barakrok poursuit :
« L'arbitrage de la France demeurant nécessaire comme les intérêts supérieurs de la Nation seront nécessairement sauvegardés. N'est-ce point là une détermination souveraine et une solution juste et démocratique alors même que tous les habitants de I'Algérie bénéficieront de droits égaux et sont astreints aux même devoirs. On demeure confondu devant tant de raison et devant tant d’incompréhension.
« Comment se peut-il que des gens sensés, en possession de toute leur raison, puissent continuer à se diviser, alors que tout les appelle à l'union ? comment se peut-il que des personnes, encore puissent penser raisonnablement au maintien ou au retour pur et simple d’un statu-quo que tout dénonce ?
« Comment se peut-il que des personnes raisonnables puissent s'imaginer un seul instant que des Européens installés parmi nous depuis si longtemps, respirant depuis des générations l’Algérie de tous leurs pores, soient contraints un jour à quitter cette terre qu’ils ont fécondée, qu'ils aiment et pour laquelle ils sont disposés, eux aussi, à mourir. Les uns et les autres, nous sommes sur une terre qui nous appartient à tous. Alors, pourquoi ce désaccord, pourquoi ces tueries, pourquoi ces larmes et ce sang et qu'avons-nous pu faire pour attirer sur nos têtes une telle calamité. Tout simplement parce que nous n'avons pas su nous entendre et lorsque nous avons parlé, c’était avec des restrictions mentales dans I'esprit des uns et des autres.
Et l’Algérie, tel un tonneau de vin fin qui, ballotté dans le courant des passions, s'est vu contaminé, dénaturé par la lie. L'heure de la vérité a sonné. Il ne sera pas dit que nous aurons manqué de courage. Nous possédons en nous-mêmes assez de ressources morales et intellectuelles pour faire face à l'orage. Nous dénonçons la violence d’où qu’elle vienne. Nous nous inclinons devant ses victimes. Nous demandons le châtiment exemplaire de tous les coupables. Nous nous refusons à nous laisser enfermer dans le cycle infernal du terrorisme et du contre-terrorisme. Nous dénonçons cette lutte fratricide. Nous demandons la prise immédiate de mesures énergiques pour que force reste à la loi et à la justice, à elles seules. selon la tradition française, aucune discrimination d'ordre racial ou confessionnel ne saurait être tolérée et la sécurité de l'ensemble des habitants doit être assurée. »
Assemblée régionale d'Oranie.
C'est le 9 Mai 1957 qu’a eu lieu l’installation de l'Assemblée régionale d’Oranie groupant les représentants des départements d’Oran, Mostaganem, Tiaret et Tlemcen. M. Fouques-Duparc en fut élu président. MM. Ali Chekkal et Salado vice-présidents.
Au cours de cette séance inaugurale, M. Ali Chekkal, assassiné depuis par le F.L.N. à Paris, affirma une fois de plus son attachement à la France et son dévouement à la politique de réformes poursuivie en Algérie. Prenant la parole après M. Fouques-Duparc, il déclara notamment :
« … Comme vous, je ne cesserai de défendre inlassablement les intérêts de nos coreligionnaires musulmans, pour lesquels je désire non seulement un standing de vie meilleur, mais encore leur accession aux postes, quels qu'ils soient, afin d'imprimer d'une façon définitive qu'il n'y a entre Musulmans français et Français d'origine que les mêmes sentiments de fraternité, d'humanité dans une égalité totale de droits et de devoir.
« Je poursuivrai de toutes mes forces l'épanouissement de ce critère qui sera le prélude de lendemains meilleurs pour le bonheur et la prospérité de tous !... »
Ces trois assemblées régionales qui sont maintenant une réalité tangible préfigurent dans les faits les assemblées territoriales décentralisées et ont permis au cours de leur première session de dégager la personnalité de chaque territoire. Ultérieurement, lorsque leurs devoirs et leurs responsabilités auront été définis, elles constitueront un des rouages essentiels de la vie des territoires de l'Algérie.
Une architecture logique, adaptée aux contingences de la vie locale s'élève, de proche en proche, assurée de l'adhésion et du concours des collectivités ethniques.
L'édifice ainsi construit affirme partout la coopération, à tous les niveaux des responsabilités publiques, des groupes autonomes de gestion et du pouvoir arbitral de la République.
RÉFORME DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Une déconcentration effective.
L'Administration de l'Algérie était, jusqu'à une date récente, caractérisée par un haut degré de concentration des attributions et des pouvoirs. Le Gouverneur Général prenait d'innombrables décisions particulières ; son Administration centrale gérait directement de nombreux services ; dans les cas ou les autorités locales conservaient une part d'initiative, celle-ci était trop souvent subordonnée à des instructions préalables de I'autorité centrale.
Le ministre de l'Algérie a véritablement innové en transférant aux I.G.A.M.E., aux préfets et parfois même aux sous-préfets une partie des attributions qu'il exerçait lui-même ou par l'intermédiaire de ses collaborateurs immédiats et, notamment, des directeurs de l'Administration centrale.
Désormais, par exemple, si tous les crédits destinés à pourvoir aux dépenses publiques continuent bien à figurer aux chapitres du budget de I'Algérie, pour des masses importantes d'entre eux, les actes essentiels de leur consommation sont accomplis par les autorités locales qui se bornent à rendre compte à l'Administration centrale.
C'est ainsi que le choix des pistes à construire, la fixation du montant des projets et leur mise au point technique, la conclusion des marchés de travaux publics et leur exécution, le paiement des dépenses enfin, ne dépendent plus que des I.G.A.M.E., des préfets et des chefs des services extérieurs au lieu de «remonter» à Alger pour décision ou pour approbation.
Ces autorités, qui sont plus près des besoins à satisfaire, sont en mesure d'agir plus vite et de réaliser chaque année une masse plus grande de ces « travaux d'urgence et de pacification » grâce auxquels de nombreux travailleurs, jusqu'ici sans emploi, perçoivent des salaires et améliorent leur condition.
Il est aisé de se rendre compte de I'ampleur d'une telle entreprise qui consiste à transférer d'Alger aux chefs-lieux des départements des attributions - donc les dossiers correspondants - et à faire gérer par les préfectures et les services extérieurs des crédits provenant de nombreux chapitres budgétaires.
Il faut agir avec discernement pour ne pas surcharger les autorités locales à un moment ou la mise en train des nouvelles préfectures est ralentie par la pénurie de personnel qualifié.
Depuis des mois, grâce à la compréhension de tous ceux qui abandonnent les attributions traditionnelles comme de ceux qui reçoivent des charges nouvelles -
Ces instructions de principe du ministre de l'Algérie entrent chaque jour dans les faits. Ainsi, l'Administration centrale du Gouvernement Général se consacrant aux seules tâches de direction, pourra étudier et prévoir pour que les autres autorités agissent plus vite et mieux. Elle conseillera et contrôlera au lieu de décider dans une infinité de cas particuliers.
Réduction des Directions du Gouvernement Général.
En vue de cette utilisation plus rationnelle des compétences techniques, le processus de déconcentration s'est accompagné, depuis un an, d'un processus complémentaire qui s'est déroulé, celui-là, au sein même de l'Administration centrale. Le nombre des Directions et services du Gouvernement Général ayant été ramené de 24 à 9, la constitution de ces « grandes unités administratives » doit permettre de lutter contre les effets d'un cloisonnement qui nuisait au plein emploi du personnel et qui développait les particularismes de service à service.
Si l'on ajoute que, déjà se concrétisent les attributions de cette nouvelle circonscription qu'est la « région » - chacune groupant 4 départements - et que bientôt aux grandes unités de l'Administration centrale correspondront des services régionaux placés sous I'autorité de I'I.G.A.M.E., on s'apercevra que, dans le silence et I'effort, naissent des institutions administratives susceptibles d'épouser les contours de n'importe quelles institutions politiques futures.
LA RÉFORME JUDICIAIRE
Deux nouvelles cours d'Appel.
Le souci de déconcentration et d'intensification de l'action des pouvoirs publics en Algérie, qui a conduit à multiplier les circonscriptions administratives, s’est également exprimé dans le domaine judiciaire puisque déjà, en 1955, il avait incité le législateur à reconsidérer l'organisation judiciaire de l'Algérie en décidant la création de deux Cours d'appel à Oran et à Constantine.
Dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui ont été accordés, le gouvernement a entendu poursuivre cette réorganisation et la première mesure prise dans ce sens a été le décret n° 56 633, du 28 juin 1956, destiné à assurer le fonctionnement des justices de paix d'Algérie. Depuis cette date, différentes autres réformes sont intervenues qu'il convient, ici, de rappeler brièvement.
La loi du 7 août 1955 avait découpé le territoire algérien en trois ressorts de cours d'appel et décidé la création des cours d’Oran et de Constantine, création qu'il appartenait au gouvernement de traduire le plus rapidement possible dans les faits.
Application de la réforme
Les modalités d'application de cette réforme ont été fixées par le décret du 8 septembre 1956 qui délimitait le ressort de chacune des Cours, en fixait les effectifs, organisait les compagnies, chambres et conseils régionaux et départementaux des officiers ministériels ou publics, enfin déterminait les modalités de transfert aux juridictions désormais compétentes, des procédures n cours.
Ce même texte a été complété par le décret du 18 octobre 1956 qui a précisé les modalités de transfert des procédures en cours.
Enfin, un décret du 28 septembre 1956 a fixé au 16 octobre 1956 la date d'application de la loi du 7 août 1956, date à laquelle les trois Cours d'appel ont effectivement commencé à fonctionner.
D'autres mesures ont souligné l'importance prise par certaines juridictions françaises et musulmanes à raison de l'augmentation du nombre des affaires qui leur sont soumises. C'est ainsi que :
1° En ce qui concerne les tribunaux de première instance, un décret du 15 novembre 1956 a procédé à une refonte de la répartition par classes de ces tribunaux ;
2° En ce qui concerne les juridictions musulmanes, un décret du 12 novembre 1956 a érigé certaines mahakmas malékites judiciaires annexes, en mahakmas principales, et crée autant de postes de cadis-juges.
Algérie 1957, cabinet du ministre de l’Algérie
|
|
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
|
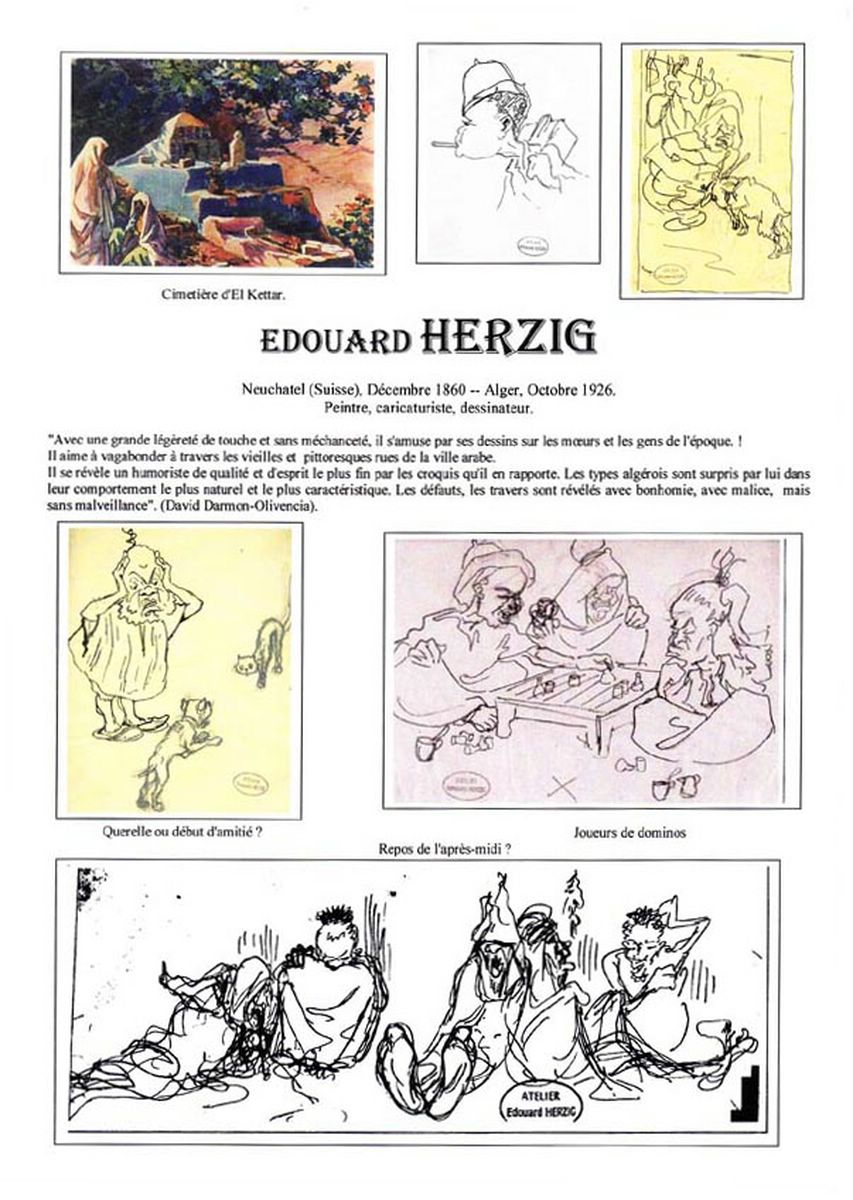 A SUIVRE
A SUIVRE |
|
PHOTOS de MALTE
Envois de M. Marc Donato
|
Souvenirs pour les descendants de Maltais
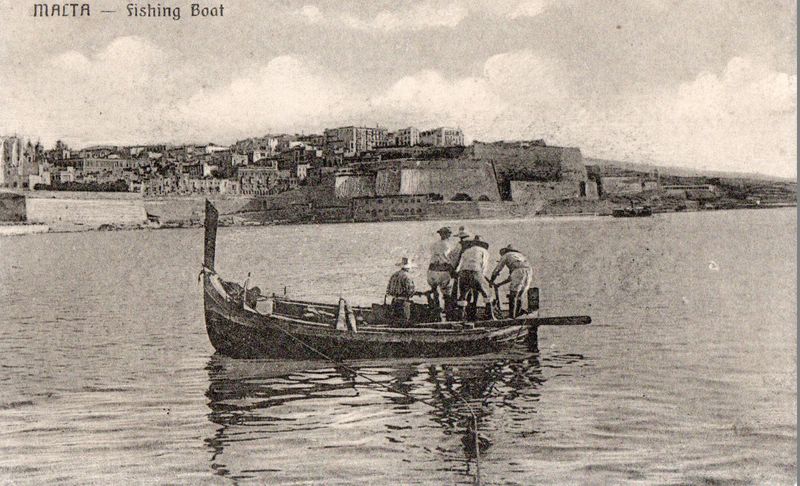
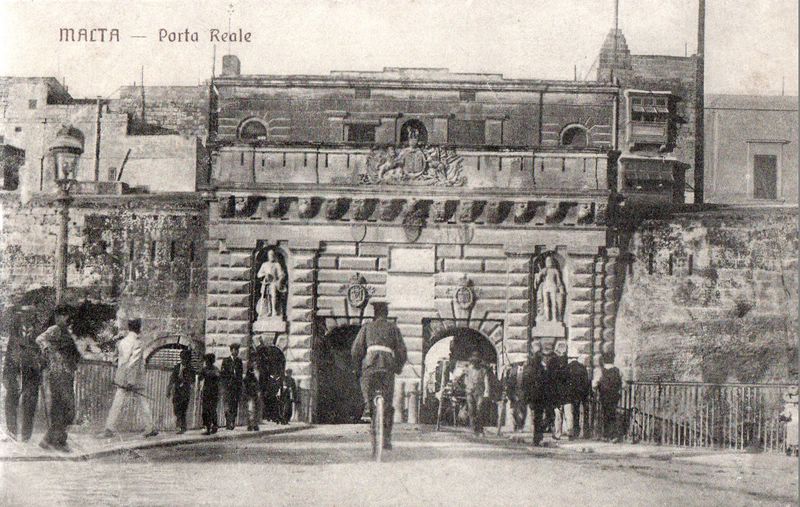


|
|
| CARDIOLOGIE
De Jacques Grieu
|
« Rodrigue, as-tu du cœur ? » demandait-on au Cid :
Du cœur, il en avait ! Un grand cœur, l’intrépide !
En faisant de bon cœur son devoir jusqu’au bout,
C’était du cœur au ventre ! Et pas de ventre mou !
De ce genre de cœur, l’époque n’en fait plus;
Pour le cœur à l’ouvrage, on est souvent déçu.
« Tout cochon a au cœur un homme qui sommeille » ,
Nous disent nos bons psys, prodigues en conseils.
D’autres disent l’inverse et la main sur le cœur,
Se le frappent alors en moralisateurs.
En « avoir le cœur net » ? Affaire de philosophes
Qui ont toujours à cœur le blâme ou l’apostrophe.
La mémoire du cœur est la reconnaissance
Et donc l’ingratitude en est la déficience.
« Le cœur a ses raisons que la raison ignore » :
Le cœur a-t-il raison quand il s’oppose au corps ?
Quand on vise le cœur, ça tombe à côté ;
Et l’on manque sa cible en n’ayant rien touché.
« Contre mauvaise chance, il nous faudrait bon cœur » :
La chose est vite dite et engage l’auteur.
Si le cœur vous en dit essayez d’en sourire,
Si c’est à contre cœur, le résultat est pire…
La rancœur refoulée, sur le cœur se blottit :
Le cœur dément souvent ce que la bouche a dit…
Si le « cœur sur la main » est chose bénéfique,
Le cœur sur... autre part, serait acrobatique.
« Loin des yeux, loin du cœur » est dicton pessimiste
Qui met la rage au cœur à tous nos « grand-cœuristes ».
Pour la dette de cœur, c’est richesse insolvable :
Nous restant sur le cœur, elle nous fait coupable.
Jacques Grieu
|
| |
Georges BIDAULT
ACEP-ENSEMBLE N°301
|
|
Un grand Français gênant
pour Charles De Gaulle
et escamoté
par I'Histoire politiquement falsifiée
« On peut tromper tout le peuple pendant un temps. Une partie du peuple pendant tout le temps, mais pas tout le peuple pendant tout le temps",
Cette citation de Georges Bidault me sert d'introduction pour vous le présenter. Il est né le 5 octobre 1899 à Moulins, dans l'Allier et a fait ses études dans différents internats catholiques, terminant sa formation à la Sorbonne.
Reçu premier à I'agrégation d'histoire et géographie en 1925, pour la petite histoire, devant Pierre Brossolette et Louis Joxe.
Puis Professeur au Lycée Louis le Grand, Georges Bidault comptera parmi ses élèves Jean d'Ormesson, Jean Ferniot et le sociologue René Caillois, celui-ci écrira en 1971, en s'adressant à Georges Bidault : « L'Histoire est de loin la moindre part de l'enseignement que j'ai reçu de vous. Vous m'avez appris bien davantage du côté du style et de la conduite de vie »
Quant à Jean d'Ormesson :
"Il ne lisait pas son cours, ne s'embarrassait guère de papiers, dictait parfois, en les martelant, des formules brèves et explosives. Son originalité d'esprit éclatait à chaque mot. Déjà le vocabulaire fuyait toute banalité et des images audacieuses fusaient en feux d'artifice. S'il fallait résumer en un mot la nature de son enseignement, je crois que je dirais ; une rigueur non-conformiste... "
Jean Ferniot évoquera son éloquence froide et son originalité d'esprit.
Georges Bidault épouse Suzanne Borel, qui sera la première femme attachée d'ambassade, en 1930.
Il n'envisageait absolument pas une carrière politique, bien au contraire, il souhaitait exercer comme journaliste, mais cela lui était impossible, à cette époque pré-Front populaire, en raison de ses opinions politiques. Cependant il devient éditorialiste du quotidien catholique « L'Aube ».
Mobilisé sur sa demande il est fait prisonnier en 1940 puis libéré en juillet 1941. Il demande à être affecté comme professeur au Lycée du Parc, à Lyon, parce qu'il s'agit de la région où la résistance est la plus développée en France.
Dès son arrivée, en février 1942, il entre en résistance dans le réseau « Combat» dont il devient membre du comité directeur et bras droit d'Henri Frenay. C'est dans ce groupe qu'il rencontre pour la première fois Albert Camus, qui collabore avec lui dans la rédaction du journal clandestin « Combat ». Puis, sur l’initiative de Jean Moulin, Georges Bidault créé le BIP (Bureau d'Informations et de presse), une agence de presse clandestine destinée à informer les différents mouvements de résistance intérieure ainsi que le bureau de Londres,
En mai 1943, il « monte » à Paris, en toute clandestinité, pour fonder le CNR (Comité National de la Résistance), dont il remplace à la présidence jean Moulin, suite à la trahison suivie de l'arrestation de celui-ci à Caluire, le 21 juin 1943.
Il aura longtemps un doute sur I'origine de cette trahison jusqu'au jour où Daniel Cordier, le trésorier de Londres, lui confirmera qu'il ne s'agissait pas d'un doute.
Georges Bidault maintient contre vents et marées la cohésion de la résistance intérieure, surtout contre De Gaulle dont l'objectif premier est de la diviser afin de promouvoir les FTP communistes qui le porteront au pouvoir dès la libération.
Je lui ai demandé de m'expliquer certains détails de la résistance et de la position de De Gaulle durant cette période. J'ai donc appris par lui que « le général de Londres » n'était pas en odeur de sainteté dans de nombreux réseaux.
Qu'après 1943 il avait eu pour objectif de la diviser afin d'éviter qu'elle ne s'oppose à lui lors de la libération, réservant les fonds de financement pour les FTP communistes au détriment du CNR. Mais je ne rentrerai pas dans l'histoire de la résistance car elle serait trop longue et mériterait une conférence à elle seule.
Georges Bidault contrôle et dirige l’insurrection à Paris, la capitale, elle 25 août 1944 c'est lui qui accueille De Gaulle à l'Hôtel de ville. Ils descendent ensemble les Champs-Élysées, (Comme en témoignent de nombreux reportages filmés et photos) avant que sa présence soit effacée pour les raisons politiques que l'on sait.
De Gaulle nommera Georges Bidault ministre des Affaires Etrangères dans son premier gouvernement provisoire le 9 septembre 1944.
Parce que ni Londres ni Washington ne veulent le reconnaître comme chef de l'État français, De Gaulle se tourne alors vers l'URSS.
Accompagné par Georges Bidault il s'envole vers Moscou en novembre 1944 et il en revient avec un pacte d'alliance de vingt ans avec les Russes. Il fait ainsi du parti communiste le parti de soutien de son gouvernement.
De Gaulle s'installe au pouvoir en France. Assuré dorénavant de l'appui sur sa droite du Conseil National de la Résistance, dirigé par Bidault, il offre aux communistes la direction politique de la résistance intérieure et nomme Maurice Thorez, (imposé par les Russes) ministre d'état.
Totalement ignoré lors des accords de Yalta, De Gaulle, reçu par Staline, signe un accord séparé à la date du 29 juin 1945 (Archives du Foreign Office).
C'est par Georges Bidault, qui était à ses côtés à Moscou, que j'ai appris quel avait été la monnaie d'échange pour obtenir tous les pouvoirs : De Gaulle s'engageait à livrer à Staline les 102.481 russes détenus dans le camp de regroupement de Beauregard, à La Celle-Saint-Cloud.
Il ne s'agissait pas uniquement de Russes mais également de Cosaques, Caucasiens, Baltes et Ukrainiens qui faisaient partie des trois millions qui, lors de l’invasion de I'URSS et de la Pologne, avaient été capturés par les Allemands, avec femmes et enfants, et déportés comme travailleurs.
Nombreux s'enrôIèrent dans la Wehrmacht, ceux qui étaient contre le régime communiste instauré par la révolution et par Staline. Ils s'étaient regroupés dans l'armée Vlassov afin de poursuivre la lutte.
Un véritable holocauste s'est produit à la libération, autre que la Shoah, mais celui-là a été recouvert par une chape de plomb, un silence de tous les Etats. Ce fut un crime contre l'humanité qui dépasse de loin tout ce que l'on a connu et condamné depuis.
Sur les 102.481 russes livrés à Staline, des milliers furent fusillés immédiatement, dès leur arrivée à Odessa, via Marseille, et des dizaines de milliers, plus malchanceux, seront dirigés vers le goulag où ils subiront les pires atrocités avant de disparaître.
De Gaulle a accepté sans état d'âme d'expédier vers l'URSS, donc vers la mort, tous les prisonniers Russes détenus en France, qu'ils soient consentants ou non, nombreux se sont suicidés afin d'échapper au destin qui les attendait où ont été abattus parce qu’ils refusaient de partir.
Le ministre de l’Intérieur, Edouard Dupreux (SFIO) et Georges Bidault (MRP), ministre des Affaires Etrangères, protestent énergiquement mais ils doivent s'incliner sur ordre de De Gaulle et de son vice-président du conseil, Maurice Thorez.
Avez-vous jamais entendu une voix qui accusait De Gaulle et les communistes français de cet holocauste ?
Dès lors Bidault s’oppose à De Gaulle lors du référendum du 5 mai 1946 qui soutient le projet de constitution socialo-communiste. Il fonde et devient président du MRP (Mouvement Républicain Populaire) qui sera le premier parti de France avec 160 députés contre 46 au Parti Communiste et 115 à la SFIO.
A dater de juin 1946 il est tout à la fois le chef de l'état, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Il promulgue la constitution de la IVème République, par référendum, le 13 octobre 1946.
En tant que chef du gouvernement il obtient pour la France une zone d’occupation en Allemagne, faisant ainsi reconnaître son pays comme l'un des « quatre grands ". II fait attribuer à la France un siège permanent au conseil de sécurité de I'ONU et impose le français comme langue officielle. Enfin il est I’initiateur du Conseil de l'Europe.
2 fois président du Conseil, 3 fois vice-président, 4 fois ministre des Affaires Etrangères, député de la Loire de 1945 jusqu'en 1962, Grand-Croix de la Légion d'Honneur compagnon de la libération et enfin ministre de la Défense, Georges Bidault a toujours mené une politique anti-communiste. II a critiqué ouvertement la politique indochinoise de Pierre Mendès-France, en 1954, et la politique Nord-Africaine d'Edgard Faure en 1955.
Partisan farouche de l’Algérie Française, il a voté l’investiture de De Gaulle avant de s'opposer à lui de toute sa volonté devant la dérive progressive de sa politique algérienne, et de lui vouer une hostilité absolue puisqu’il trahissait ses engagements les plus solennels. Georges Bidault n'a jamais accepté le reniement d'un Michel Debré, ni celui des quelques autres politiciens, qui ont fait le choix de leur fidélité à De Gaulle par ambition personnelle, plutôt qu’à leur engagement pour l'Algérie française.
Le 10 juin 1959 Georges Bidault prononce un discours étincelant à l'Assemblée, en faveur de l’Algérie française, qui lui vaut un tonnerre d’applaudissement mais, le 16 septembre de cette même année, suite à la décision gaullienne de l'autodétermination. Il s'écrie : « Je suis venu dire NON à ce sacrilège processus d'abandon ».
Il lui était insupportable d’imaginer I'abandon de I'Algérie comme I'avait été celui de l'Indochine, abandon qui l’avait terriblement traumatisé.
En compagnie de jacques Soustelle, Robert Lacoste, Bourgès-Maunoury, Coste-Floret et 200 autres personnalités, Georges Bidault organise le " Comité de Vincennes ", le 20 juin 1960 (il sera dissous quelques mois plus tard) et c’est lors de cette première manifestation que je fais sa connaissance puisque je « couvre » l'évènement pour mon journal L'Aurore.
Je retiens cette phrase de son discours : "Si la France ne, fait pas l'intégration du Nord au Sud. de Dunkerque à Tamnrasset, elle lui sera imposée du Sud au Nord. La seule véritable identité de l'Algérie française. "
Avec la dissolution du " Comité de Vincennes" disparaît la seule voie légale de défense de I'Algérie française.
Georges Bidault m'invite à le retrouver dans sa résidence de Saint-Cloud la semaine suivante et ce jour-là il me parle longuement d'Albert Camus, apprenant avec surprise que c'est lui qui m'avait engagé comme pigiste en 1954 et que je poursuivais une relation suivie avec Camus, à Paris, depuis mon arrivée en juin 1958. Georges Bidault avait lu mes articles concernant Albert Camus sur L'Aurore. Ces articles lui avait permis, me confia-t-il, de mieux cerner le personnage qu'il avait eu du mal à interpréter sur sa politique algérienne lors de leurs premiers contacts à l'époque de la résistance. Il avait été très satisfait d'apprendre que, s'il y avait un référendum sur l'autodétermination, Camus s'engageait totalement contre cette indépendance aussi bien dans les médias français qu'algériens.
A dater de cette date nous avons eu une relation plus suivie.
Georges Bidault avait nourri de grandes espérances sur le « putsch » des généraux, qu'il avait soutenu ouvertement et s'était montré très déçu lors de sa désintégration, dont il rendait responsable le général Challe pour avoir refusé de reformer les Unités Territoriales, dissoutes lors de la semaine des barricades, en 1960, et s'être opposé à l'armement d'une partie de la population algéroise. Il estimait que l'une des causes de I'échec de ce « putsch » avait été de ne pas avoir coupé tout contact radiophonique entre les soldats « appelés » et le chef de l'Etat qui s'adressait à eux.
Surveillé très étroitement par les Renseignements Généraux il me demande de le représenter à Madrid, en mars 1961, auprès du général Salan, de Pierre Lagaillarde et d'une demi-douzaine d'autres personnalités, lors de la création officielle de l'OAS (qui fonctionnait officieusement à Alger depuis février). Je m'y étais rendu sous prétexte du match de football Espagne/France qui s'y disputait le 2 avril.
Ce jour-là Georges Bidault se ralliait totalement à l'OAS.
C'est dans ce contexte, dès mon retour, que je suis convoqué par lui, dans sa villa à Saint-Cloud. J'y rencontre pour la première fois le capitaine Pierre Sergent.
Mme Bidault nous offre le thé et la décision est prise de fonder le « Bulletin de liaison et d'informations du CNR/OAS » afin de rétablir la vérité sur la réalité des attentats programmés par l'OAS et ceux réalisés par les « services secrets » à la solde du gouvernement gaulliste et qui sont imputés à l'OAS. Ce bulletin de liaison du CNR/OAS est destiné à renseigner les médias nationaux et internationaux, ainsi que les personnalités politiques, sur le véritable combat de l'OAS, et fournir des informations inconnues ou occultées, par la grande presse.
Par exemple, ce qui a été soigneusement dissimulé par tous les médias, le massacre programmé, dix jours avant la signature des « accords d'Evian », sur ordre de De Gaulle et de son gouvernement d'une unité d'infanterie composée essentiellement de jeunes appelés du contingent, basée non loin de Souk-Ahras, dans l'Est algérien.
Sur ordre de De Gaulle, l'armée française allait commettre la plus odieuse forfaiture de son histoire.
Depuis le lever du jour du 9 mars 1962, une pluie d'obus tirés par l'artillerie lourde de I'ALN installée en Tunisie pleut avec une intensité sans précédent sur cette unité composée de jeunes recrues, des appelés pour la plupart. Le commandant de I'unité n'a pas les moyens matériels de riposter car ses hommes ne sont équipés que d'armes légères. En effet, sur ordre du gouvernement on lui a retiré quelques jours plus tôt son artillerie lourde plus un régiment de la Légion étrangère et une demi-brigade de blindés.
Ordre bien singulier puisque les services secrets avaient signalé une concentration inhabituelle de forces adverses en territoire tunisien, juste en face de ce secteur.
Sans cesse le commandant demande par radio à sa hiérarchie basée à Constantine et à Bône, l'appui de l'aviation pour le dégager,
La situation devient désastreuse à l'aube du 10 mars. Les tirs redoublent de violence. Puis c'est le silence « Je vous en prie, réagissez ! Nous risquons une attaque massive des fellaghas »
De son poste d'observation le commandant constate à l'aide de ses jumelles qu'à moins d'un kilomètre plusieurs brèches ont été ouvertes dans le barrage électrifié qui marque la frontière entre les deux pays.
Sur les collines environnantes des milliers de combattants de l'ALN progressent à découvert dans sa direction. Ils sont à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau. Il sait qu'il ne pourra pas résister à une attaque de cette envergure et que tous ses hommes vont se faire massacrer. Il se demande Pourquoi on ne lui envoi aucune aide. Ce qu'il ignore c'est que l'état-major militaire a reçu I'ordre de ne pas intervenir.
Pour quelles raisons ? Des négociations sont engagées avec les nationalistes algériens et Louis Joxe discute en ce moment même à Evian avec les représentants du GPRA.
Pour amadouer les dirigeants nationalistes, le gouvernement français a décidé quelques jours plus tôt un cessez le feu unilatéral.
Ainsi I'ALN peut agir en toute impunité et tenter une opération spectaculaire afin de négocier dans de meilleures conditions.
Et c'est pour cette raison que De Gaulle va sacrifier sans aucune pitié sans aucune émotion, quelques centaines de jeunes soldats appelés du contingent dans le seul but de démontrer à la métropole la nécessité urgente de terminer cette guerre quel qu'en soit le prix.
Informé de tout cela, le lieutenant-colonel Lisbonis, commandant la base aérienne 213 de Bône hésite à intervenir. Un an plus tôt, au moment du putsch des généraux, il était resté fidèle à De Gaulle. Mais sa conscience le tenaille et il ne peut concevoir de ne pas se porter au secours de ces soldats français sacrifiés au nom d'une odieuse politique d'abandon.
Dès le lever du jour il donne l'ordre aux escadrilles de décoller.
En quelques heures la victoire change de camp. Les pilotes des T-6 arrosent de leurs mitrailleuses les fellaghas surpris par une attaque aérienne qu'ils n'attendaient pas et les B-26 franchissent la frontière, les poursuivant et lâchant leurs bombes sur les positions de l'artillerie adverse.
Les soldats du contingent et la population civile sont sauvés.
Quant au lieutenant-colonel Lisbonis, il s'envole pour Paris. Non pas pour être félicité mais par mesure disciplinaire.
Le gouvernement lui reproche d'avoir enfreint les ordres et d'avoir gravement compromis les pourparlers d'Evian, même au prix de la vie de quelques centaines de jeunes soldats français.
Le 14 mars, le commandant de la base aérienne de Bône les-Salines est mis aux arrêts pour avoir riposté aux attaques de I'ALN contre le barrage.
Il fera parvenir à Georges Bidault tous les détails de cette trahison d'état.
En écrivant ces lignes il me revient en mémoire l'une de ses déclarations percutantes :
« Il ne faut jamais accepter que soit affirmé que les 400.000 appelés du contingent venaient défendre les «Français d'Algérie », les « colons » comme ils disent. Ce n'est pas pour vous défendre que des milliers sont morts en Algérie. Jusqu'en 1959 ils sont morts pour la France, pour défendre une terre française qui devait rester française, après cette date ils ont été sacrifiés pour une terre qui ne serait plus française, ils ont été « assassinés » par de Gaulle, par sa politique. Ils se sont fait massacrer alois que les émissaires gaullistes « marchandaient » avec le FLN l'abandon de l'Algérie. Ils ont été sacrifiés comme l'ont été les Harkis au nom de la grandeur gaullienne.
Quand les Corps Francs d'Afrique ont débarqué en Provence, quand les tirailleurs algériens ont libéré Colmar, ce ne sont pas les Provençaux et les Alsaciens qu'ils venaient libérer mais la France.
La décision prise par le socialiste Guy Mollet d'envoyer le contingent en Algérie a été un acte criminel. Cette guerre devait rester une guerre de soldats de métier et non pas d'appelés novices. Fin de citation.
Georges Bidault est informé sur les tractations secrètes qui se déroulent en février 1962, aux Rousses, dans le Jura, et sur des agréments secrets, qui sont acceptés par les représentants français. Il était stipulé que les supplétifs musulmans, l es « harkis », seraient licenciés et que ces musulmans fidèles à la France seraient livrés désarmés à la vindicte du FLN.
Et comme cela accrochait également sur le Sahara, De Gaulle, qui avait déclaré quelques mois plus tôt « Le Sahara c'est l'œuvre de la France, c'est la chance de I'occident », n'hésite pas à ordonner à ses négociateurs de ne pas bloquer le processus : « Avec le Sahara et les supplétifs ne compliquez pas les choses. La France ne doit plus avoir aucune responsabilité dans le maintien de l'ordre après I'autodétermination. Si les gens s'entre massacrent, ce sera l'affaire des nouvelles autorités. Le maintien de l'ordre public sera l'affaire du gouvernement algérien, ce ne sera plus la nôtre. Les Français n'auront qu'à se débrouiller avec ce gouvernement. »
Il s'en est suivi le massacre par le FLN de plus de 60.000 supplétifs, harkis, et leurs familles.
Nouveau crime contre l'humanité avec la complicité de De Gaulle et du gouvernement de la France.
Après la signature des « Accords d'Evian », le 20 mars 1962, Georges Bidault fonde à Rome, avec Jacques Soustelle, Antoine Argoud et Pierre Sergent, le nouveau CNR et en devient le président.
Il dénonce publiquement que « non seulement I'armée française a reçu l'ordre de s'abstenir mais, ce qui est bien plus grave, en apportant I'aide de l'aviation et de certaines unités, à I'ALN, elle a participé à I'anéantissement du maquis OAS de I'Ouarsenis, dont le seul objectif était de lutter contre le FLN. L’armée française est responsable du massacre de plus de la moitié des effectifs. »
En juillet 1962 son immunité parlementaire est levée. (241 voix pour, 72 contre et 167 abstentions)
Dès lors il juge sa liberté d'expression entravée et sa vie menacée.
La villa de mon patron, Robert Lazurick, (L'Aurore) se situe à quelques dizaines de mètres de celle de Georges Bidault. J'ignorais qu'il était au courant de mes rapports avec celui-ci et je suis particulièrement surpris lorsqu'il me prie de contacter Georges Bidault afin de lui conseiller fortement de quitter la France car son arrestation n'est qu'une question d'heures. Georges Bidault rejoint Bruxelles et y retrouve Jacques Soustelle, puis la Suisse, l'Italie et, enfin l'Allemagne.
Dès l'annonce de l'arrestation du général Salan, Georges Bidault est nommé nouveau chef de I'OAS. Cette phrase est extraite de sa première déclaration comme chef de l'OAS :
« Nous souhaitons qu'un régime fort et moderne;fasse oublier la faiblesse des institutions de la quatrième République et I'indignité des hommes de la cinquième »
Georges Bidault sera expulsé d'Allemagne, après l'enlèvement folklorique du colonel Argoud, puis du Portugal, où le président Salazar lui obtient un visa pour le Brésil où il résidera quatre années.
Ces années d'exil I'ont profondément marqué. Lui qui avait engagé sa vie dans la résistance contre l'ennemi extérieur puis, plus tard, contre l'ennemi intérieur, concevait mal qu'il ait été obligé de quitter son pays parce qu'il se battait pour sa grandeur, pour son influence, pour son rayonnement dans le monde, comme il l'avait toujours fait.
Revenu en France, après l'amnistie de 1968, il soutiendra Alain Poher en 1969, participera à la création du Front National, en octobre 1972, mais se retirera une semaine plus tard, ne partageant pas quelques options retenues et, enfin, soutiendra Jacques Chirac en 1981.
C'est cette année-là que je l'ai rencontré pour la dernière fois. Je l'avais invité à déjeuner d'un couscous dans un restaurant très connu des « Pieds-Noirs », Porte Maillot.
Ce n'était plus le même homme bien sûr. Fatigué, désabusé, il faisait un constat de l'état de la France et me prédisait la venue d'années difficiles devant le laxisme des gouvernements successifs, de gauche comme de droite, devant l’invasion migratoire et la situation économique désastreuse.
On ne peut que constater, trois décennies plus tard, que son analyse était des plus justes.
Georges Bidault nous quittera physiquement le 27 janvier 1983. Son corps est inhumé à La Celle-les-Bordes, dans les Yvelines.
Les plus hautes autorités de l'état et de la nation sont absentes lors de I'hommage et les honneurs militaires qui lui sont rendus, du bord des lèvres, aux Invalides.
Emmanuel Gomez
|
|
LE PRIX DE LA DOULEUR
VERITAS N°80 février 2004
|
|
Ce témoignage authentifié, exceptionnel et inédit, est celui d’un médecin métropolitain qui s’est dévoué à soulager de son mieux les troubles psychosomatiques dont nous avons tous souffert à la suite de notre exode.
Sous couvert d'anonymat (suppression des noms propres) le Docteur Cattin nous relate, dans une parfaite authenticité, I'expérience qu'il a vécue dans sa vie professionnelle et qui a motivé son engagement à nos côtés. Ill nous précise avoir sollicité I'avis de l’Ordre des Médecins qui, à 90% approuvent son témoignage. Ils sont nombreux, ils sont quelques milliers, dans la France entière, qui pourraient apporter d'autres témoignages corroborant ceux de notre ami. Qu'ils le fassent donc, sans crainte. LA LETTRE DE VERITAS leur ouvre ses colonnes : Tous les Français doivent connaître nos épreuves et mesurer notre calvaire.
Le terme de médecine psychosomatique évoque l'antique problème des relations du corps et de l'esprit, ce dernier étant longtemps confondu avec l'âme, terme théologique. Ce conflit fut occulté ou obscurci par la survivance du dualisme cartésien jusqu'au XIXème siècle.
Aujourd'hui, nous savons qu'on ne peut pratiquer une médecine séparée de chacun des deux composantes de I'être humain, ( Professeur Jean Delay « Introduction à la médecine psychosomatique» Masson 1961). Nous connaissons l'importance du rôle des affects, c'est-à-dire des émotions violentes, extériorisées, mais plus encore secrètes, dans le déterminisme de certaines maladies organiques, aussi bien que dans celui de perturbations mentales plus ou moins durables.
Les observations médicales qui vont suivre sont véridiques, mais elles sont rapportées sous le plus strict anonymat, pour respecter la loi du secret professionnel. Elles s'étalent sur une dizaine d'années depuis 1962 :
LE CAS DE MADAME R...
Le 15 août 1962, Madame R...,31 ans, rapatriée d'Oran, se présente à la maternité de L.... avec une grossesse à terme. Dès le début de l'accouchement, la patiente présente brusquement les symptômes d'un délire confusionnel aigu, désorientation complète, refus de tout effort expulsif. Une application de ventouse, difficile en raison de l'agitation, permet d'extraire un enfant vivant normal.
Dans les jours qui suivent, le délire va se poursuivre, moins agité, mais avec la même désorientation. La patiente ne reconnaît plus son mari, refuse de voir son enfant, nie, même, avoir accouché. On pense, un moment, à une psychose puerpérale. C'est alors que le mari, très peu loquace, qui apprend que sa femme qui n’a jamais été malade un seul jour depuis dix ans qu'ils sont mariés, avait été admise dans une maternité d'0ran, au début du mois de juillet 1962, pour menace d’accouchement prématuré.
Le 5 juillet, des terroristes F.L.N. se sont introduits dans cette maternité, ont violé et éventré plusieurs femmes dont l'une était en train d'accoucher. Une sage femme arabe, qui tentait de s'interposer, a été violée et égorgée. Madame R... a pu se barricader dans les toilettes avec une autre femme enceinte et elles sont restées ainsi plusieurs heures avant que les gendarmes n'interviennent.
Les suites de ce violent choc émotionnel vont durer longtemps. Après un séjour hospitalier qui n'apportera guère d'amélioration, Madame R... va garder un état dépressif chronique, Elle ne pourra s'occuper de ses enfants (elle en a deux autres). Une voisine charitable viendra les garder dans la journée pendant que le, mari part à la recherche d'un travail, puis, une belle-sœur viendra, à demeure, manifestant cette belle solidarité familiale méditerranéenne.
Un an plus tard, Madame R... ne peut encore sortir seule, reste paniquée devant tout visage étranger, doit suivre un traitement médicamenteux assez lourd et reste chroniquement handicapée avec la nécessité d'une tierce personne à domicile. En fait, il faudra des années avant que cette femme retrouve un comportement tout à fait normal.
LE CAS DE MADAME L...
Madame L.., 63 ans, rapatriée d'Oran, a erré d'hôpital en hôpital depuis son arrivée en métropole, avant de venir échouer dans un logement misérable, une sorte de hangar avec deux lucarnes pour fenêtres.
Un logement décent, disponible et tout proche a été refusé par son propriétaire qui ne voulait pas le louer « à ces gens-là parce qu'il était gaulliste à 100% », (sic).
L’environnement est hostile : " Qu'est-ce que ces étrangers viennent faire chez nous ?
"Question souvent posée surtout lorsque ces rapatriés sont d'ascendance espagnole.
La malade est atteinte d'une tumeur primitive du foie, affection incurable à cette époque. Elle souffre jour et nuit, présente un comportement très agressif envers le médecin, ne veut plus entendre parler d'hôpital où elle dit avoir été si maltraitée. La famille est sans ressources. Le mari, ancien fonctionnaire municipal, ne perçoit plus sa retraite depuis qu'il a quitté l'Algérie.
Les plus proches voisins, des Espagnols réfugiés, depuis 1939, de l'Espagne de Franco, refusent tout contact avec « ces Pieds Noirs fascistes ». Pourtant, aidant un jour le mari à se retrouver dans ses papiers, je découvre une carte d'adhésion au parti communiste d'Oran...
L’état de la malade s'aggravant, elle me demande de lui adresser un prêtre. Par malheur, celui que je contacte est un ancien du Prado. Par deux fois, il refuse de venir parce qu'il s'agit de rapatriés d'Algérie (sans doute des suppôts de Satan dans son esprit ?). Je pourrai, enfin, trouver un prêtre neutre politiquement qui accepte de venir... Mais la malade va mourir en maudissant Dieu et les hommes, projetant également contre moi ses malédictions, perdue dans un délire induit par des doses croissantes de morphine.
Après la mort de Madame L.., la famille de cette dernière va reporter sur moi, médecin métropolitain, toute l'agressivité qu'une trop longue souffrance avait fait naître. Toute la misère du monde s'était réunie dans I'hostilité générale rencontrée en métropole dans des conditions de vie matérielle lamentables et dans la fatalité d'une maladie douloureuse et incurable.
Refusant de méditer sur l'ingratitude humaine qu'un jeune médecin doit apprendre à rencontrer sur son chemin, je ne peux éprouver qu'une immense compassion devant un destin de malheur aussi accablant !
LE CAS DE MADAME S...
Madame S... , rapatriée de Boufarik, vient me voir pour des maux de tête intenses, quotidiens, l'obligeant parfois à garder la chambre dans l'obscurité, ne cédant à aucun calmant. « Je crains, par instant, de devenir folle... Bilan, radio, fond d'œil, tout a été fait à Aix-en-Provence. « Je ne comprends pas qu'il ne m'ait rien trouvé... Ne me dites surtout pas que c'est nerveux !,.
Revue une seconde fois. La réticence hostile de la patiente s'accentue : « Vous ne pouvez rien pour moi, je ne veux pas vous faire perdre votre temps...,. Le hasard d'une matinée vide.,. et c'est le déclic...
Je réponds : « Mais... j'ai tout mon temps.,. La patiente baisse sa garde, sa colonne vertébrale rejoint lentement le dossier du fauteuil, ses mains, crispées sur les accoudoirs, se relâchent.
La patiente va parler. Parler d'abord avec hésitation, méfiance ou retenue de pudeur, puis, bientôt, avec véhémence, précipitation même, comme pressée de se soulager d'un fardeau trop longtemps porté ! J'apprends la mésentente familiale avec la belle-famille, les difficultés de vivre entassés à cinq personnes dans deux pièces, le mari toujours sans emploi. L'inquiétude pour un frère engagé dans l'O.A.S, et dont on est sans nouvelle depuis trois mois...
La patiente s'interrompt un instant, me jette un coup d'œil interrogateur. Devant mon silence, elle poursuit. « C'est bien une des rares fois ou prononçant le mot OAS. devant un métropolitain, celui-ci ne me fait pas la morale... La morale ? Je ne suis pas là pour ça et je dois garder une neutralité bienveillante. Ayant l'intuition d'un moment de grâce dans cet entretien à but thérapeutique, je lui demande de poursuivre, bien que, deux ou trois fois, Madame S... esquisse le geste de se lever. « Ah ! cela m'a fait du bien de pouvoir dire tout ce que j'avais sur le cœur ! » Combien de fois entendrai-je, de mes patients rapatriés, cette exclamation qui atteste bien de I'empathie curative de la relation médecin-malade. Lors de cette consultation, nous avons à peine parlé des maux de tête qui, pourtant sont toujours là !
Un mois plus tard, je revois Madame S... car son fils souffre d'une angine. Les maux de tête ont entièrement et spontanément disparu. Je reste muet, autant de surprise que d'embarras. D'où venaient-ils ?
Je veux éviter le charabia médical des « céphalées psychogènes », tout autant que la simpliste affirmation « c'était nerveux ». La patiente me tire d'embarras : « Pour moi, c'était la sinusite ». D'accord pour ce mot familier et rassurant.
Puis elle ajoute : « La vie était devenue, pour moi, un enfer. C'est vous qui m'avez guérie. ,. Je crois bien que la dernière fois, je ne lui ai même pas fait d'ordonnance ! Ma disponibilité de temps et d'écoute a-t-elle suffi pour servir de catharsis à une souffrance morale inexprimée jusque là, à l'exorcisme d'un environnement hostile ? Un sourire lumineux, un de ceux que l'on n'oublie pas, veut m'en persuader.
LE CAS DE MADAME V...
Madame V... souffre d'un état permanent d'angoisse « peur de quelque chose ,. Elle ne sait pas quoi, mais « qui va arriver,. Elle vient me voir pour me demander conseil, mais elle ne veut aucun médicament. Elle a « peur de se droguer ».
L’exode s'est passé, pour sa famille, le moins mal possible. Son mari, employé de banque, avait été muté en métropole au début de 1962. Logement médiocre mais bonne entente familiale. Un peu réticente à ce premier contact, Mme V... va s'ouvrir davantage, ensuite. Elle souffre de cauchemars :
« retenue prisonnière dans une cage sans issue ». Elle entend des voix, chose qu'elle n'a osé dire à personne, ni à son mari, ni à sa fille de seize ans... « Je crains de devenir folle,. Je la rassure : ce syndrome mineur de psychose hallucinatoire de la cinquantaine est souvent de bon pronostic, traité par la chlorpromazine que j'impose à ma patiente.
Un mois plus tard, nette amélioration : les voix se sont tues. « Ce qu'elles disent n'a plus aucun sens » affirme la patiente. Je pense que tout va s'arranger en poursuivant le traitement. J'ai tort.
Comme j'ai tort de ne pas avoir remarqué davantage cette réflexion faite au moment de raccompagner ma patiente. « Cela fait deux ans que je n'ai pas fait mes Pâques...,. Nous sommes en avril 1963.
Quelques jours plus tard, c'est la grande crise de délire. Madame V... présente un état confusionnel. Elle veut partir, en pleine nuit, n'importe où, son mari et sa fille doivent la maintenir. Les voix ont repris de plus belle et lui disent. « qu'elle est damnée et que personne n'y peut plus rien
« Pendant le long séjour que la patiente va faire en psychiatrie, le mari m'apprendra que sa femme a commencé à être perturbée à Pâques 1961, lors d'un sermon de l'Evêque d'Alger, lu à l'Eglise Saint Augustin, ce qui avait fait sortir, en pleine messe pascale, tous les fidèles outrés et révoltés par les insultes et les reproches dont ce prélat accablait la communauté Pied Noir en général, et ses ouailles, en particulier. L’époux de la patiente, qui se dit « non pratiquant» me déclarera : « J'éprouve moins de haine contre le F.L.N. qui nous a chassés que contre certains prêtres qui ont excité les musulmans c1ntre nous, par pure démagogie. Voulant revoir un prêtre en métropole, il y a quelques semaines, ma femme est tombée sur un imbécile de petit abbé qui lui a dit : "l'exode des Pieds Noirs est une punition que Dieu leur inflige !" ,.
Or, le bilan hospitalier sera bien celui d'une névrose religieuse d'une patiente profondément croyante, déchirée entre son respect de l'habit ecclésiastique et sa révolte silencieuse contre certains prêtres d'Alger. Elle devra suivre un traitement très long avec de nombreuses rechutes de crises d'angoisse, traversant cet univers morbide de la faute rempli de rites expiatoires multiples qui trouvent un terrain favorable chez une nature scrupuleuse.
Revue de loin en loin, pendant des années, Madame V... ne retrouvera le chemin de l'Eglise qu'avec beaucoup d'appréhension et seulement le jour de la mort de son mari, tandis que sa fille, elle, abandonnera toutes pratiques religieuses.
J'aurai encore l'occasion de rencontrer plusieurs cas semblables de névroses religieuses, latentes le plus souvent, prenant le masque de troubles psychiques, d'accès dépressifs, de crises d'angoisse, d'insomnies rebelles dans leurs formes mineures, mais parfois, aussi, tournant à la pathologie mentale déclarée, comme le cas de Madame V..
Toutes ces perturbations avaient comme origine commune le scandale éprouvé par cette communauté chrétienne, gravement menacée dans sa survie par la violence d'un terrorisme aveugle, et qui voyait cette violence meurtrière, encouragée, souvent bénie et parfois ostensiblement soutenue par certains membres du clergé catholique !
LE CAS DE MADAME B...
Madame B.., la cinquantaine, élégante, a tellement besoin de parler de s'exprimer, que, dans le salon d'attente, elle a rédigé une liste de tout ce qu'elle veut me dire. Insomnie presque totale, angoisses par crises redoutables avec palpitations. Bien sûr, « les événements » y sont pour quelque chose. « Pourtant, aux pires moments, j'ai fait face. Oui, nous avons tout perdu, mon mari avait un cabinet d'assurances... Pleurs. Je n'ai jamais pleuré lorsque nous sommes partis, précipitamment... En fait, la patiente me parle peu de l'exode. Tout roule sur ses souvenirs d'enfance, sur sa ville natale, Miliana cette perle du Zaccar située au flanc du Dahra. Si vous la connaissiez !...
Au cours des consultations suivantes, j'apprendrai à connaître « ces couchers de soleil sur la vallée du Chélif, les plus beaux d'Algérie !...
"La patiente a un don de conteuse. Ses descriptions sont lyriques, colorées. Quel merveilleux pays. Larmes redoublées... Je suggère : « Vous devriez écrire cela, pour vos enfants...». «Oh ! Docteur - répond-t-elle - mes mains tremblent tellement que je ne peux presque plus écrire. » L’étincelle aurait dû jaillir ce jour-là !
Appelé à domicile quelques jours plus tard en raison de I'aggravation de l'état de la malade, le mari me prend à part pour me dire que sa femme n'a jamais été comme cela en Algérie, même aux pires moments de l'exode. Tout semble s'être déclenché depuis que nous sommes arrivés à Lyon 1..., Enfin, la lumière jaillit. Non, la ville de Lyon n'y est pour rien. Cette patiente développe les symptômes d'une maladie de Basedow, un hyperfonctionnement du corps thyroïde dont la cause est souvent dépendante d'une violente émotion. Je n'avais pas pris assez de recul pour noter tous les symptômes : tremblement des mains, amaigrissement, insomnie totale, tachycardie...
Très améliorée par le traitement, Madame 8... viendra me dire, un mois plus tard, qu'elle attribue cela au fait que j'ai, longuement, su I'écouter, qu'elle avait pu « me dire tout ce qu'elle avait sur le cœur». Si elle savait que mon écoute, trop complaisante, a failli me faire passer à côté du diagnostic !
Le charme de Miliana.. Peut-être aussi celui de cette femme qui n'en manquait pas (convient-il de faire cet « aveu» ?). Dans ce cas précis, j'ai privilégié l'écoute au détriment de l'observation rigoureuse des symptômes, alors que l'inverse est parfois reproché aux médecins.
Il s'agissait là d'un cas typique de maladie organique, déclenchée par le stress des événements d'Algérie, qui nécessita un très long traitement et laissa, ensuite, pendant très longtemps, une instabilité nerveuse.
LE CAS DE MONSIEUR G..
Monsieur C... , employé des Postes à Constantine, se présente aussi comme un ancien de la 3ème D.l.A. ( troisième division d'infanterie algérienne). Il me montre sa blessure de l'épaule « un éclat de BB » comme si la signature du célèbre canon allemand était un motif supplémentaire de fierté.
Il vient pour des douleurs à la face externe des deux jambes, de plus en plus vives, et des cauchemars « terrifiants » qui, joints à l'irascibilité manifeste annonce une polynévrite alcoolique.
Indifférent au diagnostic, l'homme enchaîne. « Nous avons été trahis par De Gaulle qui est un falempo. Le monument aux morts de son village natal aurait été détruit par l'Armée française, elle-même. Le nom de mon père, tué en 1917, au plateau de Craonne, y était inscrit, avec ceux d'une trentaine de Pieds Noirs morts pour la France... Nous voilà obligés de partir de chez nous, une main devant, une main derrière.,.
Je m'efforce d'être apaisant et m'enquiers de l'emploi retrouvé. " Ils ont décidé de me reprendre aux P.T.T. si j'acceptais une cure de désintoxication. Un point favorable, le patient reconnaît son alcoolisme, ce qui est rare... Et alors ? Après trois jours en cure libre à V... (hôpital psychiatrique), I'homme a interrompu cette cure.
" Ils ont été odieux avec moi me disant, qu'à la 3ème D.l.A., il n'y avait que des bougnoules, les Pieds Noirs étaient restés bien tranquilles chez eux pour continuer à faire suer le burnous. L’homme écumait de rage, prenant au premier degré ces éternelles stupidités qui règnent en métropole, attestant, pour l'Histoire, d'une dégradation de I'esprit public.
Avec l'assistante sociale, nous essayons de lui trouver un emploi aux Travaux Publics, moins regardants sur la question de l'intempérance. Conflit avec « un cégétiste qui m'a traité de fasciste, suivi de voies de fait, renvoi au bout de quinze jours.
Voilà un homme en détresse, veuf, sans famille, isolé au milieu de voisins indifférents ou hostiles.
Je tente, avec prudence, une cure de désintoxication à domicile qui paraît réussir pendant trois semaines, laissant quelque espoir. Puis, la solitude et le découragement aidant, c'est la rechute avec, une nuit, crise de delirium tremens nécessitant l'admission urgente en psychiatrie... Décès quinze jours plus tard dans un tableau de confusion mentale irréversible.
Il s'agissait, certes, d'un terrain alcoolique, mais curable.
J'accuse la propagande officielle anti-Pieds Noirs, I'imbécillité et la méchanceté de certains métropolitains, jusque dans le personnel sanitaire, d'être responsables de la fin misérable d'un citoyen français arraché à sa terre natale et qui ne connaissait cette ingrate métropole que pour I'avoir visitée, lors du «grand voyage organisé », de 1944 !
Citoyen d'un autre pays, ancien combattant et blessé de guerre pour la France, il aurait été honoré comme il le méritait. Le malheur, c'est qu'il n'était que citoyen français, mais... Français d'Algérie !
LE CAS DE MADAME T… ET DE SA FILLE
Madame T... m'appelle au chevet de sa fille. Elle a 6 ans et présente des douleurs abdominales vives et une température élevée, évoquant une appendicite aiguë. Il ne s'agit pas d'une appendicite - me déclare la mère d'un ton affirmatif – ma fille est atteinte de la Maladie Périodique, affection très rare atteignant exclusivement les familles juives sépharades d'Afrique du Nord. Le professeur S..., d'Alger, qui a reconnu cette maladie, m'a recommandé de ne pas faire opérer ma fille.
Il se trouve que je connais le professeur S... de nom, ayant lu une de ses publications. Me voilà aussitôt investi par la mère d'une parcelle de la confiance totale qu'elle place dans ce pédiatre algérois.
Cependant les symptômes persistent, inquiétants. Je demande un bilan hospitalier. Alors la colère de Madame T... éclate. Elle a déjà fait hospitaliser sa fille dans un grand service de pédiatrie ou l'on voulait, à toute force, l'opérer.
Devant mon opposition, on m'a traitée de mère irresponsable. J'ai réagi, comme vous le pensez. Un interne a été odieux. Vous, les Pieds Noirs, m'a-t-elle dit, vous vous croyez d'une race supérieure. Il va falloir en rabattre, ici. Quant à vos médecins algérois, tout ce qu'ils savent faire, c'est de laisser mourir les enfants arabes.,.
J'exprime aussitôt mon indignation à Madame T..., lui rappelant que l'Ordre des Médecins Français a condamné ouvertement cette calomnie odieuse. Mais le choc émotionnel a été trop violent et Madame T... refusera longtemps toute idée d'une nouvelle hospitalisation, ne facilitant pas ma tâche.
Je ne veux pas m'exposer à me faire insulter de nouveau.
Cette femme avisée ne connaît que trop les limites offertes par la médecine au traitement de sa fille.
Venez quand même-me dit-elle - votre présence nous réconforte et, après ma fille va mieux. Vous voyez bien que vous êtes capable de la soigner ici. Miracle ou illusion que donne la confiance ?
Je ne veux pas passer pour un thaumaturge. L’angoisse de Madame T... se répercute sur celle de sa fille et redouble les douleurs de celle-ci, tandis que - je l'ai bien observé - l'apaisement de la mère améliore indiscutablement l'état de I'enfant.
Comment a-t-on pu méconnaître à ce point l'importance des liens privilégiés unissant une mère hyper protectrice et une enfant chroniquement malade, à la sensibilité exacerbée, trop précocement mûrie par la souffrance ? Cela se lit dans le regard pathétique qu'échangent ces deux êtres.
A la détresse de l'exode, à I'insécurité de l'avenir familial, (il y a deux autres enfants et le mari n'a pu encore retrouver de situation), à l'alarme d'une mère devant cette inquiétante maladie, au devenir mal connu de la médecine, en métropole, il a fallu que s'ajoute le traumatisme affectif causé par ces médecins manquant de la plus élémentaire psychologie, à défaut de toute compassion humaine !
Par bonheur, Madame T... pourra revoir le professeur S..., réinstallé en métropole. La famille quittera la région mais je serai tenu au courant de l'état de santé de cette enfant pendant très longtemps, entretenant un lien amical, presque affectif, avec cette famille, lien qui parfois apporte le meilleur soulagement quand la médecine est impuissante.
LE CAS D'HELENE
« Je vous amène ma fille qui se plaint de maux de tête continuels, de troubles de la vue. Elle maigrit sans arrêt depuis deux mois. Avec cela échec scolaire complet. Pourtant, elle était toujours première de sa classe au lycée Fromentin à Alger, spécialement douée en mathématiques... ,.
Je regarde cette jeune fille de seize ans, longiligne, maigre en effet, le front haut dégagé, légèrement bombé (tendance au mysticisme ?) enfermée dans un mutisme total. « A la maison également Hélène ne dit plus un mot,. Un bilan hospitalier n'a rien montré d'organique.
Après deux rendez-vous annulés, je peux enfin recevoir la jeune fille seule. Elle s'exprime avec beaucoup d'aisance. Il y a deux mois la prof. de maths du lycée m'a prise à parti pendant le cours, pour me dire que je devrais avoir honte de mes parents et grands-parents qui pendant 132 ans en Algérie s'étaient conduits comme des esclavagistes... Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ensuite, en récréation, la plupart des élèves ont approuvé. Une fille a même ajouté que le colonialiste équivalait à fasciste. C'est son père qui avait lu cela dans les temps modernes, la revue de Sartre ... Je ne veux pas que mes parents le sachent, je ne veux pas qu'ils soient humiliés comme je l'ai été : vous me promettez de ne jamais rien leur dire ? ». Mais les troubles de la vue se sont accentués, la moindre lecture est difficile, l'amaigrissement m'inquiète. Je parle d'un nouveau bilan hospitalier qui est refusé.
Hélène, élève brillante, fille unique, était l'objet de toutes les ambitions de ses parents, ruinés par l'exode. Le père architecte n'avait retrouvé qu'un emploi médiocre. Pourtant, elle va décider d'abandonner ses études pour devenir une petite employée de commerce. Trois mois plus tard, en m'apprenant cette lamentable décision, et en me remerciant d'avoir gardé son secret, Hélène me dit que tous ses troubles ont disparu dès qu'elle a pris cette décision, avec reprise de poids de 5 kg en quelques semaines.
Une psychothérapie, d'ailleurs refusée, aurait été problématique dans un environnement hostile, surtout dans ce monde scolaire et universitaire, qu'Hélène a dû fuir car il lui renvoyait trop une image insupportable de ses parents et grands-parents.
L’agressivité qu’elle a du ressentir en retour, enfermée dans ce secret volontaire, s'est retourné contre elle-même, induisant cette conduite auto-punitive.
Ai-je eu tort de rester le dépositaire de ce secret ? Et au contraire, gardant ainsi la confiance de cette jeune fille à I'intelligence et à la sensibilité extrêmement vives, ai-je pu contribuer à conjurer l'évolution d'une « maladie de conversion ,, en particulier la redoutable anorexie
Ai-je eu tort de rester le dépositaire de ce secret ? Et au contraire, gardant ainsi la confiance de cette jeune fille à l'intelligence et à la sensibilité extrêmement vives, ai-je pu contribuer à conjurer l'évolution d'une maladie de conversion, en particulier la redoutable anorexie mentale que l'on a craint un moment ? Qui peut le dire ?
Telle est l'histoire véridique d'une jeune fille Pied-Noir qui se sacrifia symboliquement pour défendre l'honneur de sa communauté et de ses ancêtres. Elle rappelle un peu celle d'Antigone, cette héroïne antique qui se fit victime volontaire au nom d'un idéalisme trop exigeant.
Les parents d'Hélène sont morts, elle-même a quitté ma région pour se marier à l'étranger.
LE CAS DE MONSIEUR G...
Monsieur G... est rapatrié de l'Oranais. Sa stature de colosse silencieux aux traits figés, contraste avec l'aspect de sa femme menue, remuante et bavarde. Elle parle pour lui, entamant une longue narration de leur exode.
L’odyssée a débuté quelques jours après l'indépendance lorsque l'homme, artisan maçon, découvre un matin que son unique ouvrier, musulman qu'il emploie depuis 10 ans, a été égorgé avec sa femme et leur fille de 18 mois par le F.L.N.
C'est le départ précipité vers le port le plus proche avec deux valises et leur fille de 4 ans. Refus de la marine nationale de les embarquer à Arzew, ils sont renvoyés sur Oran. Plus de 40 km en partie à pied. Les camions militaires refusaient de nous prendre à bord. C'est un paysan arabe avec sa vieille camionnette qui nous a sauvés,.
Ensuite, c'est le cauchemar d'Oran, le port inaccessible, I'atteinte interminable à La Senia. « On nous avait mis en garde contre les A.T.O, ceux qui nous ont le plus maltraités ce furent les gendarmes rouges, nous faisant défaire nos valises 5 à 6 fois de suite en jetant toutes nos affaires par terre, nous insultant et nous menaçant si nous protestions... J'ai cru que mon mari allait en étrangler un. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver à se contenir car I'autre cherchait à le provoquer. Si vous saviez ce que nous avons enduré sur ce terrain d'aviation, la chaleur la soif, l’angoisse de tout le monde, les enfants qui pleuraient, et ces militaires français qui nous injuriaient et nous brutalisaient ! Oui, des militaires français, quelle honte ». La femme pleure, I'homme reste figé, absent.
L’état dépressif de ce dernier a débuté quelques semaines après son arrivée à L... Ayant trouvé du travail comme manœuvre sur un chantier du bâtiment, il a dû interrompre au bout d'un mois, à cause de vertiges, et d'une fatigue croissante. « Depuis qu'il est en arrêt de travail, en raison d'un traitement antidépresseur, mon mari ne va pas mieux. Il dit qu'il n'a plus confiance en lui, qu'il est fini. Et c'est la seule phrase que j'obtiendrai du patient : « Je suis fini ! ».
Malgré tous les traitements, l'état mental s'aggrave. Ne pouvant plus monter sur des échafaudages, on l'a relégué dans des petits travaux de gardiennage avec un salaire très réduit.
« Cela l'a achevé» dit sa femme quelques semaines plus tard. Des électrochocs restent sans effet, au contraire le patient accuse maintenant des troubles de mémoire, se dit indigne de la société. Il ne pourra plus jamais travailler. Cette dévalorisation est un signe inquiétant.
Un soir, la femme du patient m'appelle au téléphone. Son mari n'a pas dormi depuis deux jours. Il refuse de continuer son traitement. Elle est inquiète. Je passerai ce soir un peu tard. Mais elle préfère le lendemain « pour ne pas réveiller sa fille. Car ils vivent à trois dans une pièce. Ce soir là j’ai manqué d'intuition. J'aurai dû me rendre auprès du patient même très tard. Car on vient me prévenir au petit matin que l'homme s'est pendu.
Chez un homme indemne de tout passé psychiatrique, au traumatisme de l'exode est venu s'ajouter l'indignation et I'humiliation ressenties devant I'attitude de l'Armée et de la police métropolitaines qui avaient retourné leurs armes contre la population Pied-Noir depuis plusieurs mois, laissant les bandes du F.L.N libres de se livrer à des enlèvements et des assassinats !
L’attitude indigne de ces soldats dans leurs camions, des gendarmes d'Oran, avait fini d'exaspérer cet homme pacifique. sa souffrance morale cachée, n'ayant pas trouvé à s'exprimer dans un environnement hostile ou indifférent, s'était retournée en agressivité contre lui-même, conduisant à ce geste auto-destructeur. « Il avait tout renfermé en lui» me dira plus tard Madame G dans une image simple mais vraie. Le mal était trop profond pour être accessible à une main secourable.
LE CAS DE MONSIEUR D...
Monsieur D... est un homme d'une quarantaine d'années, fonctionnaire de I'Enregistrement, qui se présente bien, c'est-à-dire simplement avec l'aisance naturelle d'un homme droit qui inspire confiance.
Il est porteur d'un volumineux dossier de radiologues, cardiologues, pneumologues, consulté pour une douleur rétro-sternale constrictive rebelle depuis 3 ans... Le diagnostic d'angine de poitrine reste en suspens, ce qui tourmente le patient : « je ne discute pas la compétence des spécialistes déjà consultes mais je n'ai pu échanger deux mots avec aucun d'eux »
Je saisis ce grief au vol. Il me paraît important. La profession ? Ses collègues de bureau sont très corrects avec lui à condition de ne jamais aborder le sujet de l'Algérie. Le mot douloureux est prononcé, ravivé par un événement récent : De Gaulle vient d’être réélu, la veille. Nous sommes en décembre 1965. Voyez-vous en dehors des meurtres et enlèvements, des ruines matérielles (depuis la confiscation des terres par Ben Bella en automne 963 mes beaux-parents sont complètement ruinés), ce qui malgré tout, nous affecte le plus, c'est le mépris avec lequel de Gaulle nous a traités. On peut opprimer, ruiner, anéantir une communauté d'hommes, ce sont les vicissitudes de I'Histoire, on n’a pas le droit de les humilier, eux et leurs ancêtres, par une cascade de mensonges dont on nous abreuve encore aujourd'hui. De penser que les métropolitains ont pu réélire cet homme, me bouleverse,.
Rompant avec ma réserve professionnelle. Je ne peux m'empêcher de dire à Monsieur D... à quel point je partage ses sentiments, ce qui encourage chez lui ce ton de confidence prolongé dont le patient avait besoin. En me quittant Monsieur D... me dit son soulagement (le mot est répété 2 ou 3 fois) d'avoir pu parler librement.
Revu chez des amis quelques semaines plus tard, Monsieur D.., me prend à part pour me dire que ses douleurs constrictives, mystérieuses ont complètement disparu. Devinez depuis quand - ajoute t-il avec malice - et bien c'est depuis la réélection de De Gaulle. Nous échangeons une longue poignée de main complice.
L’avenir confirmera que cette angine de poitrine était une projection d'un long conflit intériorisé d'une souffrance refoulée, que seule une compréhension globale du patient pouvait soulager. Si certains spécialistes se montraient un peu plus psychologues ? Mais peut être répondraient-ils que ce n'est pas là leur métier
CONCLUSION
A côté des conséquences matérielles et du stress de l'exode lui-même, nous avons vu apparaître, dans ces quelques observations, le rôle important joué par la honte et la colère chez beaucoup de rapatriés dans les perturbations psychosomatiques qu'ils ont présentées devant cette incroyable campagne de calomnies menée, conjointement, dans une alliance contre nature, par le parti communiste et le parti gaulliste.
Transformant les victimes en coupables, celle-ci était destinée par leurs auteurs à se dédouaner de toutes responsabilités dans cette tragédie. A la souffrance de cet exode, en catastrophe, résultant de la capitulation d'Evian, s'ajouta en métropole le temps de l'humiliation et du mépris : ce fut là le plus grand péché de la France.
Dr Pierre CATTIN
|
|
|
Piqûre de Rappel
Envoyé par M. Alain Algudo
|
|
LA GRANDE POSTE D’ORAN
5 JUILLET 1962
Il est 11h30. Le soleil règne sur la place de la Grande Poste. Une légère brise marine empêche encore la grosse chaleur de dominer l’atmosphère.
Brusquement, alors qu’un silence lourd, compact, inhumain, vient de s’établir pour une seconde, un immense tapage, comme un brusque coup de tonnerre, déclenche l’enfer sur le centre ville.
Plus de klaxons, plus de voitures, de vélos, de poussettes, un ouragan recouvre tous les bruits.
Des rues adjacentes, de la place, de partout, des femmes, des vieillards, des enfants, des hommes de tous âges, se mettent à courir de tous les côtés, en tous sens, se croisent, se bousculent, paraissant agir comme des déments.
Déjà le sang est omniprésent, il gicle des gorges ouvertes, des poitrines, des bras, des jambes, des visages défigurés. De profondes blessures transforment les êtres humains en mannequins rouges.
La foule, dense à cette heure, se rue vers la Grande Poste, espérant y trouver un quelconque salut. Les employés n’ont guère le temps de fermer les lourdes portes d’entrée, les tueurs sont déjà mêlés aux victimes.
Tous pénètrent comme des bolides dans le hall. En un instant, il n’y a plus d’employés des Postes, plus de visiteurs, plus de clients. Ce n’est qu’un grand troupeau poursuivi par des hordes de bouchers hurlant, fous de rage et massacrant tout être vivant !
Le sang est partout. Il recouvre les comptoirs, les tables, les tableaux, les vitres. Il coule à flots. Les postiers, mêlés aux clients, tentent en vain d’échapper à l’holocauste débutant.
Les clients, d’abord, sont abattus, malgré leurs hurlements de douleur et de terreur, leurs supplications. Les femmes ont les seins coupés, puis sont achevées. On leur arrache les yeux, le nez. Les visages ne sont plus, bientôt, que bouillies sanglantes…
Après les clients, les fonctionnaires des deux sexes, par centaines, sont achevés de la même manière. Beaucoup tentent de survivre, aveuglés par leur sang, ils courent dans les couloirs, les toilettes, les moindre recoins … Ils sont tous tués !
Un homme a tout vu, il a compris que son heure était venue. Il est préposé à la radio, tout en haut de l’édifice :
IL ENVOIE IMMÉDIATEMENT DES S.O.S. AU MONDE ENTIER. Le bruit du massacre lui parvient de plus en plus fort. Il déverse dans l’unique escalier de fer, seul moyen de l’atteindre, le contenu de tous les extincteurs d’incendie qu’il détient. IL SAIT QU’IL A PEU DE TEMPS POUR ALERTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES et reculer ainsi, le plus possible, l’échéance atroce qui l’attend.
Sa longue agonie commence ! Il appelle à l’aide la police, l’Armée, les Autorités navales de Mers-el-Kébir, les journalistes du monde… Par tous les moyens, il essaie de faire comprendre la situation dans laquelle se trouve Oran.
Il hurle au monde entier ce qui se passe à Oran, il hurle que l’enfer s’y est déchaîné, qu’une ville entière sombre dans la folie ! Aucune réponse. Les ordres venus de l’Autorité supérieure française « Ne rien faire quoi qu’il se passe » seront appliqués * !...
Les assassins, au pied de l’escalier, hurlent de rage et essaient, en vain, de monter les marches… Pendant longtemps, ils piétineront et se bousculeront avant d’y arriver…
Alors, lentement, l’homme comprend que tout est fini, que le monde entier, ce monde dit civilisé, abandonne à un sort atroce toute une population dont le seul crime est d’être française. Il persiste pourtant à appeler sans cesse AU SECOURS !
Rien… Seul le silence… Un silence de mort …Pas une seule réponse ! Un silence qui le condamne à mort, après la multitude déjà sacrifiée, par l’obéissance aveugle à des ordres criminels, au nom d’une prétendue discipline militaire qui, à ce niveau, n’est plus qu’une complicité avec des assassins !
D’un instant à l’autre, sa porte sera abattue. Il prie. C’est un croyant. Il revoit sa chère chapelle du Saint Esprit, de l’autre côté de la place où il allait si souvent prier avec sa famille…
La porte s’abat avec fracas, l’escalier vient d’être franchi. En un instant, il n’est plus qu’une boule de chair et d’os… Ce nouveau martyr, dernier fonctionnaire des Postes d’Oran, se nommait M. Brosse. Ce sacrifié là fut, comme des milliers de Français d’Oran, livrés à une barbarie sans nom le 5 juillet 1962. POURQUOI ?
Deux jours après que l’indépendance de l’Algérie soit déclarée par Charles De Gaulle ! Qui portera, dans l’Histoire, la responsabilité d’avoir donné, ou d’avoir fait appliquer les ordres criminels de non-intervention, bien que sachant parfaitement ce qui allait se passer, et s’est bel et bien passé !
L’Histoire est têtue comme l’est aussi LA VÉRITÉ. Elles doivent tout remettre en place !
SI LA JUSTICE EXISTE, IL FAUT QUE CETTE ABOMINATION SOIT RECONNUE ET EXPIÉE !
Témoignage retrouvé et transmis par Alain ALGUDO
Nous possédons une Attestation sur l’honneur du témoignage Lieutenant Colonel Robert FOURCADE, Officier de l’Ordre National du Mérite à titre militaire à qui le Général KATZ a déclaré : « Le 5 juillet 1962, j’ai été mis au courant dont étaient victimes un grand nombre de citoyen Français d’Oran : J’ai téléphoné personnellement au Général DE GAULLE pour lui rendre compte de ces assassinats et pour lui demander si je pouvais faire intervenir les troupes placées sous mon commandement afin de rétablir l’ordre dans la ville. Le Chef de l’État m’a répondu simplement : « SURTOUT NE BOUGEZ PAS ! » Et une fois de plus j’ai obéi. »
· Le Comité VERITAS a alors entamé, contre le général Katz, une procédure judiciaire pour OBÉISSANCE A DES ORDRES CRIMINELS. Malheureusement Katz est décédé pendant la procédure !
· Charles De Gaulle, donneur de cet ordre criminel, alors qu’à Oran se trouvaient 22.000 soldats français consignés dans leurs casernes dont la seule présence aurait empêché les massacres, serait-il considéré, comme RESPONSABLE, MAIS PAS COUPABLE ???
Et pourtant voilà ce qu’avait déclaré DE GAULLE lors de son discours à ORAN le 7 juin 1958 :
« OUI, OUI, oui, La France est ici pour toujours, elle est ici avec sa vocation millénaire qui s’exprime aujourd’hui en trois mot : Liberté, Égalité Fraternité….Vive ORAN, ville que j’aime et que je salue, bonne, chère, grande ville d’ORAN, grande ville Française. »
· Extrait des déclarations, entre autres, de Charles De Gaulle :
· « Moi vivant, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur Alger ! »
« Je ne livrerai jamais l’Algérie au FLN, cette clique de gens qui n’existent pas, et qui sont incapables de se gouverner »
Puis, le 3 juillet, dans ses félicitations à l’état algérien :
« Cette indépendance nous l’avons voulue et aidée ! »
Cerise sur le gâteau, définition du Gaullisme par Michèle Alliot Marie :
« Le Gaullisme, ça n’est pas la détestation de l’autre, au contraire, c’est la main tendue à l’autre »
Vous apprécierez !!
En souvenir de la petite Myrtille DUBREUIL qui, ce jour là, a perdu 14 membres de sa famille !
Alain ALGUDO ex Président fondateur Comités de Défense des Français d’Algérie
ex Vice Président du Comité et de la revue VERITAS VERITAS
Auteur de « Mon Combat »
|
|
Macron complice des mensonges algériens
|
| Mensonges, mensonges, veulerie, lâcheté. Que ce soit le président Emmanuel Macron où son historien officiel sur l’Algérie, lisez ce qui suit :
INFO LE FIGARO – À la demande de l’Élysée, l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a pris part ce jeudi à la commémoration du 17 octobre 1961. Un geste voulu par le président français pour raviver un dialogue gelé depuis des mois entre Paris et Alger.
À la demande de l’Élysée, l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a participé ce jeudi 16 octobre à une cérémonie d’hommage aux victimes des événements du 17 octobre 1961 organisé par la Ville sur le pont de Bezons à Paris.
La manifestation lancée à l’époque par le FLN pour protester pacifiquement contre un couvre-feu imposé aux Algériens – on est en pleine guerre d’Algérie – fut violemment réprimée par la police de Maurice Papon, faisant plus d’une centaine de victimes parmi les Algériens, dont beaucoup furent jetés dans la Seine.
« La France n’oublie pas ce jour sombre de son histoire »
Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron souhaitait envoyer deux messages à Alger : rappeler que « la France n’oublie pas ce jour sombre de son histoire », et souligner qu’il est désormais nécessaire de « dépasser la crise » qui paralyse les relations franco-algériennes. Stéphane Romatet, rappelé à Paris depuis avril 2025 alors qu’Alger venait d’expulser douze agents de l’ambassade de France, n’a toujours pas regagné son poste.
L’historien français Benjamin Stora, spécialiste de la colonisation de l’Algérie, revient dans cet entretien à TSA sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris.
Benjamin Stora, qui a récemment publié une bande dessinée sur le drame du 17 octobre 1961, évoque aussi les raisons du refus de la France de reconnaître ce massacre comme crime d’État, les raisons de l’acharnement de l’extrême droite sur les Algériens, l’éventualité d’un dégel dans les relations franco-algériennes après le départ de Bruno Retailleau du ministère de l’Intérieur…
Ce ne sont que des mensonges, ils me font honte. Aussi bien l’un que l’autre ne peut apporter la preuve de ce qu’ils commémorent. Je ne vais pas revenir sur mes explications détaillées lors des mois d’octobre des précédentes années mais enfin 2 à 300 cadavres d’Algériens jetés dans la Seine et « ils ont tous disparus » et pas un seul retrouvé sur une berge entre Paris et Rouen par des enquêteurs d’État. La Seine les a dissous.
Bizarre non ? Il y a quelques jours, 4 ou 5 corps ont été vus flottant sur la Seine par le passager d’un métro. Eux non pas disparus, c’est étrange.
Pas une seule famille de ces 2 à 300 Algériens jetés dans la Seine n’a déposé ne serait-ce qu’une requête pour obtenir, par exemple, une compensation pour ce soi-disant massacre.
D’octobre 1961 jusqu’à la parution du livre La bataille de Paris, du communiste Jean-Luc Einaudi, paru en 1991, qui aurait révélé au grand public ce massacre après des recherches approfondies (il les a certainement découvert au fond du fleuve !), aucun gouvernement ou président n’a commémoré ce massacre qui n’existait pas : ils n’en avaient jamais eu connaissance… Oui, j’ai dit bizarre.
Que de mensonges, que de lâcheté.
Manuel Gomez
20 octobre 2025
|
|
11 NOVEMBRE 1918-11 NOVEMBRE 1908
|
Discours du Premier ministre à l’occasion
du 90ème anniversaire de l’Armistice
Mesdames et messieurs,
Le onze novembre 1918, la guerre déroulait encore sur cinq cents kilomètres de front ses tranchées de souffrances. C’était une guerre comme l’homme n’en avait jamais connu, si terrible qu’elle semblait épuiser le monde, et qu’on doutait de pouvoir un jour en guérir les blessures.
Aux campagnes les plus riches de France et de Belgique, elle avait substitué un désert de boue, hérissé de moignons d’arbres ; à des peuples heureux, des cohortes d’hommes harassés, transis d’angoisse.
Sur beaucoup d’entre eux, elle avait laissé sa marque - bras et jambes arrachés, visages détruits, regards absents. A beaucoup d’autres, encore, elle avait pris la vie.
L’imagination, mesdames et messieurs, nous dresse de la guerre de 1914 un tableau effrayant. Elle reste tragiquement en dessous de la réalité. A quelque source qu’on puise - photographies, croquis, témoignages - la vérité de la guerre se révèle plus dure, plus cruelle, plus longue aussi que nos esprits ne parviennent à l’admettre.
Le 11 novembre 1918, l’épuisement secondant les armes, cette guerre prenait fin.
Notre pays en sortait vainqueur, mais l’immense élan de gloire et d’allégresse ne pouvait couvrir le témoignage des survivants et la plaie sanglante de l’hécatombe.
L’Armistice était promis. Il fallait fixer un lieu pour le conclure. Le maréchal Foch le voulait symbolique. Il le voulait distant de la confusion des combats. Au gré des opérations, il avait conduit aux abords de Compiègne le wagon qui abritait son propre Quartier Général.
Pour évoquer le choix de cet emplacement, en forêt de Rethondes, le général Weygand trouva des mots justes : "La solitude du lieu, écrivit-il, assurera le calme, le silence, l’isolement, le respect de l’adversaire". Calme, silence, respect de l’adversaire : tels sont les sentiments que le lieu continue d’inspirer, et que nous venons y ressentir à notre tour, au fil de notre propre histoire.
Depuis 1918, le 11 novembre symbolise la fin de la Première guerre mondiale.
Ce jour là, l’agitation de notre époque s’estompe, le tracas de l’actualité s’interrompt pour laisser place au recueillement, à la communion nationale.
Dans chaque commune de France, devant chaque monument, devant tous ses noms qui s’alignent sous nos yeux, la même émotion s’installe. La même gravité.
Deux circonstances lui rendent, cette année, une force particulière.
Le 11 novembre 2008, nous célébrons le 90e anniversaire de l’Armistice.
Trois générations nous séparent à présent de ce passé dont nous faisons mémoire. Leur ayant survécu l’une après l’autre, Lazare Ponticelli, le dernier poilu français, mourrait il y a huit mois.
Mesdames et messieurs,
Ces circonstances nous interrogent. Quel sens conservent nos cérémonies, après 60 ans de paix européenne ? Devons-nous perpétuer plus longtemps le souvenir d’un passé désormais sans témoins ? Le 11 novembre doit-il mourir, avec la mort de ses derniers acteurs ?
A ceux qui doutent aujourd’hui de la valeur de cette cérémonie, et de la portée du geste national qu’elle constitue, je suis venu apporter la réponse de la République. Cette réponse s’adresse à tous, jeunes et vieux, civils et militaires. Et elle est catégorique.
Le temps n’efface pas notre dette à l’égard de ceux qui donnèrent leur jeunesse pour notre liberté. Il n’efface pas le sens du sacrifice - et il fut immense, chez ces hommes qui offraient leurs vies pour la France, quand leurs familles offraient, à l’arrière, leur attente et leur peur.
Le temps n’efface pas le sens de l’héroïsme - et jamais sans doute, dans l’histoire de la France, il n’y eut tant de héros que dans les tranchées de 1914 !
Héros, ceux qui chargeaient à la baïonnette, sous les balles.
Héros, ceux qui creusaient, se terraient et tenaient sous le fracas des obus.
Héros, ceux qui feignaient la confiance, pour ne pas gagner les autres à leur désespoir.
Héros ceux qui se battirent, non parce qu’ils voulaient la guerre mais parce qu’ils aimaient la paix.
Non, le temps n’efface pas leur courage !
Le temps n’efface pas la solidarité nationale, qui pressait un pays entier derrière ses troupes, et qui, avec elles, se refusait à l’invasion.
Le temps n’efface pas la fraternité humaine ; et j’insiste sur ce sentiment si puissant qui est peut-être la raison la plus forte de notre présence ici.
Je crois que dans la fièvre de la mobilisation, beaucoup de Français sont partis en guerre avec, au cœur, la haine de l’adversaire. Ils en sont rentrés avec le respect des Allemands.
Là où ils croyaient combattre un peuple impitoyable, ils avaient rencontré des hommes ; ils avaient partagé leurs blessures ; ils avaient côtoyé leurs fatigues.
A la même époque, nos soldats venus de métropole et d’outre-mer nouaient dans le sang, avec leurs alliés belges, italiens, portugais, russes, anglais, canadiens, australiens, américains - et tant d’autres encore - la plus mémorable des alliances.
On n’efface pas, même en 90 ans, même en un siècle, les effets d’une pareille épreuve.
On n’efface pas, même en 90 ans, le sentiment profond de commune appartenance qui lie les peuples entre eux, quand ils ont touché du doigt le danger mortel de leur propre acharnement.
Je parle ici en tant que Premier ministre, pour rappeler, sans passéisme et sans nostalgie guerrière aucune, la force de cette conscience historique. Profondément positive, cette conscience nous invite à nos responsabilités et nous incite chaque jour à construire pour le meilleur de l’humanité.
Si depuis cinquante ans, nous bâtissons l’Europe, ce n’est pas parce que nous avons oublié la guerre, mais parce que son souvenir bien vivant nous interdit de la laisser renaître.
Si la mort du dernier poilu nous adresse une injonction claire, ce n’est pas de tourner la page de la guerre contre l’Allemagne - cette page est tournée, en politique et dans nos cœurs, depuis plus de soixante ans.
Ce n’est pas non plus d’abandonner une commémoration dans laquelle les derniers combattants eux-mêmes, tant qu’ils vécurent, voyaient une marque indispensable de respect pour leurs frères. C’est au contraire de préserver notre mémoire collective, au-delà des individus et des générations ; de lui trouver de nouveaux relais ; de l’inscrire dans les rites et dans les rythmes d’une société différente ; de chercher pour elle les expressions nouvelles qui la tiendront vivante.
La mémoire de la Première Guerre mondiale doit être une mémoire agissante. Elle doit nous guider, dans les choix politiques qui sont les nôtres. Elle doit amplifier l’idéal européen. Elle doit prévenir les tentations qui hantent notre époque - l’extrémisme national, les propagandes morbides de la défiance et de la haine. C’est la condition même de notre liberté.
C’est dans la pleine reconnaissance des lumières et des ombres du passé que notre nation s’instruit et se grandit. Les peuples courageux, les peuples lucides, les peuples libres connaissent leur histoire !
Ils savent l’étudier et l’approfondir ; ils savent l’honorer et la partager ; ils savent la juger et la condamner parfois ; l’occulter, jamais !
Parce que la guerre de 1914-1918 fut une épreuve atroce, certains voudraient que le temps nous en libère ; mais les Français sont-ils prisonniers de leur mémoire ? Non, ils ne le sont pas, et je veux, bien au contraire, qu’ils en soient les gardiens. Je veux, en particulier, que dans les écoles de France, l’enseignement de la Première Guerre ne sépare jamais son horreur d’une part de fierté et de reconnaissance. Cette reconnaissance et cette fierté, nous la devons à nos aïeux, qui, dans le feu de la guerre, pensaient à ceux qui les suivraient.
Nous la devons aussi notamment à nos soldats. Eux, qui, aujourd’hui encore, à travers le monde, engagent leurs vies dans les combats du droit et de la sécurité internationale.
Je rends à leur esprit de dévouement, à leur patriotisme et à leur professionnalisme l’hommage de l’Etat. Ils perpétuent les traits valeureux d’une nation libre et souveraine.
Trois générations après l’Armistice, ma présence, à Rethondes, au nom de la France, prouve la force de notre fidélité. Cette commémoration renouvelle notre mission de transmettre. Notre devoir de ne jamais éteindre la flamme du souvenir. Sous les litanies douloureuses de noms égrenés devant nos monuments, je souhaite que chacun puisse entendre les cris et les voix entrelacés de la France rassemblée, de l’Europe fraternelle, et des peuples en paix.
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
90ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Nécropole Nationale de Douaumont - Meuse
Mardi 11 novembre 2008
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Vos Altesses royales,
Monsieur le Président de la Commission Européenne,
Monsieur le Président du Parlement Européen,
Messieurs les Présidents des Assemblées parlementaires,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Il y a 90 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1918, prenait fin la première guerre mondiale 65 millions d’hommes mobilisés. 8 millions et demi de morts.21 millions de blessés, 4 millions de veuves, 8 millions d’orphelins. Voilà ce que fut le bilan de cette guerre.
Pour comprendre ne regardons pas que les chiffres, certes énormes, mais aussi la douleur infinie de chaque victime, celle de l’enfant derrière le cercueil de son père, celle du père, de la mère auxquels on annonce la mort de leur fils, la douleur de l’épouse qui reçoit la dernière lettre de son mari après qu’il a été tué.
Derrière chaque maison détruite, chaque village anéanti, il y avait une blessure profonde qui ne s’est jamais refermée.
Derrière chaque deuil, dans le coeur et dans l’âme de chaque veuve et de chaque orphelin, il y avait une souffrance qui ne s’est jamais éteinte.
Ces blessures, ces souffrances, nous ne devons en oublier aucune.
La France n’oubliera jamais ses enfants qui se sont battus pour elle. Elle n’oubliera jamais le sang versé sur la Marne, sur la Somme, à Verdun, au Chemin des Dames par les tirailleurs venus d’Afrique du Nord, d’Afrique Noire, de Madagascar, d’Indochine.
Elle n’oubliera jamais les soldats anglais, écossais, irlandais qui se battirent sur son sol comme ils se seraient battus sur le sol de leur propre patrie.
Elle n’oubliera jamais les soldats américains, canadiens, australiens, néo-zélandais, indiens tombés si loin de leur pays pour défendre sa liberté.
Elle n’oubliera jamais les soldats italiens, ni les belges, ni les luxembourgeois, ni les portugais, ni les grecs, ni les serbes, ni les monténégrins, ni les roumains, ni les russes qui se sont battus à ses côtés avec le même courage, qui ont affronté les mêmes épreuves, consenti les mêmes sacrifices au nom de la même grande cause, celle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Mais aujourd’hui, en ce 11 novembre 2008, alors que presque tous les témoins de cette tragédie ont disparu, alors qu’en France le dernier soldat survivant de cette guerre atroce n’est plus, alors que les haines se sont éteintes, que l’esprit de revanche a disparu, que nul parmi ceux qui se sont tant combattus ne songe plus à dominer l’autre, le temps est venu d’honorer tous les morts.
Nous voici réunis ici, représentants de toutes les Nations qui s’affrontèrent pendant quatre ans dans la plus atroce des guerres, sur ce qui fut le champ de bataille de Verdun, sur cette terre où furent versées tant de larmes et tant de sang, devant ces milliers de tombes toutes semblables, devant cet ossuaire où dorment ensemble pour l’éternité, sans que l’on puisse les distinguer les uns des autres, 130 000 soldats inconnus, amis et ennemis, que la mort a uni comme si elle avait voulu faire la leçon aux vivants.
Si nous sommes réunis ici où un jour un Président de la République française a mis fraternellement sa main dans la main d’un Chancelier d’Allemagne, ce n’est pas pour célébrer la guerre. Ce n’est même pas pour célébrer la victoire d’un camp contre l’autre.
Si nous sommes réunis c’est d’abord pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu jusqu’à l’extrême limite de leurs forces avec dans le coeur l’amour de leur patrie et la conviction de défendre une juste cause.
Sans rien oublier, sans rien renier, chaque nation rendant à ses héros l’hommage qu’elle leur doit, chacune se souvenant que cette guerre fait partie de son histoire, qu’elle en fut un moment terrible mais fort, nous devons tirer de ce qui s’est passé pendant ces quatre années terribles une leçon pour la conscience humaine.
Car cette guerre ne fit pas seulement peser une menace sur la vie et le bonheur de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Elle fut la première qui menaça à ce point l’idée même d’humanité.
Dans la boue des tranchées, parmi les rats et la vermine, sous la pluie incessante des obus, montant à l’assaut face aux mitrailleuses en piétinant les corps des morts, tenus en éveil la nuit par les cris atroces des blessés abandonnés entre les lignes, les soldats pour survivre sentaient qu’ils devaient faire taire en eux leur part d’humanité.
Le miracle fut qu’ils restèrent des hommes et qu’au milieu de tant de sauvagerie, leur conscience demeura éveillée. Le miracle fut que ces hommes jetés au milieu de l’enfer continuèrent jusqu’à la fin d’être sensibles à la souffrance. On vit jusqu’au bout des larmes couler sur ces visages farouches quand la mort frappait à côté d’eux. On vit jusqu’au bout ces soldats qui avaient appris à endurer les pires épreuves écrire à leur famille les lettres les plus émouvantes en pensant à chaque fois que c’était peut-être les derniers mots d’amour qu’ils leur adresseraient. Et ils voulaient que ces mots fussent plus forts que la mort. On vit jusqu’au bout ces soldats qui côtoyaient tous les jours la douleur et la mort se soutenir, s’entraider. On les vit sortir des tranchées la nuit au péril de leur vie pour aller chercher des blessés.
Ces hommes ne devinrent pas des machines, ils ne devinrent pas des monstres. Ils restèrent des hommes. Des hommes courageux, des hommes de devoir, mais des hommes qui souffraient, des hommes qui eurent peur, des hommes qui aimaient. Des hommes avec un coeur, avec une âme, avec une conscience. La guerre les avait endurcis, mais aussi horrible fut-elle, elle ne tua jamais en eux ce qu’il y avait de plus profondément humain.
Ils furent grands ces soldats qui endurèrent les pires souffrances. Ils affrontèrent les plus grands dangers. Ils consentirent aux plus grands sacrifices.
Ils furent grands ces soldats tombés la face contre terre, dans la boue des tranchées.
Ils furent grands ces survivants défigurés, mutilés, hantés par le souvenir de leurs terribles souffrances et par les fantômes de ceux qui étaient tombés à côté d’eux.
Ils furent grands ces survivants qui rentrèrent chez eux avec le regard triste de ceux qui sont condamnés à vivre avec le souvenir du malheur.
Ces héros embrassèrent leurs parents, leur femme, leurs enfants et ils se remirent au travail, en silence, ne parlant de la guerre que pour dire « plus jamais ça », et contemplant de temps en temps quelques photos jaunies où les sourires des morts se mêlaient à ceux des vivants.
Ils avaient dit « plus jamais ça ». Ils avaient voulu que ce fût la dernière des guerres.
Ils ne furent pas entendus. Pour que l’on comprenne enfin ce qu’ils avaient voulu dire, il fallut une tragédie pire encore dont les fils avaient été secrètement tissés par les souffrances de la Grande Guerre. Ce fut comme une sorte d’accomplissement dans l’horreur, l’expression d’une volonté d’anéantissement total de la personne humaine, si violente qu’elle entraîna enfin un sursaut de la conscience universelle.
La construction de l’Europe, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Organisation des Nations Unies, après tant de drames, après tant de folies meurtrières et totalitaires, sont les plus belles traductions de ce sursaut de la conscience.
C’est sur le sang versé par les soldats de la Grande Guerre, sur le témoignage de ce qu’ils ont enduré et sur le sort tragique des millions de victimes de la deuxième guerre mondiale, sur la douleur qui accompagna jusqu’à leur dernier jour ceux qui survécurent à l’enfer des tranchées et sur la blessure que garderont toujours au fond d’eux-mêmes les rescapés des camps d’extermination, que s’est construit le grand rêve de fraternité humaine, le grand rêve de paix, de compréhension, de respect, de solidarité entre les hommes qui est aujourd’hui ce que nous avons de plus beau, de plus grand, de plus fort à opposer au retour de la barbarie.
Souvenons-nous de leur souffrance, elle est la clé de notre salut.
Souvenons-nous que cette souffrance fut une souffrance partagée et que la douleur de ceux qui pleurent un fils, un mari, un frère est la même partout.
90 ans après la fin de la Grande Guerre je veux rendre hommage à tous ceux qui se sont battus dans l’honneur et la dignité.
J’irai tout à l’heure m’incliner dans le cimetière allemand au nom de l’amitié qui unit aujourd’hui le peuple français et le peuple allemand qui après s’être tant combattus ont décidé de regarder ensemble vers l’avenir.
Je penserai à cette jeunesse qui n’ira plus mourir en masse sur les champs de bataille parce qu’en venant se recueillir sur ces tombeaux elle saura que le combat pour la paix est le plus beau combat de l’homme et qu’il n’est jamais gagné.
Je penserai aussi à ceux qui n’ont pas tenu, à ceux qui n’ont pas résisté à la pression trop forte, à l’horreur trop grande et qui un jour, après tant de courage, tant d’héroïsme sont restés paralysés au moment de monter à l’assaut. Je penserai à ces hommes dont on avait trop exigé, qu’on avait trop exposé, que parfois des fautes de commandement avaient envoyé au massacre et qui un jour n’ont plus eu la force de se battre.
Cette guerre totale excluait toute indulgence, toute faiblesse. Mais 90 ans après la fin de la guerre je veux dire au nom de la Nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s’étaient pas déshonorés, n’avaient pas été des lâches mais que simplement ils étaient allés jusqu’à l’extrême limite de leurs forces.
Je veux dire que la souffrance de leurs épouses, de leurs enfants fut aussi émouvante que la souffrance de toutes les veuves et de tous les orphelins de cette guerre impitoyable.
Souvenons-nous qu’ils étaient des hommes comme nous avec leurs forces et leurs faiblesses. Souvenons-nous qu’ils auraient pu être nos enfants. Souvenons-nous qu’ils furent aussi les victimes d’une fatalité qui dévora tant d’hommes qui n’étaient pas préparés à une telle épreuve. Mais qui aurait pu l’être ?
Tous les pères emportés dans cette horrible guerre auraient pu écrire à leur fils avant de mourir: « Tu viens d’avoir neuf ans. Trop jeune encore pour participer à la guerre, tu es assez grand pour avoir l’esprit marqué de ses souvenirs, assez raisonnable pour comprendre que c’est toi, c’est vous les enfants de neuf ans qui aurez plus tard à en mesurer les conséquences et à en appliquer les leçons.
C’est pour que tu te souviennes, que j’accepte volontiers les angoisses de l’heure, tous les risques et la séparation plus cruelle que tout. »
Tous ces pères, quel que soit l’uniforme sous lequel ils ont combattu, quel que soit le drapeau qu’ils ont défendu, nous leur devons le respect et nous nous devons de nous souvenir d’eux parce qu’ils sont nos pères à tous.
11/11/2008
F. Fillion et N. Sarkozy
|
« … Tout commence avec de l’eau… bénite. Le 25 décembre 496, jour de Noël, le roi Clovis est baptisé en la cathédrale de Reims. Ce signe de la croix tracé sur le front du monarque marque l’entrée du royaume des Francs dans l’Église catholique. La France est devenue « fille aînée de l’Église ». Mais l’expression « France, fille aînée de l’Église » apparaît pour la première fois lors du prêche prononcé le 14 février 1841 par le père dominicain Henri-Dominique Lacordaire à Notre-Dame de Paris… Puis c’est Jean-Paul II, en voyage apostolique en France, qui popularisa cette formule, lors d’un discours au Bourget en juin 1980. Il évoqua ce titre de fierté, avant de demander aux fidèles réunis : « France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle à ton baptême ? ». (« Le Figaro » 14 avril 2022)
En février 2024, un sondage publié par le « Journal du Dimanche » nous apprenait que, pour 83 % des Français, la France était « un pays de culture et de tradition chrétiennes ». Ce chiffre, dans un pays qui met la sacro-sainte laïcité à toutes les sauces, était à la fois surprenant et réconfortant. La France est catholique depuis plus de 2000 ans, depuis le baptême de Clovis. Notre pays est parsemé d’églises et de calvaires. L’art roman est né en 950 et il a été supplanté par l’art gothique ou ogival au cours du XIIe siècle. L’Église nous a laissé de nombreux chefs-d’œuvre, de pures merveilles, comme Notre-Dame, le Mont-Saint-Michel ou la basilique de Rocamadour, pour ne citer que les plus connus.
Mais depuis la funeste Révolution, le catholicisme s’est étiolé en France. Aujourd’hui, nos églises sont désespérément vides. L’épiscopat français est majoritairement « progressiste », il penche à gauche. Il est même devenu « muslim friendly ». Chaque semaine, des calvaires, des statues de la Vierge sont vandalisées, des églises sont saccagées ou incendiées. Tout le monde sait parfaitement qui se cache derrière ces forfaits. Mais l’épiscopat français ne veut pas nommer les coupables. Nos curaillons modernes, giflés sur la joue droite, tendent la joue gauche en serrant les fesses.
Alors, comment expliquer que 83 % des Français revendiquent leur culture chrétienne ?
Ce n’est certes pas un vote d’adhésion puisque notre pays est fortement déchristianisé (3 % des Français se disent catholiques pratiquants). Non, il s’agit, en réalité, d’un vote de protestation, contre les mosquées, contre les prêches haineux de certains imams, contre l’abaya, le voile, etc.
Mais, dans tous les domaines, les élites intellectuelles se moquent de l’avis et des désirs du vulgum pecus. Nous venons d’en avoir – encore ! – une triste illustration : le 1er octobre, le Conseil Supérieur de l’Éducation adoptait – par 44 voix contre 7 ! – un amendement qui prévoit de remplacer les appellations « vacances de Noël » et « vacances de la Toussaint » par des termes plus laïques. C’est une tentative – une de plus ! – pour déraciner la jeunesse française de l’histoire et de la mémoire spirituelle qui l’ont façonnée. Détruire le catholicisme en France est une vieille lubie de la franc-maçonnerie, qui remonte à l’époque des Lumières. Cette lutte est à l’origine de la Révolution. Il a suffi d’agiter le chiffon rouge pour qu’une partie du bas peuple, pauvre et affamé, veuille se venger de la richesse, de la puissance et de l’arrogance du haut clergé. Ensuite, cette haine de l’Autel a débouché sur des décisions ridicules, qui d’ailleurs ne survivront pas à la Révolution : imposer un calendrier républicain pour supprimer les fêtes chrétiennes était stupide, mais transformer la cathédrale Notre-Dame de Paris en Temple de la Raison était, en revanche, un sacrilège. Depuis la prise de la Bastille, toutes les surenchères étaient permises : le conventionnel Rühl brise la Sainte Ampoule dans la cathédrale de Reims. On change le nom des villes si ce nom fait référence à un saint : Saint-Malo, par exemple, devient Port-Malo, Saint-Denis devient Franciade… Mais, puisqu’on avait pris l’habitude de bouffer du curé et de tuer la superstition, il eût été dommage de s’arrêter en si bon chemin! On avait commencé, le 4 novembre 1789, par la confiscation des biens du clergé, puis la Terreur avait détruit les temples et tué bon nombre de curés non-jureurs.
L’œuvre de déchristianisation de la France était en marche, elle n’allait plus s’arrêter : c’est d’abord Émile Combes, franc-maçon qui doit ses brillantes études aux institutions catholiques et qui, par la loi du 7 juillet 1904, interdit aux congrégations d’enseigner.
Il fait fermer, en quelques jours, 2500 écoles religieuses. C’est le général André, qui, le 4 novembre 1904, est giflé à la chambre par le député nationaliste Syveton ; point d’orgue de la fameuse affaire des fiches. C’était sous la IIIe République, la République des francs-maçons (on évaluait à 30 000 le nombre des F.M. dans les instances politiques, dont 250 députés et 200 sénateurs). Le général André dut démissionner et, après lui, le gouvernement Combes. C’est la loi de séparation de l’Église et de l’État, d’Aristide Briand, le 9 décembre 1905 et le scandale des inventaires qui se dérouleront dans un climat de guerre civile. C’est la condamnation de l’Action Française par Pie XI, le 25 décembre 1926 ou, plus exactement, l’interdiction faite, en 1927, aux adhérents de l’AF, de recevoir les sacrements de l’Église. Ce drame va déchirer des familles et troubler les consciences. Cette condamnation sera levée par S.S. Pie XII en 1939, mais le mal était fait : la blessure était profonde, elle ne cicatrisera jamais totalement. C’est le Concile Vatican II, commencé sous Jean XXIII en 1962 et clôturé sous Paul VI en 1965, qui va prôner l’œcuménisme, abandonner le rite tridentin et le latin – langue universelle de l’Église – provoquant une forte crise des vocations et, en corollaire, une désertification des séminaires, des couvents et… des églises. Et, puis, comme un clou chasse l’autre, c’est la montée en puissance de l’islam en France (comme dans tout l’Occident chrétien).
La franc-maçonnerie et les courants progressistes utilisent les musulmans comme troupe de manœuvre. Ils commettent une grave erreur qu’ils paieront tôt ou tard au prix fort : l’islam est une religion forte ; une religion qui n’aime pas les mécréants. Les musulmans ont une revanche à prendre sur la Reconquista qui les a chassés de Grenade en 1492. Ils se battent depuis la nuit des temps. Fanatisés par l’Islam qui promet à ses martyrs, 72 houris (حورية,) au paradis d’Allah, ils font la guerre pour la gagner et ne craignent pas d’y laisser leur peau. Ils mènent une guerre sainte, le Djihad (جهاد) pour que le Dar al-Harb, le domaine de la guerre ( دار الحرب) devienne un jour le Dar al-Islam ou domaine de la soumission à Dieu (دار الإسلام). Ils savent ce qu’ils veulent et ne s’en cachent pas !
Paradoxalement, mon irritation, ma colère, n’est pas qu’à l’encontre des frères-maçons, de l’islam conquérant, ni même des islamo-gauchistes de Mélenchon. Ces gens-là sont des ennemis de mes valeurs mais ils ont un but précis et se donnent les moyens d’arriver à leurs fins.
J’en veux à tous ceux qui ont laissé faire, subi ou carrément collaboré : j’en veux à Giscard d’Estaing qui ne voulait pas entendre parler de racines chrétiennes dans la Constitution européenne ; j’en veux à Chirac pour qui « la France est une grande nation musulmane » ; j’en veux à Bergoglio qui, par provocation, lavait les pieds de 12 musulmans à Pâques ; j’en veux à Marine Le Pen qui se veut chantre de la laïcité républicaine et n’a « pas de problème avec l’islam » ; j’en veux, bien sûr, à Macron qui conteste la culture française et lèche les babouches de Tebboune ; j’en veux aussi à tous ces maires qui achètent leur réélection (ou tout simplement la paix sociale) en cédant devant les revendications identitaires. Par veulerie, démagogie ou clientélisme électoral, ces gens-là acceptent tout, au nom de la laïcité (maçonnique) qui serait, prétendent-ils, gage de liberté. Une liberté qui n’implique plus aucun devoir, seulement des droits individuels. « La liberté du fou s’appelle folie, celle du sot, sottise, celle du bandit, banditisme, celle du traître, trahison, et ainsi de suite… » disait Charles Maurras. J’ai envie de rajouter que celle du con s’appelle connerie et qu’elle est en train de prendre le pas sur toutes les autres ! « Liberté, que de crimes on commet en ton nom ! ». Cette citation célèbre de Manon Roland, avant de monter sur l’échafaud, reste d’une brûlante actualité !
Je ne suis ni donneur de leçons, ni calotin, ni cul-béni, mais, qu’on le veuille ou non, notre civilisation s’est construite sur le décalogue. Les dix commandements de l’Église sont à l’origine de nos lois et de cet ordre social chrétien cher à La Tour du Pin et qui est la base du catholicisme social. Saint Vincent de Paul n’a pas attendu Kouchner ou l’abbé Pierre pour venir en aide aux plus démunis. D’ailleurs ceux-là confondent allègrement la redistribution socialiste avec la charité.
Parmi mes amis, je compte des catholiques, des protestants, des israélites, des agnostiques et des athées. Pas un, pas UN SEUL, ne conteste nos racines chrétiennes. Ils savent tous ce que notre pays doit à l’Église catholique. Ils savent aussi que le Code Napoléon – notre Code Civil – a été dicté par le décalogue chrétien. « Chassez le christianisme et vous aurez l’Islam » disait Chateaubriand en… 1828. Nous y sommes, ou plutôt, nous y venons, comme la Belgique, l’Espagne ou l’Angleterre.
Le Conseil Supérieur de l’Éducation n’a-t-il pas d’autres chats à fouetter que de se soucier de rebaptiser (pardon : de renommer car le baptême sent l’eau bénite !) les fêtes chrétiennes ? Il est en partie responsable de la baisse constante du niveau des jeunes Français. Notre dégringolade dans les classements PISA en est une preuve incontestable (et incontestée). C’est à ce genre d’officine de gauche que l’on doit le délitement de notre Éducation nationale, jadis citée en exemple. Aujourd’hui elle est devenue La fabrique du crétin (1).
Eric de Verdelhan - 4 octobre 2025
1)- « La Fabrique du crétin — Vers l’apocalypse scolaire » ; excellent livre de Jean-Paul Brighelli : Éditions de l’Archipel ; 2022
|
|
LES FAUSSAIRE DE L'HISTOIRE
Par VERITAS N°77 novembre 2003
|
|
L’HOMME QUI DETOURNAIT LA TÊTE
Romancier et moraliste catholique, académicien, prix Nobel de littérature en 1952, François Mauriac est un écrivain de talent, célèbre, décoré, empanaché, qui affiche sa catholicité comme une panoplie de la « grâce » qui lui rallie tous les bien-pensants et toutes les bonnes âmes depuis plus d'un demi-siècle. Mais certains troublés par un visage trop mobile
Mauriac évoque un de ces pieux personnages du Gréco qui sentent le soufre et flottent dans une apesanteur qui permet, la foi irradiant leur visage, d'innombrables voltes, évolutions et mutations, écrit son biographe Jean Lacouture ( Mauriac, Le Seuil - 1980 - page 444). Mauriac a, comme Claudel, I'orgueil incommensurable du théologien qui connaît Dieu, mais, tandis que I'un veut nous le révéler dans le torrent impétueux de son théâtre, Mauriac, lui, nous promène dans les méandres d'un jansénisme mondain pour traquer, partout et toujours, inlassablement, le péché.
Mais, hélas, piège du démon, ce péché, il ne voit pas qu’il est en lui, sous la forme d'une modestie trop emplumée pour être chrétienne. Peu continent de langage, il parle toujours inlassablement de lui-même, dans une vaine infatuation de babil, se gobant et se regobant sans jamais se trouver indigeste :
« Si jamais je survivais, je sais bien que ce ne serait pas moi puisque même de non vivant, je ne suis pas cet homme que les autres imaginent et que je ne sais pas, moi-même ; qui je suis, (« Cinquante ans » NRF 1939). Egotisme aurait dit Stendhal, nombrilisme dit-on plus platement aujourd'hui, ou plus simplement, radotage pour les insolents...
Sur le plan social, ce grand propriétaire terrien, seigneur bordelais de la Terre de Malagar, ultra conservateur de l'ordre social, va porter à un haut degré de perfection la grimace humanitaire. Celle qui fait verser à une certaine bourgeoisie parisienne, bien nantie, des larmes médiatisées dans sa vaisselle d'argent sur les malheurs du prolétariat ; celle qui, de nos jours, pousse les vedettes cossues du Tout Paris, à ôter leur cravate pour descendre dans la rue s'encanailler sous l'œil attentif des caméras, avec la foule des sans papiers.
Mais, dans les années cinquante, la mode qui faisait fureur chez les grands bourgeois de droite, consistait à flirter avec la gent de gauche, celle qui, paraît-il, a le privilège du cœur. Ainsi Mauriac, chroniqueur habituel du « Figaro », symbole de la droite en prière, venait, en catimini, à « l'Express », nouveau porte-drapeau de la gauche pensante, pour y faire paraître son fameux « bloc-notes », bien caché à la dernière page de cet hebdomadaire, pensant, sans doute, qu'ainsi, Dieu ne le verrait pas. « Il venait souvent à la rédaction avec un frisson tout maurrassien de plaisir un peu équivoque, au moment ou il balançait entre le Figaro et I'Express. Il m'a avoué un jour, dans un soupir, qu'il était bien agréable de pouvoir se rendre ainsi du domicile conjugal au boudoir de sa maîtresse, (Pierre Viansson Ponté in l'Express du 05.09.1970 - cité par Jean Lacouture dans son « Mauriac » o.c.)
L'attitude de cette grande conscience chrétienne, si pleine de droiture, dans la tourmente qui va agiter le Maroc, puis l'Algérie dans les années cinquante, va être conditionnée par l'offre que vont faire les nationalistes arabes au lauréat du prix Nobel d'assurer la présidence de l'association France-Maghreb. Celle-ci, regroupe déjà certains prêtres fanatiques du Prado, des futurs porteurs de valises, des intellectuels qui se définissent comme tels et va devenir le laboratoire ou s'élabore la propagande antifrançaise la plus virulente et le soutien au terrorisme le plus aveugle, celui qui va s'abattre sur les personnalités musulmanes francophiles autant que sur les communautés européennes chrétiennes d'Afrique du Nord.
Mauriac ne connaît rien au Maroc où il n'a jamais mis les pieds. Il ignore totalement l'œuvre exceptionnelle accomplie par la France dans ce pays et attestée, entre autres, par deux témoignages de poids : « Sans l'aide de la France, le Maroc était perdu. Grâce à elle, l'autorité chérifienne a été rétablie et un « Maghzen », Etat digne de ce nom a été constitué. En retour de ses bienfaits, la France peut compter sur ma collaboration la plus sincère. Ainsi déclarait au journal Le temps, le Sultan Moulay Youssef, contemporain de Lyautey et père de Mohamed V. (Pierre Montagnon « La France coloniale », Pygmalion 1988 - tome 1 - page 339).
Il faut se rappeler que le Maroc, dont nul homme de bonne foi ne parcourt aujourd'hui les champs et les montagnes sans admiration stupéfaite, était, il y a quarante ans, un pays déchiré par le désordre et l'anarchie. » (Charles De Gaulle - discours du 15 mai 1947 à Bordeaux.)
Certes, les palinodies d'Edgar Faure à Paris, les nombreuses valses hésitations de Granval à Rabat, vont s'ajouter à la vague de calomnies lancées contre la France par le clan parisien conduit par Mauriac et Robert Barrat, (futur reporter de L'Express, auprès du F,L.N. en 1956 ) et aux encouragements ainsi donnés aux extrémistes de I’Istiqlal d'El Fassi qui vont déchaîner contre tout ce qui est Français ou ami de la France une vague d'atrocités : Casablanca en décembre 1952 - massacres d'Oujda, de Khénifra, d'Oued Zem en août 1955 où une cinquantaine de civils français sont dépecés à la hache, femmes éventrées, enfants tronçonnés. Mauriac détourne la tête. Il s'en prend au Pacha de Marrakech, Thami El Glaoui, ami indéfectible de la France, dont le fils, Mehdi, sous-lieutenant, est mort pour la libération de notre pays qui va le renier et le livrer à son pire ennemi, Mohammed V..
Mauriac se déchaîne contre le Maréchal Juin, doublement haÏ parce qu’il était un militaire vénéré, couvert de gloire et, de surplus, pied Noir, deux motifs d'exécration pour l'intelligentsia parisienne ! Mauriac avait fait campagne, contre le candidat Juin, puis il avait intrigué pour que les travées de la Coupole soient désertées le jour de la réception du Maréchal. Or, cette réception fut triomphale, le 25 juin 1952. Tout cela n'est que pitoyable mais ce qui est plus grave, c'est que Mauriac, dans toute cette affaire du Maroc, aura constamment tiré contre ses compatriotes et contre toutes les nombreuses personnalités marocaines amies de la France, par une sorte de jeu pervers résolument anti-national, faisant un long bout de chemin avec Sartre et le parti communiste. (Le Diable et le Bon Dieu) Pour I'Algérie, ce sera pire ! S'il ne se fit pas porteur de valises - sans doute en raison de la faiblesse de sa constitution - Mauriac va donner sa bénédiction à tous ceux qui veulent exterminer ou chasser cette communauté chrétienne envers laquelle il n'éprouve que mépris : " ce peuple pied noir très singulier, d'une race méditerranéenne française par la langue mais non par le tempérament... ( Le Figaro littéraire du 25 mai 1962, donc écrit au plus fort de l'exode!). Notre grand chrétien n'aura pas un mot, fut-ce le plus discret, de compassion envers ces vacanciers du désespoir.
Au moment des Barricades d'Alger, en janvier 1960, lorsque De Gaulle parut triompher, Mauriac se prosterna devant son idole « Charles De Gaulle n'est pas seulement l'homme du destin il est l'homme de la grâce ». Jean Lacouture qui nous rapporte ces propos dans sa biographie (« Mauriac » o.c.), ajoute malicieusement que quelques semaines plus tard Mauriac était décoré, par De Gaulle en personne, de la Grand Croix de la Légion d'Honneur, décoration exceptionnelle pour un civil. Ruban rouge contre eau bénite ? Joie des bonnes âmes de droite en métropole, angoisse montante dans la communauté chrétienne d'Algérie qui se sent doublement abandonnée. Le terrible divorce est en train de s'amorcer.
Comme pour le Maroc, Mauriac pouvait-il vraiment tout ignorer de I’Algérie en militant avec une telle ferveur (avec sa foi religieuse) au service des extrémistes du F.L.N qui veulent anéantir la communauté française et chrétienne ? Double trahison ! Pourtant le christianisme avait précédé de cinq cent ans I'Islam d’Afrique romaine et chrétienne fut une des périodes les plus florissantes de la chrétienté primitive avec des évêques célèbres, de grands Saints, des Pères de I’Eglise et aussi des martyrs... Puis ce fut la chrétienté souffrante à l'époque des Barbaresques entre le XV et le XIXème siècles dont la foule des esclaves chrétiens atteignait, certaines années, plus de trente mille membres à El Djazaïr...
Assistés par tes Trinitaires de la Rédemption, l'Ordre de la Merci, les Lazaristes de Saint Vincent de Paul rachetèrent, en deux siècles, plusieurs centaines de milliers d'esclaves. (Pierre Goinard ; La catholicité en Algérie, Itinéraires - juin 1982). La France détruisit un nid de pirates qui ravageaient tous les pays chrétiens de la Méditerranée occidentale, en débarquant à Sidi Ferruch, le 3 juillet 1830, mettant ainsi fin à des siècles d'esclavage.
Mais de tout cela, Mauriac n'a cure. Chaque musulman, engagé dans les rangs du terrorisme F.L.N., a pour lui vu le visage du Christ martyrisé. Mais, en face de chaque victime du F.L.N., chrétienne ou musulmane, martyrisée lors d'innombrables attentats, mutilations, profanation des corps, exécution en masse des Harkis, ce Grand Chrétien détourne la tête. Comme celle du triste évêque Duval, sa conscience chrétienne est engagée politiquement et à fond pour le F.L.N. Ils ignorent tous deux la profanation de centaines d'églises et de synagogues, de cimetières chrétiens et de cimetières juifs. Mais, charité oblige, Mauriac va-t-il se pencher enfin sur la grande détresse des rapatriés en métropole ? Face à ceux-là, aussi, il détourne la tête.
Des années plus tard éclate soudain en 1965 I'affaire Ben Barka : cet opposant politique au Roi du Maroc est enlevé et assassiné après tortures par des barbouzes français, sur le territoire français. L’intelligentsia française, qui tolérait parfaitement ce genre d exploits des mêmes barbouzes lorsqu'ils s'exerçaient sur la personne de Français d’Algérie, s'indigne et demande à Mauriac de s'associer à une protestation au nom des Droits de I'Homme. Hélas, Roger Frey, créateur et grand maÎtre des barbouzes, est un pur gaulliste et le Roi du Maroc, un grand ami personnel... Alors, une fois de plus, Mauriac détourne la tête...
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il fut assailli par des brigands qui le dépouillèrent et le laissèrent à demi mort, au bord du chemin. Un prêtre passa, par hasard, le vit, détourna la tête et continua sa route"' ''
Evangile selon saint Luc chapitre, 18 verset 5
Dr Pierre CATTIN
Médecin métropolitain
|
|
Entre les griffes de Moloch
par M. Robert Charles PUIG.
|
Je n'avais pas envie d'écrire ces lignes mais le vase déborde de mauvaises choses et il me semble que personne ne réagisse et encore moins une droite unie. Est-ce là, ce que souhaite le peuple? Un peuple soumis; la corde au cou comme le veut Macron ? Deux fois il nous présente Lecornu en insistant pour que ce clone passe. C'est réussi avec le PS de Faure qui parraine la formation d'un gouvernement de gauche porteur de misère. Avec quels objectifs tellement inquiétants !
Avez-vous noté que rien ne vient amender l'immigration ? Elle demeure ce qu'elle est, importante, insécurisante et surtout, elle coûte de plus en plus chère. Le tandem Borne- Barrot fait pire. Les deux augmentent la capacité de recevoir des "étudiants" algériens sans la contrepartie d'obtenir le retour de Boualem Sansal. La honte continue et aucune des lois avantageant les algériens, de celle de 1962 à celle de 1968 et consorts ne sont abrogées. La farandole infernale continue au grand ravissement de l'Élysée.
Avez-vous noté combien la facture des impôts va toucher tout le monde ? Les riches et les pauvres, les actifs et les retraités ? Plus d'impôts et moins de pièces dans le porte-monnaie. Lecornu pénalise les vieux - après l'encouragement de se laisser "suicider" en cas de maladie, on pénalise le 10 % avant impôts et on bloque les augmentations prévues des revenus des pensions et des salaires. Entreprises ou particuliers nous sommes la cible sans que les dépenses de l'état soit amandées. Pour tous, cerise sur le gâteau, on va revoir la transmission des biens en héritage de façon qu'il n'y aura plus de suivi dans la protection des avoirs familiaux. Il faut que de l'anonymat. Une France sans passé, sans culture comme le souhaite Macron.
Avez-vous noté sur le plan international comme nous nous enfonçons dans le mépris des autres ? C'est pire que le mépris que Macron affiche envers le peuple de France ! Nous avons perdu nos amitiés africaines ; Donald Trump avec Melonie se moquent de Macron en public et nous avons toujours un président qui reste loin des grands conflits sans être pour un sou dans les accords de Trump entre Israël et la Palestine, sans être pour un brin dans la paix en Ukraine.
Avez-vous noté combien notre côte internationale se dégrade ? Il ne nous reste qu'un A sur les trois que nous avions il y a peu et les mesures du gouvernement "Lecornu-socialisant" vont nous enfoncer dans la merde avec le soutien du LR vieillissant, palissant et pratiquement en fin de vie.
Tout cela c'est notre quotidien ! Macron a gagné avec le PS et nous arriverons à ce qu'il souhaite. Une France qui n'est plus la France mais un territoire aux mains de l'islamisme. Une France qui n'aura plus une majorité de français dans 10 ou 15 ans et qui deviendra un fief où le coran sera la religion dominante. Devrons-nous les catholiques porter la marque de notre religion sur nos vêtements ? Devrons-nous payer la dîme de ceux qui ne sont pas du bon coté de la religion ? Personnellement, j'attendais un sursaut du peuple. Je ne constate que juste sa soumission à Moloch et à un Élysée macroniste et socialisant. Faure et Hollande gagnent. Macron rejoint son camp du mal. nous subissons !
Il me semble que nous ne sommes plus rien.
Robert Charles Puig / 18/10/2025
|
|
LES HARKIS
De Mme Hafida Chabi et M. Wolf Albes
Le 13 mai 2014
|
DRAMES OU TRAGEDIE
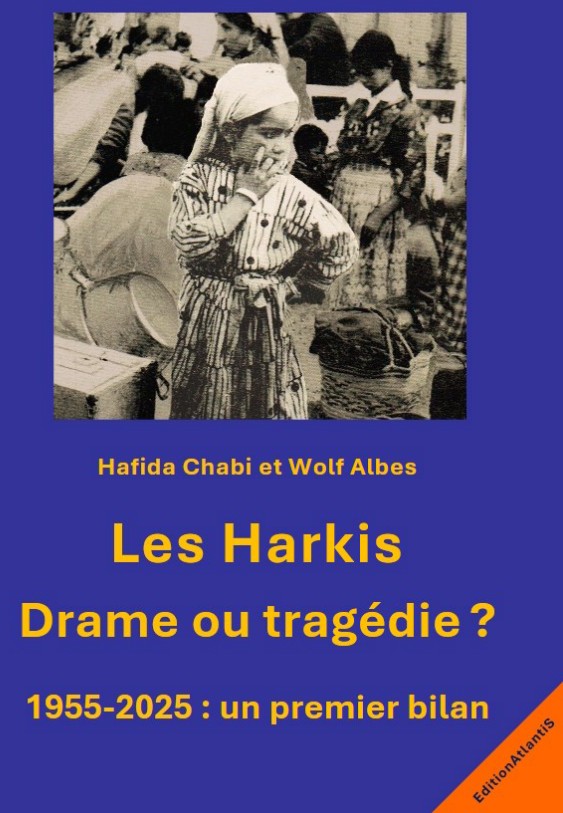 À mes parents,
Au silence de leur vie,
À mes parents,
Au silence de leur vie,
au traumatisme de l'exil
Et les séquelles laissées par
la vie dans les camps.
À leur courage et leur dignité.
Hafida Chabi
À mon père,
Résistant, jeté en prison,
Bataillon disciplinaire BB 500,
Condamné à mort et déserteur,
Prisonnier en Sibérie,
Qui m'a donné l'exemple.
Wolf Albes
À l'image floue du harki un peu faux immigré, collabo sur les bords, telle qu'elle persiste de nos jours dans des associations traitant des droits de l'homme ou du racisme et d'obédience socialiste, nous substituerons celle, plus historique, du harki combattant de la France. Dans ce pays, il faut arrêter de tirer le monde vers le bas.
Dr Patrick Jammes, médecin au camp de Bias
Notre conditionnement culturel, c'est celui de la Révolution française. Le mot de Clemenceau selon lequel « la révolution est un bloc » va servir de caution à tous nos refus de distinguer entre le crédit et le passif de 89. La terreur fait partie de la révolution, donc on n'y réfléchit pas sérieusement. Ainsi s'introduit dans l'inconscient collectif des Français une sorte d'accoutumance à l'effusion de sang périodique, rite sacrificiel, holocauste populaire.
Tout ordre est violence, mais l'ordre que prépare la plus légitime des contre-violences n'échappe pas à cette règle.
D'où ma vigilance obsessionnelle devant l'usage et le dosage de la contre-violence. D'où mon opposition à Sartre et ses amis en radicalité.
Jean Daniel, L'Ère des ruptures, 1979
Présentation – bilan – perspectives
Le Monde, champion de l'engagement pour les harkis
C'est un record absolu qui force le respect : en 1962, Le Monde a publié soixante-cinq articles sur les harkis et les autres supplétifs musulmans. Comment expliquer cet admirable engagement pour les harkis de la part d'un quotidien classé aujourd'hui à gauche ?
Il paraît qu'à l'époque, Le Monde était un quotidien plutôt libéral, très ouvert et équilibré. On cite aujourd'hui fréquemment l'article de Pierre Vidal-Naquet et encore davantage celui de Jean Lacouture qu'ils ont publiés le 11 et le 13 novembre 1962 comme preuve de leur engagement pour les harkis et pour avoir attiré l'attention de l'opinion publique sur leur calvaire.
D'après la préface à l'admirable témoignage Fille de harki de Fatima Besnaci-Lancou, Jean Lacouture serait "parmi les premiers, en novembre 1962, à dénoncer dans Le Monde le martyre des harkis". Non, tout au contraire : notre analyse nous permet de constater que Jean Lacouture a mis beaucoup de temps pour réagir à ce drame, étant donné qu'il avait publié auparavant plusieurs articles sur l'Algérie sans mentionner les harkis, contrairement à bien d'autres collègues comme Maurice Denuzières et Michel Legris dont l'engagement fut prompt et exemplaire – sans parler des autres périodiques qui, parfois dès janvier 1962, lançaient des avertissements inquiétants. En revanche, Jean Planchais – ignorance ou naïveté ? – a rassuré les harkis le 21 juin :
Il est faux d'affirmer que des milliers de harkis étaient massacrés depuis le cessez-le-feu et que des dizaines de milliers d'autres soient menacées de l'être.
Le cas de Pierre Vidal-Naquet
Et en ce qui concerne Pierre Vidal-Naquet, le bilan est beaucoup moins flatteur qu'à première vue parce qu'il dénonce sans aucune retenue l'action des calots bleus, c'est-à-dire les harkis de la Force de police auxiliaire à Paris, ce qui lui vaut une réplique de Maurice Allais dans Combat, le 7 décembre 1962 :
Ce que M. Vidal-Naquet devrait ajouter, et ce qu'il ne fait pas, c'est que si certains harkis se sont rendus coupables de tortures et d'assassinats, leur comportement n'a été dans la très grande majorité des cas que la réponse à des tortures et des assassinats commis antérieurement par le F.L.N.
Et que dire de ces Algériens dans les arrondissements concernés qui remerciaient les harkis et leur patron Raymond Montaner de les avoir libérés de l'emprise du FLN comme le rapporte Linda Amiri dans La bataille de France (2004) ?
Et que penser de la proposition de M. Vidal-Naquet de faire rééduquer tous les harkis par des membres modérés du FLN ? Dans des camps de rééducation à l'image de ceux du Vietminh ?
Les autres périodiques étudiés à la loupe
À côté du Monde, il faut, bien entendu, mettre aussi en avant ses grands confrères classés plutôt à droite comme Combat (48 articles), Le Figaro (42) et L'Aurore (35) – sans oublier les hebdomadaires d'"extrême-droite" comme La Nation française et Esprit public qui, les premiers, ont tiré la sonnette d'alarme 9 en prédisant avec une lucidité et une précision inouïes l'abandon et le massacre des harkis ainsi que le calvaire des Pieds-Noirs – comme cela est d'ailleurs le cas de certains journalistes et écrivains "de droite" comme Jean Brune dont il sera encore question dans la deuxième partie de notre ouvrage, où plusieurs notes de lecture lui sont consacrées.
Les périodiques de gauche en 1961/1962 face aux harkis :
silence, rejet, dénigrement
Quant aux périodiques "de gauche" comme Libération, L'Express et France Observateur – sans parler des Temps modernes –, le bilan est catastrophique comme le montre notre analyse. Nous avons inclus encore le magazine Paris Match pour avoir une image plus complète. Pour ce dernier aussi, le bilan est décevant : un seul article en avril 1962 sur le bachaga Boualam qui a refusé la demande du colonel Gardes de le rejoindre pour former un maquis OAS dans l'Ouarsenis. Mais absolument rien sur le calvaire des harkis, contrairement à de nombreux reportages sur celui des Pieds-Noirs – et, bien entendu, comme pratiquement dans tous les médias de l'époque, sur l'OAS dont les actions sont fustigées sans réserve pratiquement chaque jour.
Dans son grand reportage sur la manifestation du 17 octobre 1961, Paris Match n'a même pas mentionné l'engagement des calots bleus. Comme ceux-ci sont parfois mentionnés dans la presse en 1962, nous avons jugé utile de jeter un coup d'œil sur les périodiques de gauche déjà cités pour la période de juillet à décembre 1961 : effectivement, nous avons trouvé quelques articles très hostiles aux harkis. Le plus agressif et le plus connu est celui de Claude Lanzmann dans les Temps modernes, où il les traitait d'esclaves et de chiens.
La critique de la gauche par Charles-Robert Ageron
En 1990, Charles-Robert Ageron porte un jugement sévère sur la gauche française de l'époque. Pendant que la population française aurait condamné dans sa grande majorité le terrorisme du FLN en métropole qui causait de nombreux morts et blessés parmi les policiers et gendarmes, les "quelques militants ou intellectuels engagés aux côtés du FLN et quelques journaux dénoncèrent systématiquement l'action de la police, la chasse au faciès, les sévices et tortures, et fustigèrent particulièrement l'action des harkis "comme dans" le dossier présenté par Paulette Péju : Les Harkis à Paris", tout en rapprochant "la véhémence de ces dénonciations […] du petit nombre de harkis : 150 hommes en janvier 1960, 350, fin 1961 ". Et Ageron conclut :
Plus certainement encore, les réactions de peur et de colère face au terrorisme algérien, sous-estimées aujourd'hui par les chroniqueurs, ne furent-elles pas l'une des composantes de l'opinion profonde des couches populaires ? Et n'ont-elles pas contribué à renforcer les stéréotypes racistes de l'Algérien agressif et violent, vindicatif et impitoyable ? Parmi les séquelles de la guerre d'Algérie, on aurait probablement tort d'oublier la marque, dans la mémoire des Français, de cette guerre entre Algériens qu'ils jugèrent absurde et révoltante. ( "Le FLN et l'opinion française", in : J.-P. Rioux, La guerre d'Algérie et les Français, Fayard 1990 : 62. 10)
Dans pratiquement tous les articles parus dans les périodiques de gauche – mais très rarement aussi dans quelques-uns de la presse de "droite" –, les harkis sont associés à l'OAS et à des officiers susceptibles de les recruter pour des activités terroristes ou un nouveau "putsch fasciste" très redouté.
Les articles sur le terrorisme du FLN en métropole avant le 5 juillet 1962
Nous avons donc jugé bon de signaler plusieurs articles sur le terrorisme du FLN et du MNA en métropole, que ce soient des règlements de comptes entre eux ou des attentats ciblés contre les forces de l'ordre, pour rappeler la situation en 1962 (et bien avant, cela va de soi) : le nombre d'articles et de reportages – presque quotidiens ! – sur ces affrontements qui ont dégénéré souvent en d'intenses fusillades dans Paris mais également en province, avec de nombreux morts et blessés à la clé – souvent aussi avec de "regrettables dommages collatéraux", c'est-à-dire des civils français qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment – est hallucinant.
La stratégie du FLN après le 5 juillet 1962 : créer un "État dans l'État"
Et si ces affrontements violents sont devenus très rares après le 5 juillet, c'est que le FLN tenait à ne plus trop provoquer l'opinion publique. Mais si ses actions devenaient plus discrètes, elles n'étaient pas moins totalitaires pour autant : recensement, fichage et contrôle inconditionnels de la population algérienne avec menaces, de rackets, d'enlèvements, de tortures dans les fameuses caves de certains hôtels particuliers tout comme des condamnations et exécutions par ses "tribunaux populaires".
De nombreux articles décrivent la situation inquiétante de ceux qui n'étaient pas prêts à se soumettre aux lois implacables et très particulières de cet "État dans l'État" qui – tout comme l'OAS d'ailleurs ! – se substituait à l'État français.
Le cas le plus cocasse est certainement celui rapporté par L'Aurore, le 4 décembre 1962, qui titre : « Les "percepteurs" du F.L.N. avaient décrété la Goutte-d'Or "territoire algérien" ». Sans parler de ces cas, où des centaines de musulmans assiégeaient des postes de police pour exiger qu'un des leurs soit relâché.
Les harkis face à la pression du FLN en métropole
Comme le prouvent de nombreux articles dans les périodiques, c'étaient les harkis, ces "traîtres", qui étaient particulièrement visés et qui refusaient souvent de payer leurs "arriérés révolutionnaires" depuis le 1er novembre 1954. De plus, tant de harkis se sont vus refuser une simple chambre d'hôtel, parce que celles-ci étaient sous l'étroit contrôle du FLN, ou un poste de travail à cause de l'hostilité des syndicats communistes comme la CGT. Et combien d'entre eux ont préféré retourner dans les camps pour avoir au moins la vie sauve parce que la France ne pouvait pas assurer leur sécurité – au point que dix-huit préfets se déclarèrent incapables d'accueillir des harkis dans leur département à cause de cette situation !
On peut donc se demander à juste titre à quel point tous les périodiques qui ont tu la situation précaire, ensuite l'abandon, l'exode, le massacre et l'accueil désastreux des harkis, en sont aussi responsables. Leur engagement aurait-il pu changer la donne, rendre au moins possible leur évacuation ?
Maurice Allais : « Serions-nous des criminels ? »
Dès le début, Maurice Allais a sévèrement critiqué les accords d'Évian parce que les garanties qu'ils contenaient pour les Pieds-Noirs et les supplétifs musulmans n'étaient pas à leur tour garanties. Sachant parfaitement ce qui allait arriver, il a demandé sur un ton accusateur : "Serions-nous des criminels ?" Cependant, la gauche continuera encore longtemps à faire la sourde oreille tout en lui reprochant injustement de vouloir sauver "l'Algérie de papa".
Une centaine de notes de lecture
Qu'en est-il des ouvrages publiés jusqu'en 1962 et en 1963 jusqu'à aujourd'hui ?
Dans la deuxième partie, le lecteur trouvera une centaine de notes de lecture de récits, de romans, de témoignages, d'études et d'analyses, mais aussi de BD, de films et de pièces de théâtre qui, dans leur ensemble, constituent un premier bilan dans ce domaine.
Pour la première période allant jusqu'en 1962, on doit impérativement citer les deux excellents romans La Harka (1961) de Thadée Chamski et Cette haine qui ressemble à l'amour (1961) de Jean Brune ainsi que le drame Le Fleuve rouge (1957) de Jules Roy et les essais L'Espérance trahie (1962) de Jacques Soustelle et L'Algérie d'Évian (1962) de Maurice Allais, dans lesquels les harkis jouent un rôle important.
Si la grande vague de témoignages et de récits sur les harkis commence timidement dans les années 90 seulement pour s'accroître de plus en plus à partir de 2000, il ne faut pas oublier que certains auteurs comme Jean Brune (Interdits aux chiens et aux Français, 1967 ; Les Mutins, 1967), Serge Groussard (L'Algérie des adieux, 1972), Georges Fleury (Les Combattants du mauvais choix, 1976) et Bernard Moinet (Ahmed ? Connais pas…,1978) se sont engagés bien avant déjà.
Le motif de l'engagement des harkis comme pierre d'achoppement
Lors de notre lecture des récits et témoignages, mais aussi des études sur les harkis, nous avons vite constaté que c'est souvent le motif de l'engagement des harkis qui fait débat. Si les uns mettent l'accent sur la protection des leurs face à la terreur du FLN, les autres soulignent le dénuement comme facteur essentiel, conséquence logique, bien entendu, de la situation coloniale qu'il faut donc condamner et rendre exclusivement responsable de tous les maux.
Quelle surprise dans le récit d'un ancien harki qui insiste sur le fait que vu sa situation très aisée, son engagement n'avait qu'un seul motif : la protection de sa famille contre la terreur du FLN.
Les écrivains et metteurs en scène algériens, les pires ennemis des harkis
Ce sont surtout les écrivains algériens comme Rachid Mimouni (Tombéza, 1984) et Rabah Belamri (Regard blessé, 1987) qui s'en prennent aux harkis avec une haine et un mépris sans bornes. En ce qui concerne le cinéma, Florent-Emilio Siri nous off re avec L'Ennemi intime (2007) un chef-d'œuvre impressionnant qui décrit, entre autres, d'une manière exemplaire le problème des harkis tout en ridiculisant en passant l'amateurisme et le militantisme basique de La Trahison (2005) et des Harkis (2022) de Philippe Faucon.
Mais que dire des metteurs en scène algériens Rachid Bouchareb (Hors-la-loi, 2010) et, pire encore, Mehdi Charef qui, après son beau roman Le Harki de Meriem (1987), nous présente son film Cartouches gauloises (2007) et son drame 1962. Le Dernier Voyage (2005), où les harkis sont de véritables monstres qui ne méritent qu'un seul châtiment : l'exécution.
La Partie III : les entretiens avec Hafida Chabi
n revanche, c'est dans le sens de l'apaisement que dans la Partie III le « combat tranquille » d'Hafida Chabi continue dans trois entretiens avec Wolf Albes. En dépit de bien des différences, ces entretiens découvrent certaines similitudes entre les traumatismes respectifs de leurs pères :
our l'un, c'est la fuite éperdue dans un camion bâché de l'armée française, la traversée dans la cale d'un bateau et l'arrivée dans le camp de Bitche en Lorraine, où le père essaiera tant bien que mal de garantir une vie correcte à son épouse et ses treize enfants qui, eux, grandiront dans des circonstances difficiles qui les marqueront pour toujours.
Pour l'autre, c'est la résistance contre le régime nazi, la dénonciation par un camarade avec, à la clé, toute une suite de catastrophes : la prison, l'envoi au front russe dans un bataillon disciplinaire, la condamnation à mort, la désertion à travers un champ de mines, et deux ans entre la vie et la mort dans un camp de travail en Sibérie, d'où deux tiers des détenus ne reviendront pas. Et après son retour dans un pays qu'il ne supportait plus, c'est un exil qui se cache derrière une mutation au Chili pour enseigner pendant quatre ans dans une école allemande comme instituteur en ensuite faire des voyages en permanence à l'étranger.
La vie dans les camps et le traumatisme de l'exil
Dans les trois entretiens, nous essayons de décrire et analyser les conditions de vie dans le camp de Bitche en les comparant à celles décrites par les auteurs de tant de récits qui se reflètent dans les différentes notes de lecture qui servent ainsi de base pour une discussion approfondie de divers sujets : le rôle du père, de la mère, des frères et sœurs, l'organisation du camp, la peur du FLN et les fameux barbelés tant décriés. Puis les mariages arrangés et l'émancipation de la femme, les heurts en permanence entre deux cultures, le « combat tranquille » de Hafida qui n'a que deux buts : rendre d'abord la vie de ses parents plus décente et ensuite se battre pour le reste de sa vie pour que les torts commis contre sa communauté soient reconnus par l'État français et que l'histoire des harkis soit transmise aux générations futures en l'intégrant dans les programmes scolaires.
Des projets concrets pour sortir enfin des formules creuses et abstraites
Mais comment réaliser ce dernier point ? C'est cette question qui est au centre du troisième entretien et d'un exposé. Face aux nombreuses difficultés liées au projet d'inviter d'anciens harkis ou des enfants de harkis ou même d'anciens membres du FLN à venir témoigner dans les cours d'histoire, il faut chercher d'autres voies et moyens pour réaliser cette transmission.
Pour ne pas rester dans les éternelles revendications et les formules abstraites, nous proposerons l'exemple d'un projet concret à la suite de deux notes de lecture présentées dans la partie II :
Pourquoi ne pas choisir soit le récit émouvant Le village nègre (2004) de Leïla Sebbar, soit la BD non moins touchante et "réconciliatrice" de Julien Frey et Mayalen Goust, Lisa et Mohamed. Une étudiante, un harki, un secret (2022) pour étudier l'histoire des harkis en classe de français et d'histoire ?
C'est ainsi que le sujet des harkis pourrait entrer dans les programmes scolaires d'une manière attrayante, originale et surtout "juste", c'est-à-dire en évitant tout militantisme anticolonialiste et dans un authentique esprit d'apaisement et de réconciliation, deux termes qui malheureusement – comme nous l'essayons de le démontrer dans notre exposé – restent souvent des formules creuses et même mensongères pour mieux cacher un militantisme anticolonialiste exacerbé et pour imposer une vision partiale et même doctrinaire de l'histoire de la colonisation française et de celle des harkis ou du FLN.
Une fondation pour les harkis ?
Après 1962, a-t-on vraiment passé le sujet des harkis sous silence ?
En regardant la date de publication de différents ouvrages dont nous présentons des notes de lecture, nous avons pu constater tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai : mais comme ce sont surtout des auteurs classés de droite qui n'arrêtent pas de rappeler le drame des harkis aux Français, on préfère aujourd'hui les passer sous silence ou les écarter comme quantité négligeable et peu sérieuse.
Pour être fixé sur cette question, il faudra donc entreprendre des recherches plus avancées et analyser la présentation des harkis non seulement dans la presse écrite, mais dans tous les médias entre 1962 et 2000 – projet hautement intéressant pour justifier la création d'une fondation pour les harkis – tout comme celui de faire des sondages parmi les professeurs de français et d'histoire sur tout ce qui est en relation avec l'enseignement de la guerre d'Algérie en général et les harkis en particulier. Ce serait le terrain idéal pour cette fondation qui pourrait initier, encourager et financer de tels projets .
"Il y a des vérités, mais pas de vérité" –
"Il y a des réponses, mais pas de réponse"
Dans le second cycle de ses Carnets d'Orient, où les supplétifs musulmans, dont les harkis, contrairement à ses compatriotes pieds-noirs, sont présentés sous un jour extrêmement favorable, Jacques Ferrandez cite une phrase du Mythe de Sisyphe d'Albert Camus que certains historiens ne respectent toujours pas (tout en prétendant insidieusement le faire), mais qui est valable surtout par rapport à notre but d'ouvrir de nouveaux horizons pour mieux comprendre et transmettre l'histoire des harkis : "Il y a des vérités, mais pas de vérité".
Pourrons-nous un jour répondre définitivement à la question de savoir si l'histoire des harkis est un drame ou une tragédie et qui en porte la responsabilité ?
Peut-être devrons-nous revenir à Camus pour conclure : il y a – et il y aura – des réponses, mais pas de réponse.
On peut commander cet ouvrage (450 pages), dans les librairies, sur Amazon, Priceminister ou sur mon site :
https://editionatlantis.de/publikationen/?lang=fr
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône et la Province du Constantinois méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il a continué jusqu'à son dernier souffle. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous, des pages qui pourraient être complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir. Jean Claude est décédé, et comme promis j'ai continué son oeuvre à mon rythme.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Guelma, Philippeville, etc. a été fait pour d'autres communes de la région de Bône et de Constantine.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et du Constantinois
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
|
|
| Les Retrouvailles
Envoyé Par Eliane
|
Trois petits vieux qui étaient bons amis se retrouvent après de longues années :
Que faite-vous depuis que vous êtes en retraite?
Le premier dit : - " Moi, je fais de la photo..."
Le deuxième : - " Moi, je jardine..."
Et le troisième annonce : - " Moi, je fais de la recherche!!! "
- " Ah bon! Et dans quoi ??? "
- " TOUS LES JOURS, JE CHERCHE MES LUNETTES, MA CANNE, MON DENTIER, MES CLÉS... "
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d'informer est grandement menacée, et c'est pourquoi je suis obligé de suivre l'exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d'information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d'expression, tel qu'il est reconnu par la Résolution 59 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d'expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|


 Comme chaque année, la fête de la Toussaint est accompagnée des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans le manteau qu’on vient juste de ressortir, les jours qui raccourcissent, le gris du ciel traversé par des averses. Le froid qui s’installe doucement.
Comme chaque année, la fête de la Toussaint est accompagnée des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans le manteau qu’on vient juste de ressortir, les jours qui raccourcissent, le gris du ciel traversé par des averses. Le froid qui s’installe doucement.
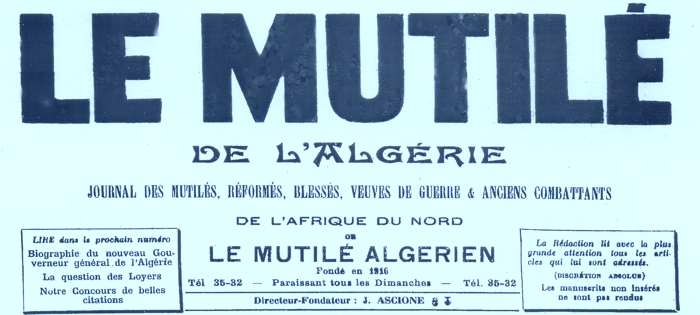
 Deux étages largement aérés par leurs 33 fenêtres de façade.
Deux étages largement aérés par leurs 33 fenêtres de façade.
 Une attention toute spéciale est accordée aux enfants dont la santé délicate réclame le grand air et des soins plus assidus mais aucune malade n'est reçue au Pensionnat ; un certificat médical est demandé au moment de l'inscription.
Une attention toute spéciale est accordée aux enfants dont la santé délicate réclame le grand air et des soins plus assidus mais aucune malade n'est reçue au Pensionnat ; un certificat médical est demandé au moment de l'inscription.
 Tout le monde en France connaît Mgr Gerlier. Fils d'un haut fonctionnaire des P.T.T., il naquit à Versailles en 1880. Elève du Collège de Saint-Lô, puis du Lycée de Bordeaux, il fit son droit dans cette dernière ville, y passa sa licence et son doctorat, et enfin s'inscrivit au barreau de Paris.
Tout le monde en France connaît Mgr Gerlier. Fils d'un haut fonctionnaire des P.T.T., il naquit à Versailles en 1880. Elève du Collège de Saint-Lô, puis du Lycée de Bordeaux, il fit son droit dans cette dernière ville, y passa sa licence et son doctorat, et enfin s'inscrivit au barreau de Paris.


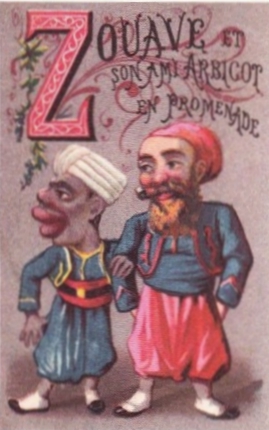 CHAMP (Val d'Oise) raconte comment il fut inspiré pour composer les couplets de « Quand Madelon ». Il avait contracté un engagement volontaire en 1889 au 3éme Régiment de Zouaves à BATNA (Algérie).
CHAMP (Val d'Oise) raconte comment il fut inspiré pour composer les couplets de « Quand Madelon ». Il avait contracté un engagement volontaire en 1889 au 3éme Régiment de Zouaves à BATNA (Algérie).
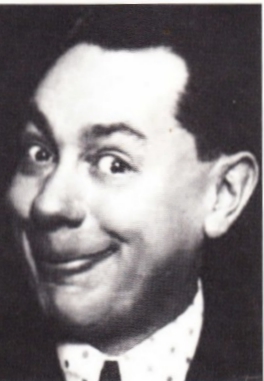 Mais c'est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui, mobilisé au 140ème Régiment d'Infanterie à GRENOBLE, va imposer la chanson aux poilus, sur une musique de Camille ROBERT.
Mais c'est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui, mobilisé au 140ème Régiment d'Infanterie à GRENOBLE, va imposer la chanson aux poilus, sur une musique de Camille ROBERT.
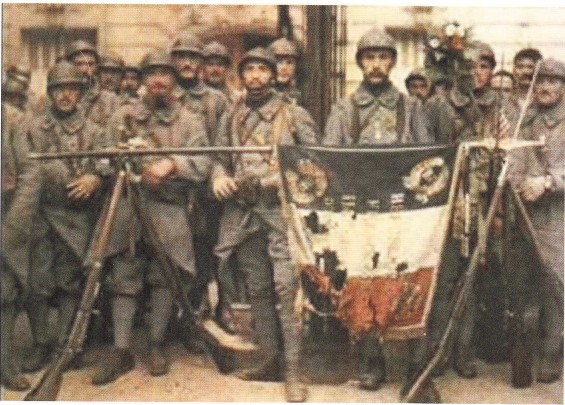

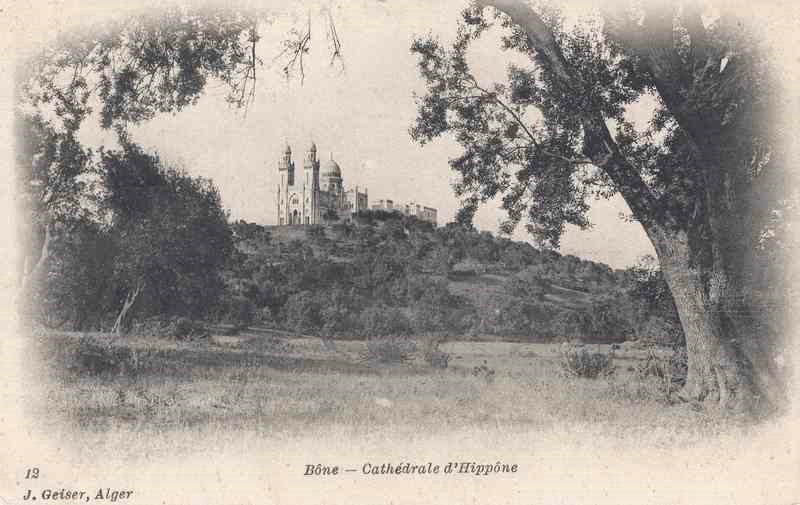
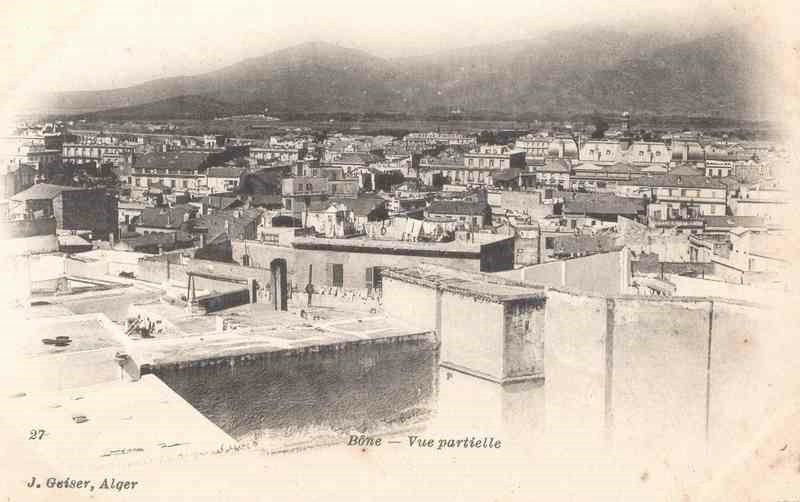
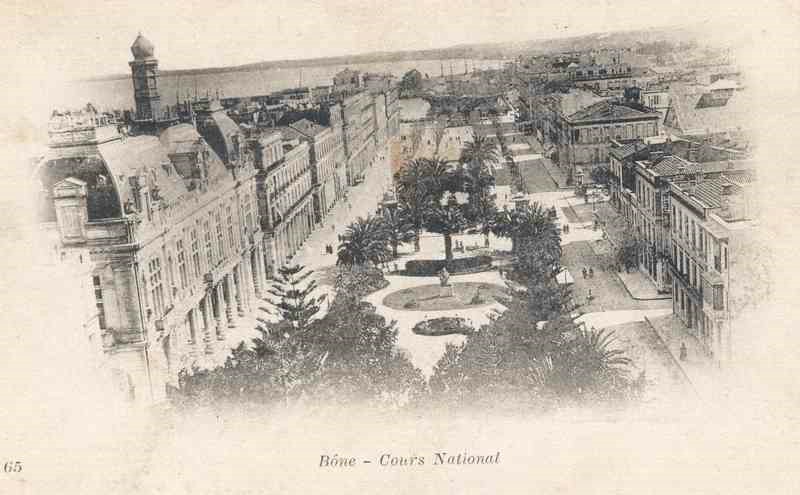


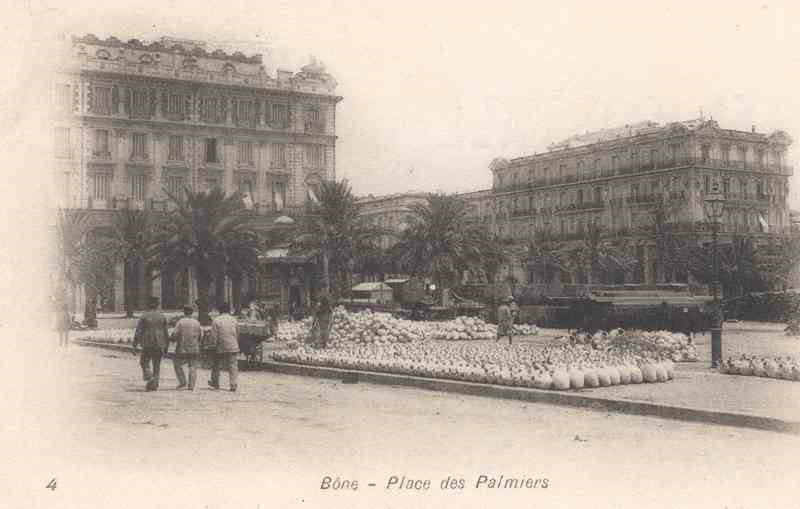
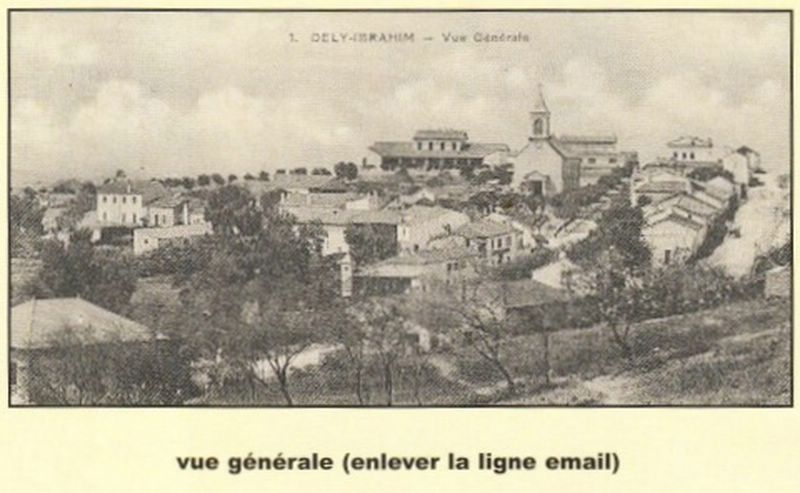 Pour en situer l'époque, certains écrits indiquent que son église a été consacrée le 21 mars 1841 par le premier évêque d'Algérie : Monseigneur DUPUCH.
Pour en situer l'époque, certains écrits indiquent que son église a été consacrée le 21 mars 1841 par le premier évêque d'Algérie : Monseigneur DUPUCH.
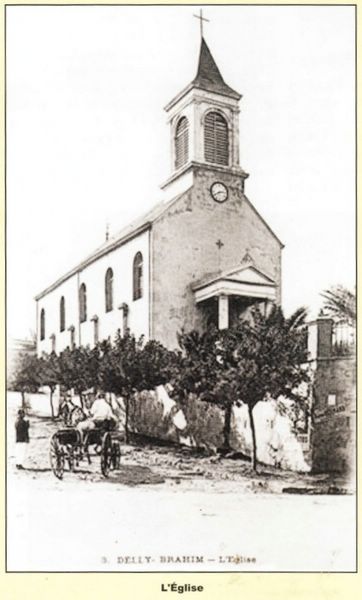 Dans la partie inférieure du village, bordant de part et d'autre l'axe conduisant vers OULED FAYET, s'alignent entre autres demeures, I'unique boulangerie du pays (SEMPERE),I'auberge du "BON CANARD" (AUBIS), réputée pour une certaine gastronomie, le monument aux morts. le Café de France (PICOT), la Mairie, l'épicerie HUGOU, véritable caverne d'Ali-Baba.
Dans la partie inférieure du village, bordant de part et d'autre l'axe conduisant vers OULED FAYET, s'alignent entre autres demeures, I'unique boulangerie du pays (SEMPERE),I'auberge du "BON CANARD" (AUBIS), réputée pour une certaine gastronomie, le monument aux morts. le Café de France (PICOT), la Mairie, l'épicerie HUGOU, véritable caverne d'Ali-Baba.
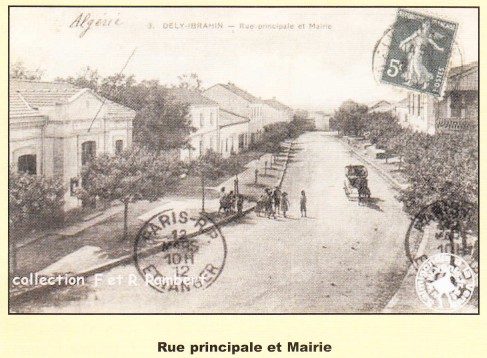 Les chemins qui le sillonnent se raccordent à une clairière centrale au milieu de laquelle a été érigé, en 1912, un monument à la mémoire des combattants du corps expéditionnaire de l'Armée d'Afrique de 1830. Cet ouvrage est surmonté du buste du lieutenant général " DUC des CARS " qui s'illustra dans diverses activités glorieuses.
Les chemins qui le sillonnent se raccordent à une clairière centrale au milieu de laquelle a été érigé, en 1912, un monument à la mémoire des combattants du corps expéditionnaire de l'Armée d'Afrique de 1830. Cet ouvrage est surmonté du buste du lieutenant général " DUC des CARS " qui s'illustra dans diverses activités glorieuses.
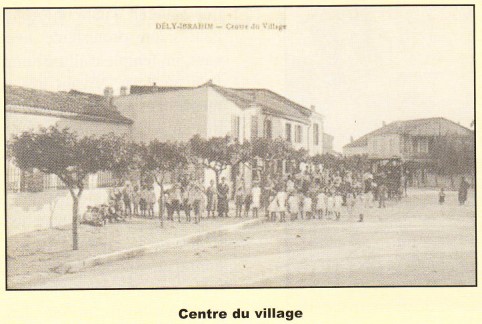 Pour toute force de police, un garde-champêtre, en képi à épis de blé, assurait une surveillance relative, assisté, en cas de besoin, par la brigade de gendarmerie de CHERAGAS. Dans cette fonction, les CAZERTE et ROUX, entre autres, s'y sont, tour à tour, distingués.
Pour toute force de police, un garde-champêtre, en képi à épis de blé, assurait une surveillance relative, assisté, en cas de besoin, par la brigade de gendarmerie de CHERAGAS. Dans cette fonction, les CAZERTE et ROUX, entre autres, s'y sont, tour à tour, distingués.
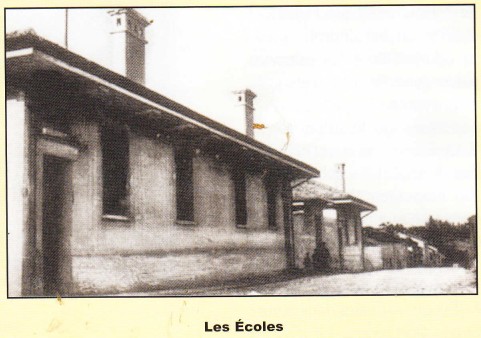 Suzanne SCHILTZ, la directrice, tenait son cours de fin de cycle élémentaire avec une autorité sans faille. Aucun désordre n'était toléré.
Suzanne SCHILTZ, la directrice, tenait son cours de fin de cycle élémentaire avec une autorité sans faille. Aucun désordre n'était toléré.
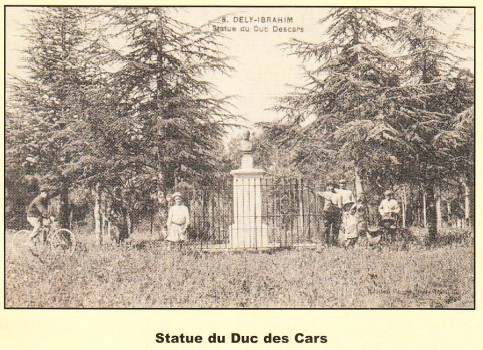 La fête du village, annuelle, donnait lieu à un bal sur la place centrale ombragée de palmiers. Un orchestre entraînait tout le bon peuple aux rythmes des tangos langoureux et des rumbas lascives, tandis que les " mamas ", assises en bord de piste, surveillaient d'un regard attendri, mais non moins attentif, les évolutions de leur progéniture... féminine.
La fête du village, annuelle, donnait lieu à un bal sur la place centrale ombragée de palmiers. Un orchestre entraînait tout le bon peuple aux rythmes des tangos langoureux et des rumbas lascives, tandis que les " mamas ", assises en bord de piste, surveillaient d'un regard attendri, mais non moins attentif, les évolutions de leur progéniture... féminine.
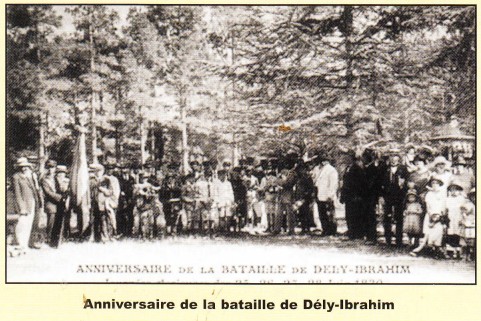 La guerre terminée, les combattants sont rentrés avec pour certains, de graves blessures (comme Raymond BEKER).
La guerre terminée, les combattants sont rentrés avec pour certains, de graves blessures (comme Raymond BEKER).
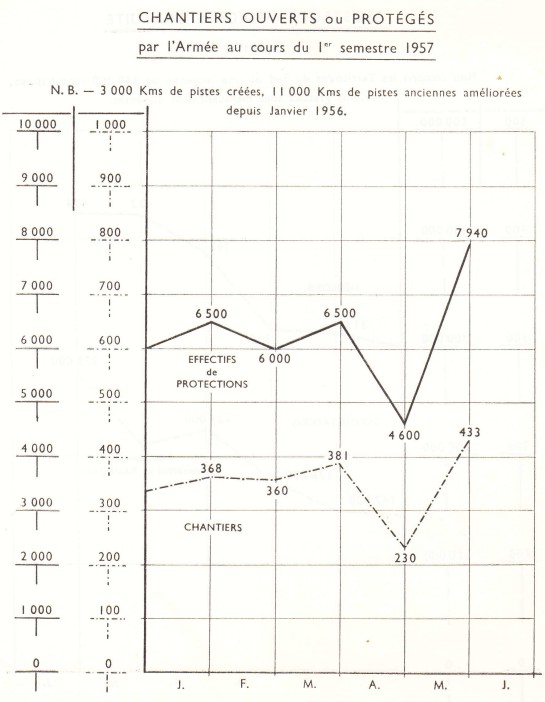
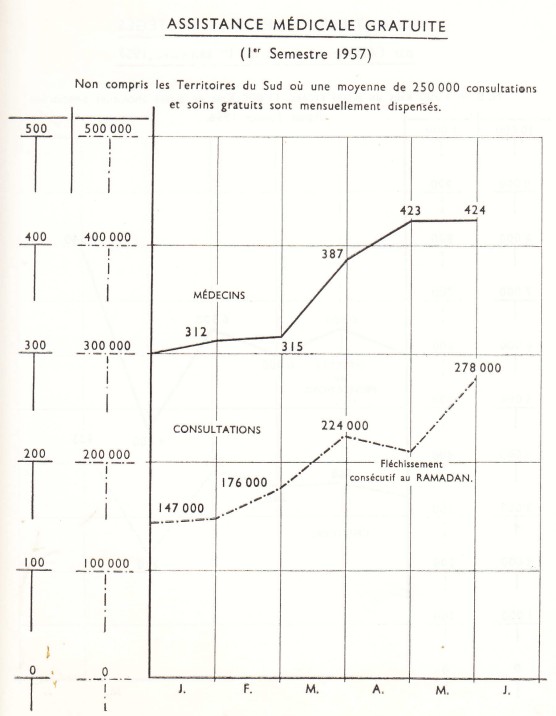
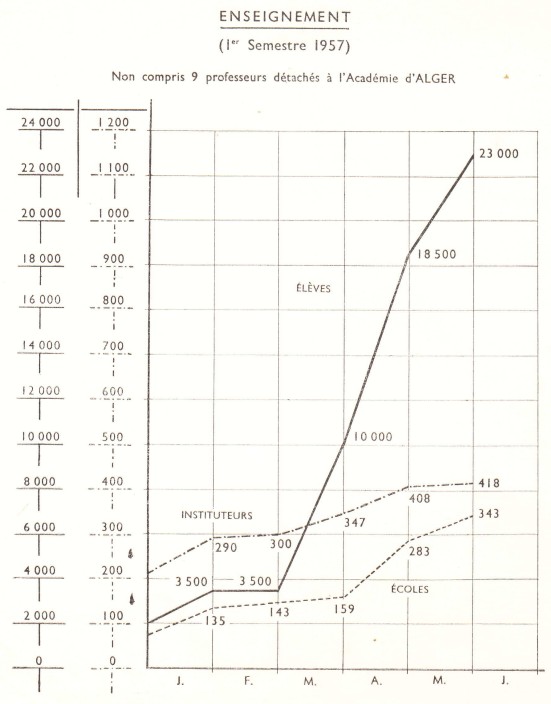
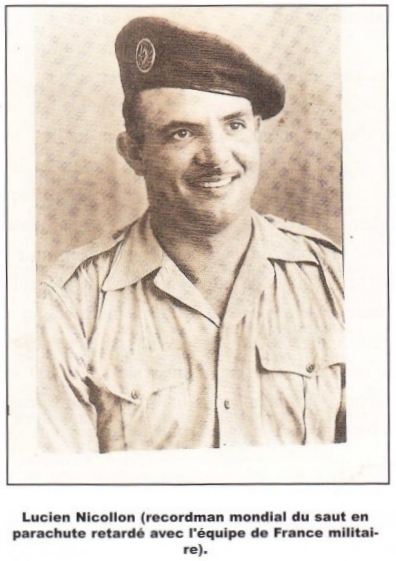 La présidence échut au colonel André Lajoix et la vice-présidence à Roch Lombard, cheville ouvrière de la nouvelle société et dont le local commercial, rue Ramier, était utilisé pour les réunions du bureau. Celui-ci comprenait entre autres membres Particulièrement actifs André Rigal, Christian Faure, Jean Sanchez et le judokas Magot, instituteur, Théodore Garcia.
La présidence échut au colonel André Lajoix et la vice-présidence à Roch Lombard, cheville ouvrière de la nouvelle société et dont le local commercial, rue Ramier, était utilisé pour les réunions du bureau. Celui-ci comprenait entre autres membres Particulièrement actifs André Rigal, Christian Faure, Jean Sanchez et le judokas Magot, instituteur, Théodore Garcia.
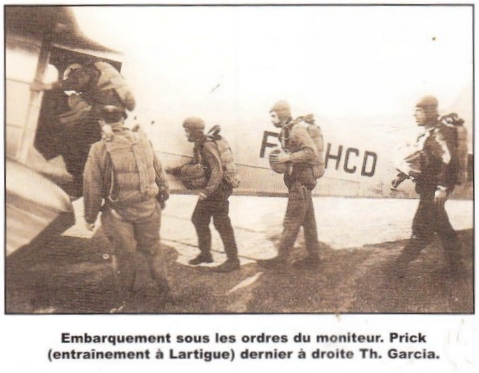 La tentation de s'enivrer de frisson par opposition à toute vie sédentaire confinée dans la bureaucratie.
La tentation de s'enivrer de frisson par opposition à toute vie sédentaire confinée dans la bureaucratie.
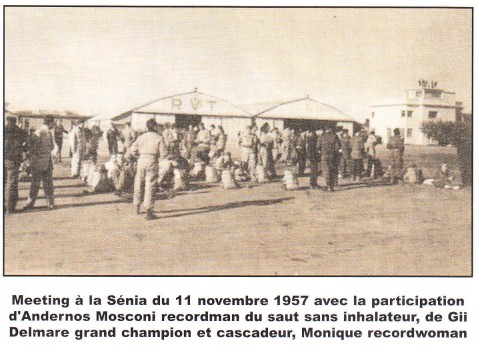 Le 9 décembre 1960, succédant à des interdictions partielles, une interdiction générale de survol du territoire algérien intervint.
Le 9 décembre 1960, succédant à des interdictions partielles, une interdiction générale de survol du territoire algérien intervint.
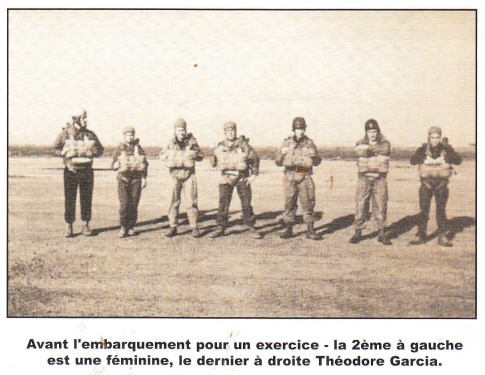
 Peintre officiel
Peintre officiel
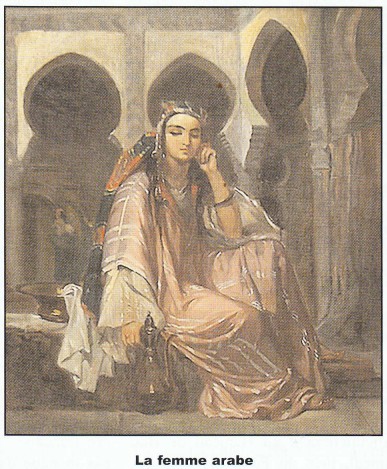
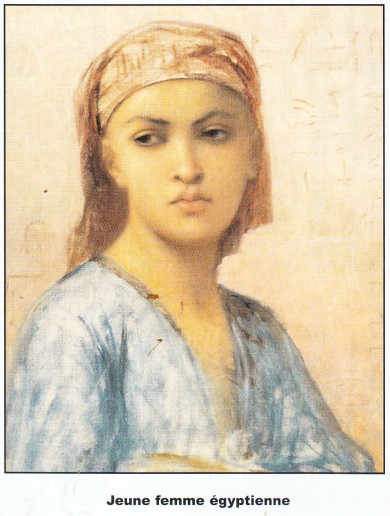
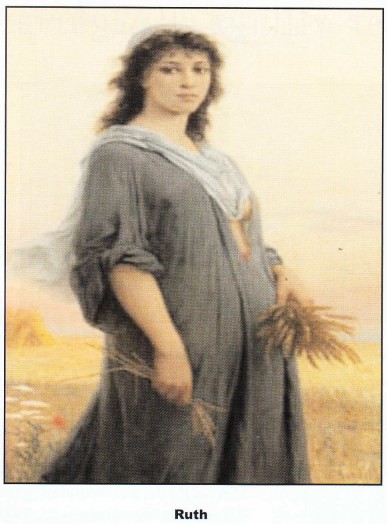 Le succès
Le succès